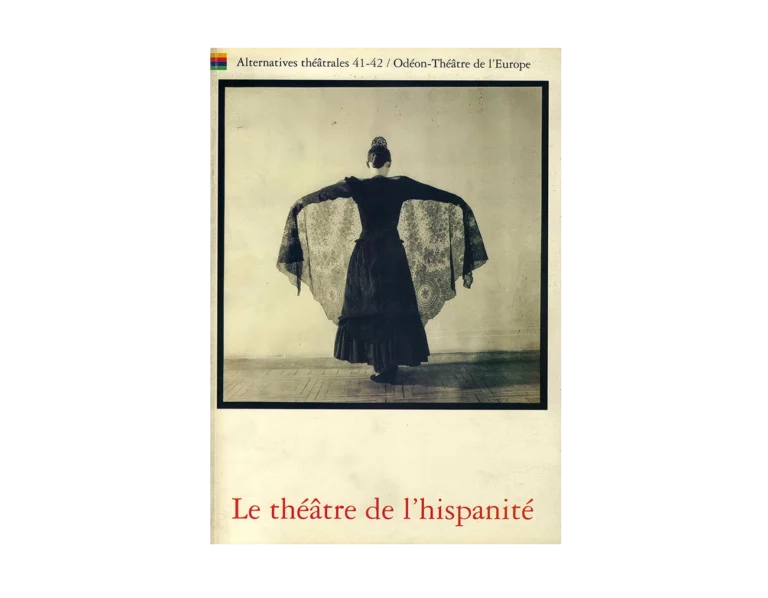— Entretien —
JEAN TORRENT : D’une œuvre que Frédéric Amat a peinte en pensant au CHEVALIER D’OLMEDO, vous dites qu’elle est très « lorquienne ». La pièce de Lope de Vega était au répertoire de la Barraca, le théâtre ambulant de Garcia Lorca. Quel lien unissait les deux poètes ?

Lluís Pasqual : Peut-être l’unique sujet de toute la poésie est-il celui de l’amour et de la mort. Lope et Garcia Lorca sont des poètes qui ont tous deux une grande facilité, elle jouait même parfois contre eux. Ils étaient en quelque sorte des médiums, comme s’ils écrivaient sous la dictée de quelqu’un. Certaines pièces de Lope sont, je ne dirais pas mauvaises, mais presque. Lui-même dit qu’il pouvait écrire une comedia en 24 heures et que plus d’une centaine ont été écrites ainsi. Garcia Lorca avait aussi cette facilité. Un autre trait commun est leur capacité de passer, de façon spudorata, sans transition, du lyrisme au quotidien. Cela signifie qu’ils ont une main extraordinairement libre, un esprit libre dans l’écriture et la composition d’une pièce de théâtre. Et ils sont tous deux, même si c’est un mot que je n’aime pas beaucoup appliqué à l’écriture, très élégants.
Pour les acteurs, les passages abrupts et répétés du quotidien au lyrique exigent une très grande agilité. On ne peut entrer dans LE CHEVALIER D’OLMEDO que par la porte de la poésie. Il faut savoir quand se poser des questions et lesquelles, mais aussi lesquelles ne jamais se poser. Lors de la première rencontre entre le Chevalier et Inès, celle-ci dit à Tello, le valet du Chevalier : « Ami Tello », et Tello lui répond « Ma reine » Il n’y a pas d’explication rationnelle à chercher, c’est comme ça. Chez Flaubert, les diverses couleurs d’yeux de Madame Bovary sont une incohérence du même ordre. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a une vérité pour tous les personnages, c’est toujours une vérité poétique. On a perdu l’habitude de faire du théâtre écrit en vers. Très souvent, l’acteur analyse le personnage, la liste des sentiments qu’il doit maîtriser, et il rapproche le personnage de lui, de sa vérité. Or dans le théâtre comme celui de Lope de Vega, la vérité de l’acteur est en général trop petite. Il ne faut pas que l’acteur s’approprie une vérité du personnage, il faut aller vers elle, parce que la vérité de ces personnages-là, la façon dont ils s’expriment est beaucoup plus énorme, plus haute, elle appartient à la poésie. Il faut que l’acteur essaie de grimper, de voler jusque-là, parce que sa propre vérité sera toujours trop petite. Et quand il aura fait le travail, cela reviendra au même. Seulement, sa vérité se trouvera enrichie. On peut faire tout ce qu’on voudra pour justifier chacun des monologues, ils n’ont aucune justification, ils n’en ont pas besoin. Il faut être très généreux, l’image qui me vient à l’esprit est celle d’un homme aux yeux fermés qui ne sait pas ce qu’on va lui mettre dans la bouche. Or, c’est un verre d’eau claire et transparente, il faut se laisser emporter par le texte, sinon c’est une pièce qui n’a aucune justification possible.
García Lorca aimait beaucoup Lope, mais surtout il admirait LE CHEVALIER D’OLMEDO, en relation sans doute avec l’intolérance que Garcia Lorca dit exister en Espagne. L’intolérance n’est pas caractéristique de l’Espagne, mais lorsqu’elle apparaît en Espagne, elle prend des formes très barbares, sinon on ne comprendrait pas la guerre civile. La guerre civile est bien sûr la conséquence historique d’une révolution industrielle pas faite, d’un retard par rapport à l’Europe, mais elle résulte aussi d’un caractère, d’une façon d’être, on aurait pu résoudre les problèmes d’une autre façon, mais cela a été la guerre civile. Dans LE CHEVALIER D’OLMEDO, il y a un commentaire du roi sur les habits distinctifs que doivent porter les membres des communautés juives et musulmanes. Lope dénonce par là un monde dans lequel peuvent se développer la barbarie et l’intolérance. Rodriguo, le rival du chevalier, ne devient dangereux que lorsqu’il transpose son problème sur un plan politique, lorsqu’il s’écrie « depuis quand les gens d’Olmedo ont-ils le droit de venir insulter ceux de Medina ?».
J.T. : Une version française du CHEVALIER D’OLMEDO a été présentée en 1957 au Festival d’art dramatique d’Angers dans une mise en scène d’Albert Camus. À votre avis, qu’estce qui, dans la pièce de Lope, pouvait séduire Camus ?
LI. P. : L’ÉTRANGER est un des romans qui m’a le plus bouleversé. Cette espèce de hasard qui fait d’un homme un criminel, dans un endroit inconnu où tout est contre lui. Dans LE CHEVALIER D’OLMEDO), il ÿ a deux choses qui sont très proches de l’univers de Camus : le fait d’être étranger quelque part et la solitude. Chez Camus, la solitude est tellement présente que dans sa traduction, Camus change le premier mot de la pièce : « aimer », et non « amour », comme chez Lope. Aimer, comme un impératif, une nécessité d’agir.
Le Chevalier est un personnage qui est seul, une sorte de matador très doué. Le poète Guillen décrit le moment de solitude totale du torero, le goût très amer du café au matin du jour où il s’apprête à affronter la mort. Le Chevalier est un personnage qui à la mort en lui. L’amour seul le tire de sa solitude. Mais je crois que la mort, comme l’amour, l’attire. Chaque fois que le Chevalier laisse s’exprimer son sentiment amoureux, la mort apparaît en même temps : la mort, c’est le fait de non-avoir, d’être privé de l’autre. Ce n’est pas une chose réfléchie. Le Chevalier souffre de mélancolie, au sens où l’entendait le XVIIè siècle, une dépression, une attirance vers le néant, vers la nonexistence, vers la mort. La seule façon de s’en sortir, c’est le hasard de cette fille qui apparaît. Ces « états d’âme », cette dépression sont peut-être la chose la plus difficile à faire passer, chez un être qui est en principe plein de force, d’énergie, de beauté.
Ce n’est pas un hasard si j’ai choisi Jean-Marc Barr pour jouer le Chevalier. Jean-Marc Barr est en quelque sorte un étranger, étranger à la France, au théâtre, au théâtre en France en tout cas. C’est aussi un être à qui on suppose toute une activité physique, c’est un être plein d’énergie, d’énergie positive, que les gens admirent et dont on peut tomber amoureux. Le Chevalier n’est pas exceptionnellement ceci ni cela, il devient énorme parce que Lope le fait énorme. Jean-Marc Barr est, je ne dirais pas à l’opposé, mais en tout cas très loin du Chevalier que je pourrais jouer, si j’avais choisi un acteur medium comme Alcón, par exemple, un acteur à travers lequel je m’exprime, qui a les mêmes vibrations que moi, comme si nous étions deux timbales l’une à côté de l’autre. Anglo-américain, français, le parcours de Jean-Marc Barr est tout à fait différent du mien, il n’a pas l’alexandrin dans le sang, ce qui est bien, mais il n’a pas non plus la mystique dans le sang. Cela peut donner un côté absolument « contemporain ».
J.T. : Dans son très désinvolte NOUVEL ART DRAMATIQUE, Lope de Vega dit que lorsqu’il veut composer une comedia, il enferme les règles à triple verrou. Est-ce cette liberté qui vous pousse à utiliser le qualificatif de contemporain ?
LI. P. : Oui, je ne dois pas penser que je monte une pièce classique du XVIIR siècle espagnol. LE CHEVALIER D’OLMEDO est bien écrit en vers, mais certaines chansons des Beatles ou de Prince le sont aussi. L’idée du contemporain me vient de cette formidable liberté d’expression. La pièce est totalement subversive par rapport aux codes qui prévalent dans la société espagnole d’alors, amour courtois, honneur. Je serais tenté de dire que c’est la pièce des coulisses. En déplaçant l’action au Moyen-Âge, Lope parle de son temps avec une subversion dont seul le théâtre était capable en ce temps-là, il met à nu et révèle l’envers du décor social. Un côté subversif que le théâtre n’a plus ou très peu parce qu’il touche moins la société. Il y a une chose que j’ai toujours trouvée extraordinaire dans le XVITè siècle espagnol. En Angleterre, à la même époque, celle de Shakespeare et du grand théâtre élisabéthain, on ne permettait pas aux femmes de jouer. En Espagne, on le permettait, il y avait même des actrices célèbres, Lope ou Calderén écrivaient pour elles. Or dans ce pays, où il n’y avait pas de troupe placée sous la protection du roi, comme celle de Molière en France, les acteurs étaient considérés comme des êtres maleante, ils n’ont obtenu le droit d’être enterrés en terre sacrée qu’à la fin du XIXè. Dans les autos sacramentels, c’est donc une putain ou un voyou qui jouent le rôle de Dieu, du Saint-Esprit ou de la Vierge Marie. Je trouve cela tout à fait étonnant qu’un être qui est moins que rien puisse représenter Dieu dans l’imagerie chrétienne. Et Lope parvient à casser tout ce qui constituait le code du théâtre, tout ce qu’il fallait dire au théâtre, l’honneur, la morale. Cela jusqu’au personnage du roi. Le roi du CHEVALIER D’OLMEDO n’est même pas Basile, le roi de LA VIE EST UN SONGE, un toi philosophe, un astronome, pétri de doutes, non, c’est un roi sportif, un roi moderne. Rodrigo lui-même, le rival du Chevalier, se sent trahi si l’on veut, mais ce n’est pas l’honneur de la jeune fille qu’il doit défendre. De même qu’on passe sans cesse de la prose au vers, de même les codes sont sans cesse brisés. Comme pour nous dire, ne vous installez jamais.

J.T. : Cela rejoint-il une esthétique de l’inachevé que vous semblez revendiquer ?
LI. P. : Non. D’ailleurs, je comprendrai un jour que l’inachevé n’existe pas au théâtre, il n’est pas lisible comme tel au théâtre, il peut l’être dans une sculpture par exemple. Non, ce n’est pas l’inachevé, c’est la non-gravité dans le sens métaphysique, idéologique. Ne pas s’installer dans le jugement. C’est pour cela que la pièce est moderne aussi. L’amour du Chevalier et d’Inès n’est pas un amour emblématique, absolu, comme celui de Roméo et Juliette. C’est un amour concret, une façon de dire que chaque personne a sa manière d’aimer, qu’aucun amour n’en vaut un autre.
C’est curieux ce que Lope parvient à faire avec une langue aussi rhétorique que la langue du XVII siècle espagnol, une langue dont on faisait, en tout cas, un usage aussi rhétorique. Il en fait une chose légère, limpide comme un cristal pur. Mais la non-gravité, la non-affirmation dépasse le domaine rhétorique, elle s’applique à tous les comportements de l’époque. Qu’est-ce que cette mort obscure, un coup de pistolet dans le dos ? Que signifient, dans la bouche d’un chevalier du XVII siècle, les paroles « Dieu sait que cette nuit, elle aurait pu être à moi » ? ou « il faut que je te quitte, je dois aller voir mes parents » ? ou « je vais aller me changer, parce que si je venais à passer sous la fenêtre d’Inès, il faut qu’elle me voie sous le jour Le plus avantageux » ?
Lope parle des mêmes choses que Calderén dans LA VIE EST UN SONGE, il se pose, comme tous les grands poètes, les questions métaphysiques essentielles, mais il n’affirme jamais. Calderôn trouve une réponse dans la théologie, Lope laisse la question complètement ouverte. Par un jeu de va-et-vient d’une petite chanson (« C’est dans la nuit qu’ils l’ont tué, / lui le Chevalier, / le joyau de Medina / et la fleur d’Olmedo ») à travers les siècles, du Moyen-Âge au XVIIè, du XVIIè au Moyen-Âge, Lope annonce une tragédie, mais sans jouer la tragédie. Et quant à savoir si cet homme était prédestiné ou pas à mourir, le grand thème de la prédestination, la question reste ouverte, pour Lope c’est un des mystères de la vie. Impossible de savoir, dans la pièce, qui a chanté le premier la complainte. On l’entend tout au début de la pièce, le laboureur qui la fredonne dit l’avoir entendue d’une certaine Fabia, mais Fabia ne l’a jamais chantée sur scène. Lope ne dit ni oui ni non, il ne sait pas.
J.T. : Francisco Rico dit que toute la pièce est un flash-back.
LI. P. : On pourrait l’exprimer ainsi, mais Le flash-back n’existe pasau théâtre. Le théâtre, c’est l’art du présent, le passé est toujours du présent ou alors il n’existe pas, c’est une convention littéraire. Un spectateur du XVIIè siècle connaît le dénouement, comme un spectateur contemporain qui vient voir ROMÉO ET JULIETTE sait qu’ils vont mourir. Ce qui importe, c’est de raconter très bien l’anecdote.
Lorsque Zéno Bianu m’a remis les premières versions du texte français, il était fier et heureux des moments lyriques, il en avait compté vingt-huit. Par la suite, c’est dans les passages qu’il jugeait plus réalistes qu’il a apporté de nombreuses corrections. Lope a été accusé d’être un auteur réaliste par les critiques espagnols du XVIIIè, XIXè et même XX&è. Le réalisme n’avait pas une bonne presse. C’est vrai, il y a du quotidien, mais dans LE CHEVALIER D’OLMEDO, c’est un quotidien auquel on n’a jamais accès dans une pièce du XVIIE, on ne voit jamais un matador qui doute, qui souffre de mélancolie, qui meurt d’amour, c’est impensable. À cette époque, il y avait de nombreux scénographes italiens qui travaillaient en Espagne, on possède des descriptions précises des représentations à grand spectacle où la machinerie à l’italienne pouvait faire étalage de ses possibilités somptueuses. Lope renonce à tout l’apparat.
J.T. : À ce propos, le choix scénographique d’Ezio Frigerio pour le spectacle de la Cour d’Honneur (un vaste champ de blé) est assez singulier.
LI. P. : Le choix du décor est complètement irrationnel, c’est un choix de la mémoire sensible. J’ai fait mon premier voyage en Castille, lorsque j’étais au service militaire. La Castille est un endroit où personne ne va. Le pays est pourtant magnifique, un paysage de collines très douces, un plateau situé à quatre cents mètres d’altitude, les ciels sont d’une extraordinaire pureté. On a pris une route qui descendait, après une courbe, les paysans faisaient la moisson, il y avait de la poussière de blé, c’était en or, toute la Castille était dorée. Il y avait une lumière de cette couleur-là dans LE SACRE DU PRINTEMPS que Béjart a créé, une espèce d’explosion dorée, orangée. Il y avait quelque chose de sacré, de miraculeux, et rien de plus terrien pourtant que la tâche agricole qui était accomplie. La Castille sera toujours pour moi liée à cette image. Or, Le CHEVALIER D’OLMEDO est une pièce très très Castille, la Castille étant la vitrine de l’Espagne du XVIIR, le royaume qui unifie la péninsule et impose ses règles.
En même temps, il y a la Cour d’Honneur. Je suis persuadé que tout le monde arrive en se disant je ne devrais jouer avec rien. La magie de la Cour d’Honneur, c’est la magie de ses trois murs. On se dit qu’il faut y faire du théâtre. Impossible d’aller contre le mur, il est là plus fort que toi, plus beau que toi, avec toute l’histoire, la mémoire de Vilar et de tous les autres, avec une distribution de fenêtres magnifique et bizarre. Pour moi, il y a aussi le souvenir de tous les pèlerinages que j’ai faits à Avignon pour voir du théâtre. Je n’aime pas ni le plein air ni les plateaux trop grands. Alors on se dit qu’il faut donner aux acteurs un sol sur lequel marcher, un sol qui nourrit et impose des règles. Pour moi, c’est la Castille, un no man’s land, mais pas un no man’s land stérile, comme le no man’s land beckettien, lunaire, mais un no man’s land plein de vie, un champ de blé. Frigerio a essayé de mettre toute la Castille dans la Cour, avec, de plus, un jeu que je crois être le jeu de la pièce : il y a d’une part la dimension quotidienne, réaliste, d’autre part les deux groupes sculpturaux à l’avant-scène, avec leur envol lyrique, nous disent qu’on est au théâtre.
J.T. : On pourrait relever deux paradoxes induits par la scénographie, celui d’un décor exaltant la vitalité pour une pièce où il est question de mort, et celui de l’irruption de la nature là où les situations sont souvent vaudevillesques, liées aux entrées et sorties des personnages dans la maison.

LI. P. : LE CHEVALIER D’OLMEDO était une pièce conçue pour un espace concret, le corral, avecdes dimensions très précises, des conventions bien établies, un espace aussi significatif et aussi signifiant que celui du théâtre élisabéthain. On était arrivé à un mariage parfait entre la littérature dramatique, l’espace où les pièces étaient jouées, et la société qui remplissait cet espace. Un peu comme l’‘amphithéâtre grec, les théâtres bourgeois, rouge et or, du XIXè, ou les stades de football. Pour moi, les deux éléments qui s’opposent dans le décor de Frigerio, la théâtralité et le côté terre et réel, et l’idée des coulisses que j’évoquais tout à l’heure me servent à transposer la pièce à l’extérieur. Il y a un champ de blé, mais il y a aussi cette arène que Frigerio a ménagée au centre du plateau, là où toutes les lignes convergent, avec encore une fois cette dualité d’un lieu réel, où les épis seraient déjà fauchés, et d’un espace théâtral, un espace de jeu.
On ne peut pas parler de la mort en l’abordant par Le côté sombre. Ici, la mort est aussi banale qu’un coup de pistolet tiré dans le dos d’un homme. Cette pièce n’est pas un chemin de croix, ce n’est pas « mort et transfiguration du Chevalier d’Olmedo ». Le blé est plus qu’un symbole, il signifie la vie, ce n’est pas un hasard si le tableau le plus énergétique au monde est un champ de blé peint par Van Gogh. En même temps, on est au théâtre, les blés sont morts, une partie est déjà moissonnée, prête à être transformée en farine ou à ensemencer à nouveau la terre.
J.T. : LE CHEVALIER D’OLMEDO est une pièce « simple », une pièce de théâtre dans laquelle le théâtre n’est pas remis en question. Si l’on considère votre parcours artistique depuis EL PUBLICO et vos dernières mises en scène de García Lorca, Valle-Inclán ou même Genet, ce choix peut paraître étonnant.

LI. P. : Il est possible que le spectateur trouve cette pièce petite, simple, sans enjeu. J’éprouve aujourd’hui le désir de raconter une histoire qui ne soit pas cassée ni cubiste. Tout le XVIIè, que ce soit Shakespeare ou Lope, affectionne l’art du conteur. Ici, il y a une narrativité très puissante, la pièce ne se replie jamais sur elle-même. C’est un fait divers raconté en langage poétique. Dans LE CHEVALIER D’OLMEDO), il y a également tout un monde magique, un monde de questions sans réponse, qui me séduit beaucoup. Je ne sais pas si le côté irrationnel de la pièce peut poser des problèmes à un public préjugé rationnel comme le public français.
Je crois de moins en moins au théâtre comme langage universel, au public comme notion abstraite. Je veux m’adresser à des gens concrets. Ce qui m’importait le plus quand j’ai monté TIRANO BANDERAS par exemple, c’était l’accueil que le spectacle recevrait à Buenos Aires, parce qu’il avait été fait pour ce public. En France, le public est sensible à la qualité littéraire d’un texte. Pendant les représentations de LA VIE EST UN SONGE au Théâtre de l’‘Odéon, j’entendais de nombreuses personnes dire « quelle belle pièce ». Je ne suis pas certain que je monterais LE CHEVALIER D’OLMEDO aujourd’hui en Espagne, mais j’ai le désir de faire découvrir cette pièce au public français, parce que je sais que cela est possible ici et que Zéno Bianu m’a fait le cadeau d’une langue si belle.
LE CHEVALIER D’OLMEDO est une pièce qui me poursuit depuis des années. J’avais commencé à la répéter il y a longtemps. J’ai arrêté au bout de quinze jours, parce que j’essayais de m’élever jusqu’à Lope et que je n’y arrivais pas. Aujourd’hui, je crois que la chose est un peu moins impossible. Peut-être parce que j’ai moi-même éprouvé le goût de la mort, celui de la vie, la solitude et le sentiment d’être étranger.
J’ai l’impression que je dois retrouver une certaine pureté, après être passé par une expérience de destruction, de fragmentation, de découpage. Retrouver le goût du théâtre tel qu’il est. Or, si les pièces du XVIIè espagnol sont quelque chose, ce sont des pièces de théâtre. J’ai perdu la pureté à 36 ans, lorsque j’ai monté EL PUBLICO de Garcia Lorca. Tout s’est cassé à ce moment-là. Une sorte de descente aux enfers. Avant, j’étais passé par la vie et par le théâtre avec une facilité si grande. Beaucoup de gens disent que mon meilleur spectacle a été LES TROIS SŒURS de Tchekhov. Or, j’avais le sentiment que la découverte de Tchekhov était si facile, comme celle de Büchner, de Shakespeare, de Brecht, de Goldoni ou de Sophocle. La phrase de Picasso, « je ne cherche pas, je trouve », j’aurais pu l’appliquer, toutes proportions gardées, à mon travail de metteur en scène. Je crois que j’ai eu la chance de connaître deux grands moments de théâtre, de théâtre dans son rapport avec le public. J’ai eu la complicité du public à l’époque du franquisme, et j’ai eu l’avidité du public, le besoin de communion, après cette époque. Ces deux moments privilégiés qu’offre parfois le théâtre font partie de mon histoire. Il y avait la possibilité de construire quelque chose de très nécessaire, comme l’ont fait, avec cette différence qu’ils partaient d’une tradition non détruite, le Piccolo à Milan, la Schaubühne à Berlin, le TNP de Jean Vilar ou le Théâtre de Nanterre-Amandiers. Le Théâtre Lliure de Barcelone et le Centre Dramatique National de Madrid ont été cela.
Après trois années de Théâtre National, j’ai senti que tout ce qu’on avait construit vacillait, la pureté des gens qui étaient arrivés au gouvernement était en train de disparaître, ils devenaient des politiques professionnels. Et puis j’ai rencontré EL PUBLICO de Garcia Lorca sur ma route, et EL PUBLICO m’a tordu le cou. Tout ce que j’ai vécu, je l’ai vécu avec et par le théâtre. Un être plus équilibré que moi, plus froid, plus rationnel aurait sans doute fait une halte sur son chemin. Si on voulait l’exprimer dans la terminologie du XIIè espagnol et de la prédestination, on pourrait dire que j’aurais dû mourir à 36 ans, plutôt que de monter EL PUBLICO. De fait, cela a été comme une mort. D’une part, le théâtre se trouvait mis en crise de l’intérieur, d’autre part et de façon plus vaste, je ressentais, comme un fait de civilisation, l’effritement de toutes les valeurs philosophiques et idéologiques, l’écroulement des systèmes de référence. Ma mise en scène de JULES CÉSAR était le reflet du spectacle que je voyais autour de moi. Depuis, il y a eu ce contact permanent avec la mort, en moi, tout près de moi, et même dans la société. Je crois que depuis quatre ou cinq ans quelque chose s’est paralysé. Je n’ai éprouvé aucun divorce entre ce que je ressentais en moi et ce que je voyais au dehors.
EL PUBLICO puis PIÈCE SANS TITRE, m’ont amené à un certain discours sur le théâtre, ou plutôt sur la question de la représentation au théâtre, quelque chose qui a enflé jusqu’au BALCON et a explosé dans TIRANO BANDERAS. Aujourd’hui, je ne dis pas que cette préoccupation est totalement évacuée, je me pose en tout cas moins de questions. J’ai l’impression que je peux rêver maintenant d’aller plus haut, je peux rêver d’utopie, parce que je ne flotte pas, j’ai les pieds dans la boue, on me les a mis. J’ai une foi totale dans LE CHEVALIER D’OLMEDO. Le choix de cette pièce est totalement libre, il n’est attaché à aucun discours, à aucune stratégie, c’est une façon de ne pas devenir grave moi non plus, de ne pas trop me prendre au sérieux, une tentative de renaître à une certaine pureté, le simple désir de dire aux spectateurs « regardez comme c’est beau ».
Propos recueillis par Jean. B. Torrent.