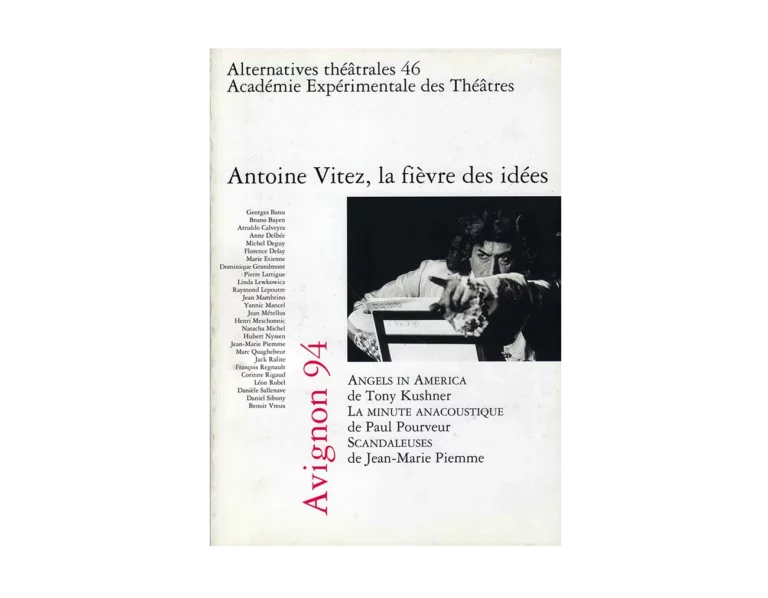JE SAIS maintenant ce que Mécène veut dire. J’ai regardé dans le dictionnaire. Le mot se trouve évidemment aux environs de «(être de) mèche » et de « médaille ». Mais Mécène, cet homme d’État romain… ministre d’Auguste….. issu de rois étrusques (ah ça, peut-être)… qui aida Octave à conquérir le pouvoir et à rallier au nouveau régime les hésitants, dont simplement la maison était ouverte à tous, à Virgile, à Horace, à Varius, franchement pourquoi a‑t-il laissé une telle trace dans l’histoire de l’ingratitude ? Ou est-ce un tour de celle-ci qu’un ministre de la propagande soit devenu synonyme d’ami des arts et de protecteur, généralement bréhaigne, des créateurs ? Fin de la notice et fin de l’idée que j’avais d’intituler ce texte « Antoine Vitez, le mécène ».
Dire alors « Vitez le grand protecteur » ? Pas davantage ; vous ou moi ne sommes pas à ce point des filles de joie. Mais Antoine Vitez protégea, il aida, appuya, des gens qui n’étaient ni de ses amis ni d’une clientèle. Comment nommer cela ? Protection éloignée ?En ce que dans le but d’aucun rapprochement, ne forgeant ainsi aucun reconnaissant ? Ou encore une fois Mécène er désintéressé ? Mais Vitez ne donna pas d’une main tandis que l’autre agitait un gant vide de toute création. Il y a ceux qui ne font rien, passons sur ces joueurs de tambour du soi.
Il y a ceux qui font pour les autres parce qu’ils ne peuvent faire pour eux-mêmes, les doux stériles amateurs de fertilité. Ce n’est pas le cas. Il y a ceux qui font pour les autres pour faire pour eux-mêmes, fabriquants de clientèle, voyeurs de l’invisible lequel ils n’atteindront jamais. C’est encore moins le cas. Vitez est un exemple plus singulier et je crains bien que le moule en soit perdu avec lui. Il fit faire à d’autres, non ce qu’il aurait voulu faire, non ce qu’il faisait, mais ce que ceux-ci se proposaient de faire. Antoine Vitez était un grand créateur et cela ne l’’empêchait pas de désirer que d’autres le fussent aussi. Assemblage miraculeux qui accepte d’amalgamer son chiffre et qui, même s’il se sait unique, ne dénie pas qu’en existent plusieurs. Tout de même, comment appeler cet élan, cette décision qui poussait Antoine Vitez à se soucier ainsi d’autrui ? L’appeler « antoinevitez » en un seul mot et proposer au jaillissement de la langue un nouveau verbe ? Mais Antoine Vitez, en deux mots, n’était et de loin pas réductible à cela. Il éclaira le théâtre de nos idées et ne cesse pas, mort, de le faire.
Puisque ici je ne parle ni de son théâtre, ni de son art, ni de ses poèmes, mais de ce geste qu’il fit à jamais sien en ne se l’appropriant pas, Saint-Martin d’un autre genre divisant son manteau riche pour des riches d’espèce spéciale (démunis de possibles), je ne vois qu’une métaphore — cela n’étonnera pas le petit nombre qui me connaît — pour prendre dans son tamis inverse, c’est-à-dire qui lance vers le haut au lieu de trier vers le bas, ce que je veux dire. Antoine Vitez dans ce geste que je tente de transmettre et auquel le nom de mécène ou de protecteur ne conviennent pas suffisamment, conduisit quant à ce qui est des autres, de certains autres, le contraire de cette chasse qui laisse derrière elle des traces sanglantes jusqu’à l’endroit où a lieu la curée. Rapatriement jusqu’à une source qui n’est pas celle dont un fleuve part, mais celle d’où il repart. Croyez-moi, puisqu’ici je ne puis disposer de secrets qui ne sont pas les miens : Antoine Vitez appuya, prépara, accueillit, abrita, suscita, permit. Quoi ? À moi, d’écrire une pièce qui vint hélas trop tard, et tôt, qu’une traduction publiée à l’Arche de l’‘ANTIPHON de Djuna Barnes fut jouée à l’Odéon dans une mise en scène de Daniel Mesguisch. Rien d’autre, un service ? Pas exactement. Il me faut un peu ici entrer dans le détail.
Certes, je l’avais peut-être croisé petite fille puisque mon père André Michel, cinéaste, ne manquait pas de faire jouer Antoine dès qu’un rôle de curé, par exemple, lui en donnait l’occasion, comme il offrait à Jean-Marie Serreau le rôle d’employé aux écritures dans les ministères de Maupassant. C’était cette solidarité qui savait faire passer la foudre d’un grand acteur par le chas de l’aiguille d’un petit rôle pour que ni le pain ni le jeu ne manquât au grand acteur, par exemple au chômage. Puis, je devins grande et j’écrivis d’ailleurs instruite par le métier de mon père, où l’argent, le beaucoup d’argent est la seule baguette magique pour la métamorphose des images, qu’il valait mieux après tout, en vue de créer, ce maigre bagage de lumières : le papier et le crayon. Bref, j’écrivis, et un jour, d’un texte déjà existant, je veux dire l’ANTIPHON de Djuna Barnes. Vitez commença par aimer cette traduction — je ne peux ici parler que de moi —, mais cette dilection se changea en idée et cette idée en action et cette action en action. C’est de cette consécution entre un goût, un jugement, une action qui était propre à Antoine dont je parle.
Chacun de nous a mille exemples de la façon dont cette chaîne se rompt et dont on entend craquer jusqu’à dans sa membrure essentielle, se dissiper dans une extatique impuissance, la promesse — que Vitez ne faisait jamais —, l’éloge cette huile qui tourne au vinaigre, ou simplement la chose dite qui, quoi qu’elle ne soit pas jurée, est sur le champ parjurée-oubliée. Ne rien demander à personne peut être la conclusion tirée par un sujet et un stoïcisme plein d’honneur la conduite préférée dans un moment, je ne dis pas un monde, où la phrase « excusez-moi (si je parle de moi)» est la formule tombée le plus en désuétude. Or, Vitez demandait à beaucoup, mais dans le sens inverse, ce qui est une façon de respecter en chacun qu’il ne demande rien à personne. Cela, il Le fit pour moi et encore une fois pour beaucoup d’autres et lui disparu, disparaît l’éblouissant paradoxe du donateur comblé de dons.