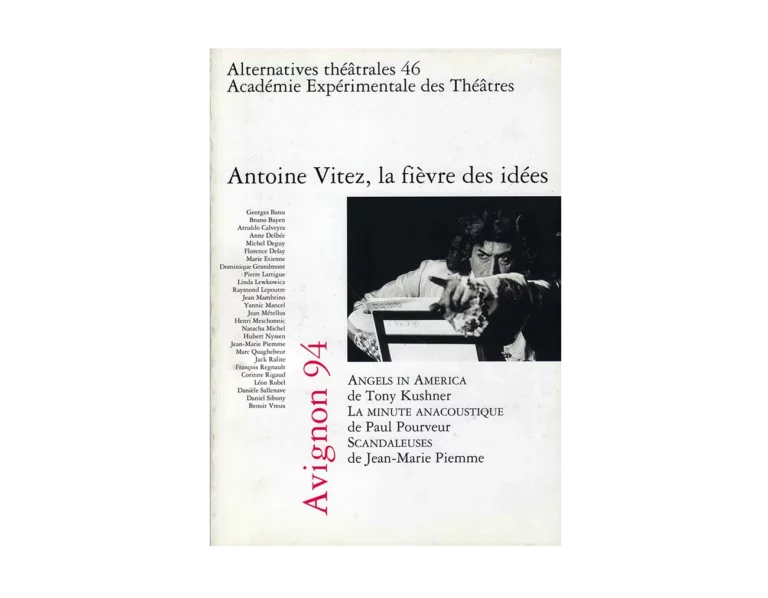LA GALERIE DES SOUVENIRS constitue déjà un théâtre, où celui qui parle croit voir l’autre, où le présent s’efface au profit d’un autre présent. Quoi de plus beau que ces miroirs dont l’alignement, décalé par l’usure, dénudé par le temps, ouvre aux écrivains restés seuls une perspective dans le langage ? Ceci pour planter le décor. L’illusion théâtrale est fille de la lucidité.
La disparition de nos aînés incite au témoignage, mais dans la difficulté de se constituer comme sujet — qui est en fin de compte le vrai sujet de la pièce — cette sorte de limpidité truquée de la mémoire ne nous est d’aucun secours, et au musée de cire de nos grands boulevards, toutes générations confondues, les Panoramas valent mieux qu’une histoire.
Écrire est une simple question d’espace (quand elle est résolue, Le silence aussi parle, et la lumière elle-même peut très bien servir de personnage). De sorte qu’entre Aragon et Ritsos tirant — l’un vers le roman, l’autre la poésie — Le théâtre qu’ils n’arrivaient pas à écrire, il fallait à celui qui est parti plus tard (et qui n’a fait aucun des trois — ou qui entendait faire les trois ensemble), il fallait à Antoine Vitez tout changer, même le lieu, la salle et jusqu’à l’éclairage.
Il fallait tirer les coulisses au centre de la scène, taureau de l’imaginaire dans l’arène. Il fallait travailler en amont de ces constructions-là et de ces genres, conscient que la véritable salle de spectacle, c’est l’œil — et que le théâtre est un renversement du nôtre — et donc que l’histoire des mots est celle, muette, du regard — façon par excellence de faire agir le rêve. En quoi, la position la plus intenable est celle de contemporain.
Dès lors, il ne s’agit plus de diriger l’acteur, mais bien de le former d’abord. Non plus de discuter tel mot d’ordre, mais de réfléchir en public à la constitution des symboles, à leur restructuration périodique ou permanente. Et pour cela, il faut sortir du monde en restant au cœur de lui. La scène est cette étymologie mise en actes. Théâtre en grec désigne aussi bien l’endroit que l’institution, les gestes qu’on y fait que les gens qui viennent les voir. L’événement ne commence en effet pas plus qu’il ne s’arrête à la seule représentation.
Encore une fois, l’ombre passe et le mur reste. Il résiste à l’élucidation qu’un soir ou d’autres il a permise. Loges vides, portes refermées — malgré les applaudissements victorieux de la mode. Une nuit où une fabrique de meubles avait brûlé dans la banlieue sud de Paris, j’étais descendu dans la rue, attiré par le ciel rouge et persuadé, au vu de la direction du sinistre, qu’on avait mis le feu au siège du journall’Humanité. Je ne sais pas si Antoine Vitez sortait du Conservatoire ou rentrait chez lui, mais j’étais dans l’état sans doute idéal du spectateur égaré. Mon erreur eut le don de l’amuser beaucoup.
Je ne sais plus de quoi nous avons parlé, mais sûrement de la scène et de son aptitude à déthéâtraliser la politique de cette délégation de pensée faite par le spectateur — qui confie à des personnages tangibles la mission devant lui d’explorer un double langage. Le drame était aussi dans le rideau qui toujours retombe sur ces réalités premières, et que l’acteur prend sur lui sans les avoir inventées.
D’où la nécessité de l’implication sociale d’un théâtre moderne, et cette exigence du plus haut niveau pour le plus grand nombre. Attitude radicale que celle de constituer un sens sous les mots travestis qui l’amènent jusqu’à nous. Il en va de l’émergence toujours recommencée des idées. Il en va de ce crime commis en commun qui — comme le disaient déjà les Alexandrins — fonde la civilisation et trace dans nos esprits parfois enflammés, par une sorte de compensation séculaire, l’enceinte morale de la cité nouvelle.
C’est cela que je voulais dire au travers d’une rencontre imprévue, un peu en infraction par rapport à nos équations personnelles, puisque la solitude de l’artiste ne se résout que dans l’œuvre — et que cette œuvre ne s’adresse pas à quelqu’un, pas même à un ami rencontré dans la rue, mais à tous en particulier. Ce que les tragédiens démontrent, c’est que le pouvoir est l’échec de l’amour — ou que le pouvoir n’appartient qu’à ceux qui le donnent.
Il en va de la République, à moins de gouverner le désir au rythme des repas, et de penser avec son ventre — comme on le fait très bien dans les publicités télévisées. Le théâtre est couleur du sang, qu’on l’ait racheté ou perdu dans une intrigue ou dans une autre. Il est couleur de la naissance, secret génétique de la poésie. Cela, Antoine Vitez le sait. Pourquoi dès lors se cramponner à un fauteuil, quand on a pour soi le nomadisme du tréteau, l’influence à distance et le masque émacié, mais généreux, de la pudeur ?
C’est que vu de tous, on est hors d’atteinte — loin des sympathies démagogiques. Le théâtre, c’est pleurer de la glycérine naturelle. La textualité nous remplace. Ici, l’acteur est muet, même quand il parle. Le geste est un modèle de formation du temps. Le rituel de l’intimité n’est-il pas le plus vrai des rôles ? Pour un témoin pareil, les coulisses n’existent plus, la liturgie est totale. Plus de marge, le masque est devenu visage. L’attitude neutre. La discipline est dans cette coïncidence entre la vie qu’on dit publique et le secret. Ou, pour dire cela autrement : son cœur est celui du paradoxe. À ce moment, le nôtre bat. Et vivre consiste à bien cerner cette énigme pour finir qu’il nous livre intacte.
C’EST avec beaucoup d'émotion et de respect, mais aussi de timidité et de fierté que je suis entré en relation…