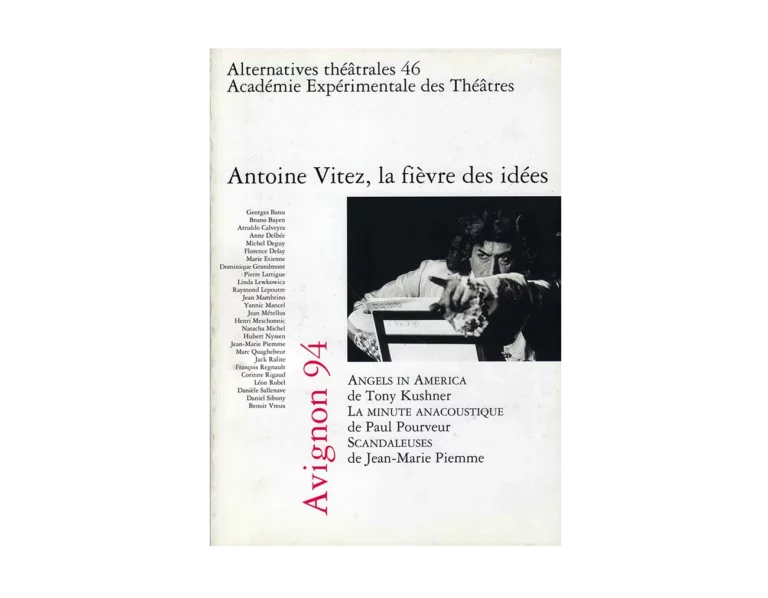IL PARLAIT toujours de littérature lorsque nous nous rencontrions.
La traduction en français des poèmes de Guido Gezelle fit ainsi partie des évocations de ses dernières années. Chez les francophones de Belgique découverts à travers nos rencontres des années quatre-vingts, Baillon l’avait frappé. Par sa langue essentiellement, m’a-t-il semblé.
Il m’avait fait découvrir Aigui auquel il me fit remettre un message. C’était à l’occasion d’un voyage que j’effectuais à Moscou, au sein d’une délégation officielle. Je le fis à travers les circuits qui étaient de rigueur dans la capitale soviétique pour un poète plus que marginal. Je n’ai jamais su si le billet était arrivé à bon port.
De Maeterlinck ou de Kalisky, nous ne parlions pas uniquement en termes de représentation. Mais de langue et d’imaginaire. Toujours, ses paroles étaient vives et fragmentaires. Elles s’interrompaient comme pour mieux rebondir et pour laisser en suspens la résonance de la trouvaille. En quoi il avait bien à voir avec la poésie.
D’elle nous parlions bien sûr. Tout d’abord, lors de nos premiers échanges, autour et à partir de mes textes dont il aimait « la douloureuse concentration ». Il en appréciait « la forme vocale — insolite pour le haïkaï » et y entendait « l’écho du Ou CHARLEROI de l’autre », Il me fit la joie de les lire un soir à Chaillot alors que ma colonne vertébrale m’empêchait presque de marcher. Henry Bauchau vint à cette lecture qui fut décisive dans l’évolution de nos rapports. Je n’eus malheureusement pas l’occasion de les faire plus tard se rencontrer vraiment.
Antoine évoqua aussi les diverses phases de sa vie active — ses grands cycles — en m’invitant à rompre un jour le cercle maléfique de mes fonctions pour entrer dans une nouvelle peau. Comme lui-même l’avait fait jadis, précisa-t-il. Et comme il avait envie de le faire en s’écartai quelque peu du théâtre pour se donner plus à Moue peu du theatre pour se donner plus a la littérature. C’est alors qu’il me parla de ses textes ; et qu’il évoqua des bribes de son enfance.
Puis une après-midi — c’était dans le salon grège de son bureau de Chaillot -, il me parla de «(s)on poème infini », qu’il m’envoya par la suite. Il m’avait demandé de bien vouloir lui dire ce qu’il m’en semblait.
Je préfère en laisser entendre l’exergue, qui dit tout : « Soleil après grêle, étangs noirs couverts de mousse d’eau, dans le pays de ton père, et le regard au loin de l’homme, encore, des champs, retourné sur toi, la voix d’une femme à côté, l’odeur du pain transporté ».
ANTOINE VITEZ écrit d’une vie intraduisible en mot, et ses mots pourtant reviennent d’une mort intraduisible, «je n’ajouterai pas d’autres…