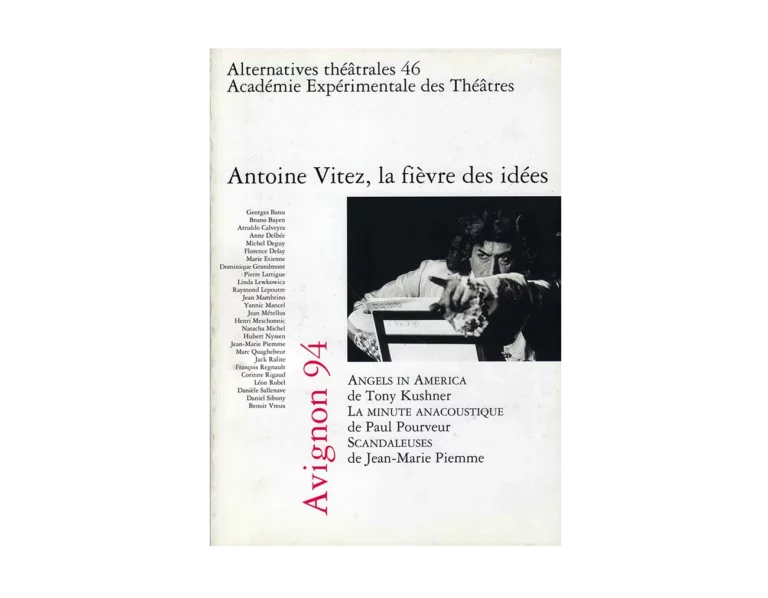AU MOIS de décembre 1965, Le Monde écrit le nom d’Antoine Vitez avec deux t. Une coquille. Mais les coupures de presse, Les lettres retrouvées rappellent qu’il était presque un inconnu. L’ai-je croisé au Old Navy, à la table d’Adamov?… Garelli, Liberati, Regnaut, Roubaud, Vargaftig et moimême, préparions avec l’aide d’Aragon une soirée que le journal présentait comme « tentative de réagir contre une désaffection de la poésie ». Maurice Regnaut fit appel alors à Antoine Vitez et je l’entendis pour la première fois au Théâtre Récamier, le 14 décembre, lisant des proses difficiles de Jacques Garelli avec une retenue qui éliminait tout effet de sens si bien qu’une comédienne de renom trouva terne sa façon de faire. Je n’étais pas d’accord. Et à relire ces poèmes aujourd’hui j’entends encore le timbre de la voix qui énonçait les paroles obscures :
«Moi par exemple, je suis cassant comme l’eau prise en glace sous la peau et qui pique. J’ai mes amours : les peignes. Et vous les sages, mes brosses, mes ciseaux, je vous aime rouillés jusqu’en vos plus humbles usages ».
Pendant plusieurs années, revenant d’Afrique ou de New-York, Garelli demanda des nouvelles de l’ami qui faisait du théâtre jusqu’à ce que nous nous retrouvions côte à côte à Chaillot pour l’intégrale du SOULIER DE SATIN, spectateurs d’une autre violence que Vitez orchestra magistralement. Il s’agissait de poésie encore.
Plus que de son ouverture au monde, je voudrais parler de ce qui l’attache à ce que les troubadours nomment le trobar clus, l’art fermé du poème où comme nulle part s’entend la langue. Il en avait l’exigence dans un rapport personnel avec l’écriture et une façon de lire. On se souvient du soir, où, en compagnie d’Alain Badiou, il évoqua Mallarmé. Si cela semble contradictoire il faut comprendre que cette contradiction est à la source de son art : élitaire pour tous.
Les deux écrivains qu’il a le mieux servis furent eux-mêmes habités de contradictions étouffées et flagrantes. Je pense à Claudel et Aragon. Il aima ces blocs.
Le nom d’Aragon est un masque illisible alors que dans Claudel il y a la clôture, la claudication d’un vers qui cherche où poser le pied et cette aile du « l » accrochée à l’épaule. Chez Aragon, chez Claudel, une même violence d’homme pris au piège. Et un recours : le chant. Car il faut que ça chante ! Pas moyen de faire autrement. L’énergie du drame contenu monte à travers les mots avec des noirceurs qui préparent l’éclair. Antoine Vitez sut faire résonner et rouler merveilleusement le bruit de tout cela.
J’ai beaucoup aimé la table dressée pour CATHERINE dans une ancienne église d’Avignon et ce repas, une sorte de Cène. Les phrases des CLOCHES DE BALE passaient de main en main, de bouche en bouche et s’envolaient, claquaient au-dessus de nos têtes. Catherine Simonidzé avait une voix de tourterelle géorgienne et ce fut un miracle, la musique naissant du livre, à plusieurs, déchiré.
Le nom de Vitez en Serbe désigne celui qui accomplit des prouesses. CATHERINE, LE SOULIER DE SATIN sont des sortes d’exploits.
On sait l’attention qu’il apporta au vers, son souci de n’en rien escamoter mettant la musique au-dessus de la référence à dieu sait quel naturel. On ne peut dire l’alexandrin comme on demande à table une salière ! Il s’en expliqua au cercle Polivanov. Il travaillait à cela tous les jours.
À la fin de son premier spectacle à Chaillot, je le revois venir les mains vides vers nous qui buvions un verre. Ravi de se trouver au cœur d’un grand théâtre, il semblait jouer son propre personnage résumant tout par un alexandrin :
« Je ne demandais rien que cet enfermement ».
« Je suis contente d’être si bien gardée — murmure Doña Prouheze — j’ai vérifié toutes les sorties. Il n’y a pas moyen d’échapper quand je le voudrais. Quel bonheur !».
« Et cependant — reprend Doña Musique — je suis entrée sans nulle permission ».