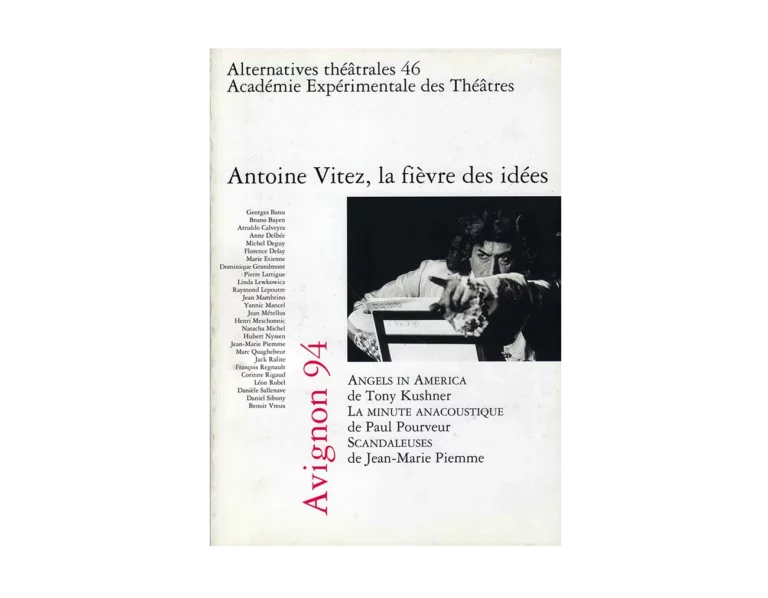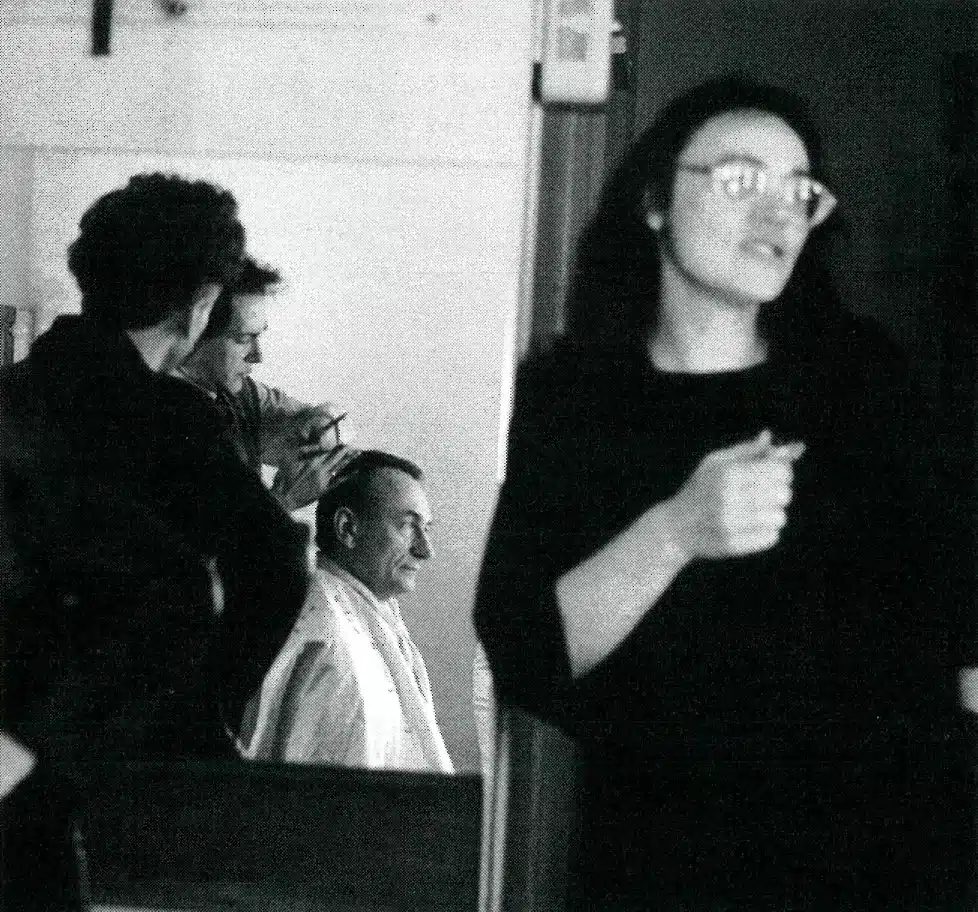
LA DERNIERE FOIS, dans les couloirs de l’Odéon. J’ai sa diction dans l’oreille, et sur l’étagère à « flacons » de mémoire dont parle Proust (dont ce souvenir même, réduit à une allusion de citation, banalise trop la « métaphore »), elle est rangée à proximité de celle de Vilar, comme leur visage étroit. Oiseaux de proue ; victoires.
Sa passion de traduire ; ses traductions du grec, du russe… Sa réflexion sur « traduire » — en relation peut-être avec une des significations de ce verbe, de si longue et si lourde carrière, quand « traduire », pour des générations de comédiens, acteurs, « interprètes », voulait dire, veut encore dire, « exprimer ». De sorte que la pratique et la théorie de la traduction font une critique de cette croyance occidentale en l’expression. Exprimer, expression (s), expressivité, expressionnisme… cette superstition, cette idolâtrie, ce « cratyléisme » de la psychologie littéraire et du Conservatoire, cet « étymologisme » d’un naturel bâti en dedans/dehors, être/paraître.. etc., demandent à être sans cesse « déconstruits », comme on dit partout aujourd’hui (à la manière du livre de Genette), pour en inquiéter les postulats, en déplacer l’économie générale, en ébranler le dualisme (intérieur/extérieur), en moquer la crédulité, la disloquer à défaut de la faire disparaître. On se rappelle comment Artaud avait rouvert les chemins de Bali, du Japon, du Mexique …
Une rencontre aux Quartiers d’Ivry, où je crois bien qu’il n’y avait que « nous » — Antoine avec un ou deux du théâtre, et les faiseurs de Po&sie : dans l’absence de public. Mais il croyait en nos possibilités. Je publie LE GRAND EXTÉRIEUR dans la revue1.
Un soir nous dînons sous Chaillot, sur le quai, l’autre Seine, près de l’Alma, dans un de ses restaurants de travail. Il y avait fait demande à des écrivains sans œuvre de théâtre de lui confier des pages, quelles qu’elles fussent, de les lui « montrer », pour qu’il en « fasse quelque chose à la scène », soit d’exercice avec la troupe, soit pour un futur spectacle. Même les pages que nous autres, gens à plume sans intrigue ni personnages, eussions tenues pour étrangères à toute mise en scène, vaines ou manquées, cela l’intéressait, recelant, croyait-il, sinon du représentable, du moins du présentable, de la matière à travail d’exhibition. Finalement je n’eus pas l’occasion de lui soumettre telles pages. Je le déplore.
Son infatigabilité, son audace (jusqu’à la nudité, surprenante dans le FAUST : indivision de risque, de générosité, de sacrifice, d’intrépidité, de narcissisme).

La façon des E « féminins » à la rime dans ses fameux « Molière », sobres, ascétiques, réduits (au sens phénoménologique des conditions de l’apparaître) à ces corps volubiles et retenus, danseurs de bouche entourant l’alexandrin comme des lanceurs de flamme ; cet E, ce nombre qui compte & ne compte pas, eût dit Claudel, en diérèse si j’ose dire, quelque part entre l’élision et l’allongement. Une merveille.
Si j’avais été chef de la télé, ou ministre ou quelque chose de ce genre, je lui aurais fait une commande : comme à l’époque les Anglais avaient su filmer tout Shakespeare, lui, Vitez, il aurait dû tourner tout Molière, intégralement, et on aurait eu tout Molière à la TV, sur la chaîne publique, tous les samedis après-midi.
- Po&sie n° 10 (1979) ↩︎