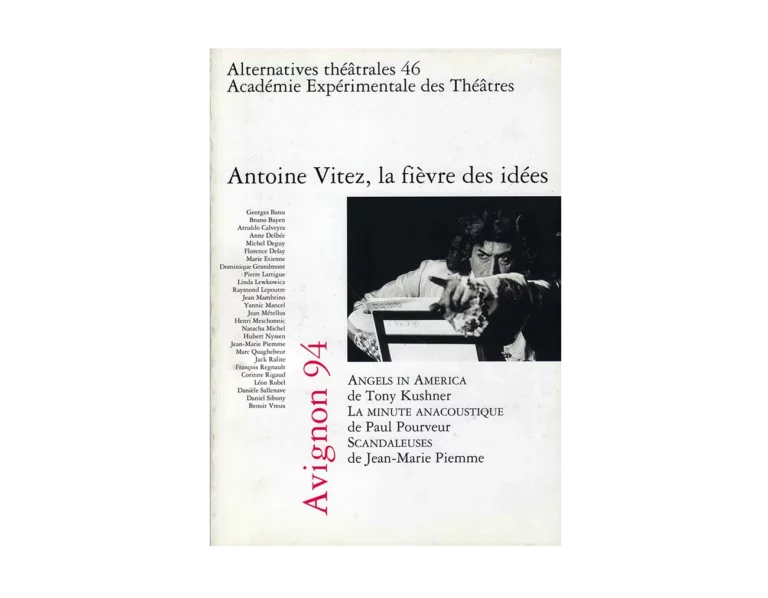LA MÉMOIRE nous donne le fil, et c’est la mémoire qui nous injecte la peur de Le perdre. Dès qu’elle s’active, elle distrait ; en même temps qu’elle s’active, elle nous avertit que nous risquons de perdre le centre. D’abord, rien qu’une distraction légère dans le fil du discours et de l’action, puis, les années passant, une hypocondrie. La mémoire devient vœu d’amnésie pour garder la mire en vue en même temps qu’elle devient peur de perdre la mémoire, et la peur de perdre la mémoire se crispe en peur de perdre la mémoire de son texte. Comme si nous étions tous des acteurs. La peur de perdre de vue la mire centrale qui serait occultée par la mémoire, et la peur de perdre toute la mémoire, tous ses égarements, toutes ses aberrations ; entre les deux, obligation nous est faite à chaque instant de choisir. Vitez était un homme de mémoire, usant de la mémoire comme stratégie. Si l’on appelle stratégie cet art surréaliste au moment décisif, au sommet du plateau, dans la fumée du mouvement des troupes, de ne pas se souvenir d’une configuration semblable survenue dans l’histoire des batailles mais, par exemple, d’une nuit d’amour grotesque, d’où étrangement résultera la victoire future. Vitez était un homme de mémoire, usant de l’hypocondrie comme mémoire. Un jour, mémoire de la main droite, un jour mémoire des dents, un jour, mémoire du coude, une mémoire qui n’existait qu’en symptômes, pour ne citer que trois déboires physiques, qu’il racontait sans frein. Au théâtre, il a, durant dix ans, combattu la technique au nom de la tactique, au nom de la dissidence : du dehors, proposant un théâtre en contrepoint, usant de figures de rapprochement, plutôt que de métaphores, — le vieux Faust s’éclipsant au profit du jeune sous le masque et dans le costume du héros de LA MORT À VENISE, hors sujet, un théâtre d’énigmes. Ce fut sa façon de piloter l’autre théâtre, à côté de l’institution. Contrepoint de l’autre théâtre, de la technique majeure de Chéreau ou de Strehler. Son deuxième spectacle, LES BAINS, était accueilli au Théâtre de Sartrouville, en 67, quand Chéreau le dirigeait. Pascal Ortega était l’administrateur de Sartrouville à cette époque. Un homme qui a tout fait, comme Vitez. Je me demande les professions qui furent inscrites sur les passeports successifs de Vitez. Je Le vois qui hésite et tambourine quand, derrière la vitre, l’employée de la mairie lui pose la question. Qui plus est, il avait la tête d’un homme qui n’a pas perdu ses papiers qu’une seule fois. Pascal Ortega est mort, il y a six jours. Les journaux n’en ont pas parlé. C’était un immense artisan de spectacle : il a été administrateur et assistant de théâtre, directeur de production et réalisateur au cinéma. Ses projets personnels ont souffert de sa générosité pour les autres. Ses deux films n’ont pas eu le succès qu’il attendait. Les grands techniciens de ces années-là, comme Pascal Ortega, ont été les maîtres qui ont permis le « tout est possible » qu’on a cru voir, un moment, sur les scènes, comme, d’un autre point de vue, en contrepoint de ce théâtre des images, ces années-là, Vitez a été un maître en révélant, sur le jeu, aux acteurs que tout était possible, géographiquement possible, parce que l’interprétation n’est qu’un point de tangence entre la ligne que suit l’acteur et le cercle du rôle, et parce que le jeu — la ligne — lui-même est hors sujet. Vitez a écrit qu’il faudrait entre les gens de spectacle un peu moins de confraternité et un peu plus de fraternité. Je me souviens de Pascal Ortega, premier assistant sur le MASSACRE À PARIS, mis en scène par Chéreau. Les répétitions étaient interdites à tout œil extérieur. Je m’étais planqué derrière des fauteuils. Il m’a vu. Nous avons échangé un regard. J’étais passablement ridicule, et il m’a laissé tranquille dans mon coin. Nous ne nous connaissions pas. Il s’amusait. Partout où je l’ai vu ensuite, j’ai revu un visage fraternel, et j’étais heureux pour ceux dont il s’occupait. Pascal Ortega manifestait avec douceur, efficacité, puissance que tout est plus important que le spectacle, et que nous faisons des spectacles le plus sérieusement du monde. Cette allure était la sienne. C’était la sagesse de Vitez aussi, tant qu’il a cru jusqu’au bout des ongles, que le théâtre imitait l’activité des membres du clergé régulier. Je rentrais chez moi pour écrire un texte sur Vitez hors du théâtre, quand j’ai appris la mort de Pascal Ortega, et, au moment où je rentrais, la fenêtre d’une maison voisine a volé en éclats. Agir sur le théâtre du dehors, comme un simple spectateur, ou comme un exilé, et comme un exilé qui entre, un soir, dans une ville étrangère, pénètre dans un théâtre pour voir un spectacle dont il rêverait qu’il soit celui qu’il a rêvé dans son oreille, c’était, pour Vitez, raviver la mémoire. Celle qui fait le bruit du torrent. Un chant matériel sans habitude. Si la mémoire est inlassable.
SON ATTENTION se faisait flottante, son regard, qui suivait votre pensée dans vos yeux, soudain dérapait, glissait sur votre front…