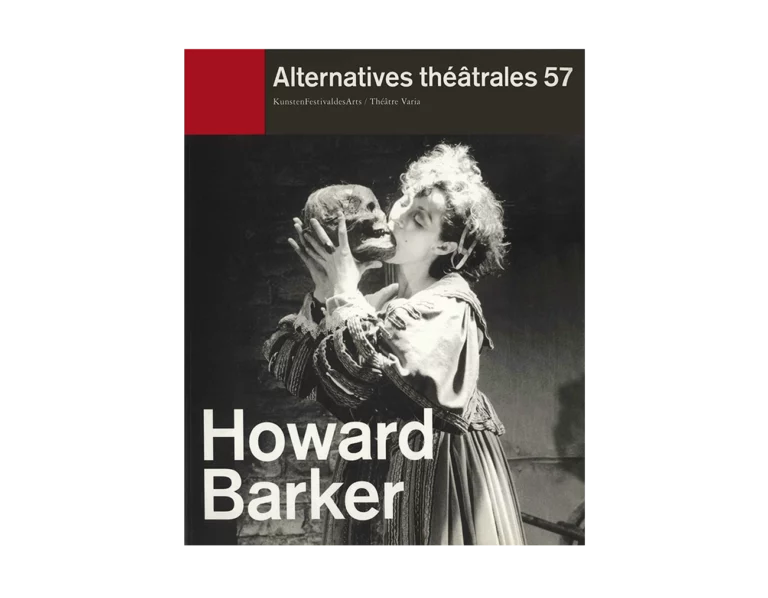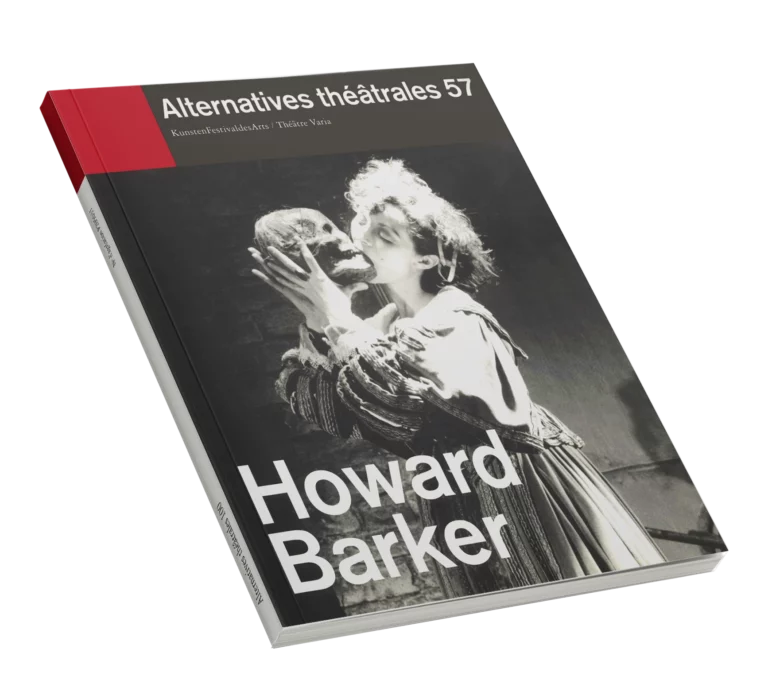AU FUR ET À MESURE que croissent succès public et popularité médiatique, Jérôme Deschamps et sa compagnie subissent dans leur pays, de la part des « décideurs » — programmateurs, critiques dramatiques et autres évaluateurs professionnels — une désaffection inversement proportionnelle à l’adulation (parfois excessive) brusquement montée en graine au début des années 80, c’est-à-dire encre LA FAMILLE DESCHIENS au Théâtre des Quartiers d’Ivry (1979) et LA VEILLÉE au TNP de Villeurbanne (1985). Auraient-ils donc, dans ce dernier spectacle, commis un crime de lèse protecteur en s’attaquant à l’image sacrée de l’animateur socio-culcurel ? Ou bien se seraient-ils rendus coupables, après ces quelques succès confidentiels réservés aux abonnés du service public, d’élargir leur audience en inaugurant avec C’EST DIMANCHE une nouvelle chaîne culturelle de télévision (« la Sept sur FR 3 », en mai 1987), de se voir attribuer le Molière du meilleur spectacle musical en 1988 pour LES PETITS PAS, ou pire encore d’avoir osé réaliser avec succès sur Canal+, à une grande heure d’écoute, un sketch quotidien connu sous le titre générique — ô sacrilège — de ce même spectacle (les DESCHIENS) reconnu jadis par le premier quarteron d’aficionados aujourd’hui déçus et méprisants ?
Médiatisation excessive, diront simplement les plus élitistes parmi les puritains. Ces détracteurs zélés, adeptes inconditionnels du service public et de sa mythologie, auront probablement oublié qu’au moment où Jean Vilar décida de les coopter sur les scènes du Palais des Papes et de Chaillot, Maria Casarès et Gérard Philipe étaient de grandes vedettes du cinéma populaire, et que lorsque le spectateur du TNP s’émouvait des malheurs de Rodrigue et de Lorenzo, c’est aussi Fanfan la Tulipe et le jeune François du DIABLE AU CORPS que son cœur applau dissait… Compromission avec des capitaux privés, diront d’autres — comme si seul l’argent public était propre et pur!… Ou encore, et peur-être plus grave : concession démagogique au rire gras de la France profonde. Il est vrai que la France bien pensante, oubliant avec pudeur que ses ancêtres étaient gaulois, n’en finit pas, depuis le XVIIème siècle, de régler des comptes avec le rire, sa « nature » et son « essence ». En dépit des efforts désespérés de quelques universitaires galvanisés par les travaux de Van Gennep, Bakhtine et Gaignebec, l’intelligentsia française reste dans son ensemble bien prudente et bien imperméable aux joies archaïques et primaires de la farce, du carnaval, et du grotesque. Héritière des diktats de Boileau qui déniait à Scapin le droit de figurer au même rang de dignité qu’Alceste, la pensée culturelle unique, juste-milieu, consensuelle et « politiquement correcte », tient toujours à distance l’improvisation scabreuse et son cortège aléatoire de lazzis, de mascarades, de bastonnades, d’injures, d’accidents langagiers et d’exaltation joyeuse du« bas matériel et corporel. » Le plus drôle, c’est qu’une celle pudibonderie laïque, aujourd’hui hégémonique dans les milieux culturels, rejoigne à l’égard de Jérôme Deschamps le discours de censure et d’excommunication récemment tenu par le Saint Siège à l’égard de Dario Fo, cet autre grand saltimbanque incorrect et inclassable, adoré du public populaire, toujours écartelé entre tréteau forain et petit écran.
« On n’admet pas volontiers, dit Jean-Loup Rivière, — et la remarque vaut aussi bien pour LES PRÉCIEUSES RIDICULES — qu’il y ait autant de pensée, autant de « philosophie » dans LE MARIAGE FORCÉ que dans LE MISANTHROPE » (CONVERSATIONS SUR « DOM JUAN » AVEC JACQUES LASSALLE, P.OL. 1994). Et pourtant tel est bien ici l’enjeu de notre propos : tenter de montrer qu’au-delà des jugements de valeur fondés sur la hiérarchie des genres et des publics, l’œuvre théâtrale de Jérôme Deschamps — à ce jour une perire vingtaine de spectacles réunis par un commun imaginaire aussi singulier que cohérent — relève non seulement d’un théâtre populaire au-dessus de tout soupçon démagogique, mais également d’un théâtre d’arc qui, en dépit de son laconisme et de sa prédominance visuelle, soit aussi, selon la belle formule d’Antoine Vitez, un théâtre « des idées ».
Enfances
D’une enfance catholique et bourgeoise passée à Neuilly sous le signe du scoucisme, il n’y a pas grand chose à dire, si ce n’est qu’elle est éclairée par deux personnalités déterminantes. Un oncle comédien, Hubert Deschamps, acteur dans la compagnie animée par Jean-Pierre Grenier et Olivier Hussenot, transmet à son neveu quelque chose de l’héritage artistique et moral de Léon Chancerel et des Comédiens Routiers, c’est-à-dire aussi, plus lointainement, de l’aventure bourguignonne de Jacques Copeau et de ses anciens élèves du Vieux Colombier. Quant à une cousine du côté maternel, elle a épousé un certain Jacques Tatischeff dit Jacques Tati, cinéaste issu du music hall, réformateur du cinéma comique français, observateur minutieux de la réalité quotidienne, inventeur, avec son Monsieur Hulot, d’un personnage d’hurluberlu naïf, et anticonformiste, écartelé comme le Charlot de Chaplin entre la plate banalité de l’homme ordinaire et une involontaire extravagance, riche de fantaisie poétique. Auteur de quelques rares longs métrages, le réalisateur de MON ONCLE, anticipant les lamentations des amateurs de renouveau permanent, confiera à son jeune cousin qu’un « artiste n’a que deux ou trois idées originales à apporter, le reste n’étant que variations. »
Les adolescences théâtrales de Jérôme Deschamps se poursuivent ensuite au lycée Louis-le-Grand, au sein du groupe théâtral animé par Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent, avec entre autres, en 1964, les représentations des SCÈNES POPULAIRES de Henry Monnier et du FUENTE OVEJUNA de Lope de Vega. Puis vient l’heure de la formation, avec L’École de la rue Blanche, puis le Conser vatoire National, promotion 1973 — celle de Jacques Villeret, Richard Berry, Patrice Kerbrat, Jean-François Balmer, ainsi que d’un certain Daniel Mesguich qui, cette année-là, dans le cadre des travaux d’élèves, dans un Conservatoire pédagogiquement rénové par les récentes nominations de Jacques Rosner, Antoine Vitez, Pierre Debauche et Marcel Bluwal, attribue à Jérôme Deschamps le rôle de l’arpenteur K. dans son adaptation du CHÂTEAU de Kafka.
Mais la rencontre déterminante, à cette époque, est sans aucun doute celle d’Antoine Vitez qui l’engage dès 1973 dans M = M (LES MINEURS SONT MAJEURS), une pièce de Xavier Pommeret écrite en hommage aux ouvriers grévistes massacrés à Fourmies le 1er mai 1891. Il le réengagera ensuire en 1976 pour le rôle de De Ciz dans PARTAGE DE MIDI de Claudel alors qu’il est pensionnaire à la Comédie-Française, puis l’année suivante, à Ivry, pour la création d’IPHIGÉNIE HÔTEL de Michel Vinaver.
Nourri au discours artistique et idéologique extrêmement exigeant d’Antoine Virez, Jérôme Deschamps pourra lui proposer pour Ivry — ainsi qu’à Jack Lang pour Chaillot (donc Vitez est alors le conseille artistique) — les esquisses balbutiantes de ses premières créations : BABOULlFICHE ET PAPAVOJNE (1973), duo de clowns beckettiens avec faux nez interprété de concert avec Jean-Claude Durand ; BLANCHE ALICATA (1977), monologue conçu comme une parodie de mélodrame, avec Dominique Valadié dans le rôle de la fille-mère éplorée ; et surtout LA FAMILLE DESCHIENS au Théâtre des Quartiers d’Ivry (1979), trio masculin où pour la première fois apparaissent le papier peint défraîchi, les blouses, les poussettes, l’outre à gros rouge, la purée sur le camping gaz, la musique d’André Roos (avant même l’accordéon de Michèle Guigon et les compositions à la fois populaires et savantes de Philippe Rouèche) et le nom de Macha Makeieff au générique du spectacle …