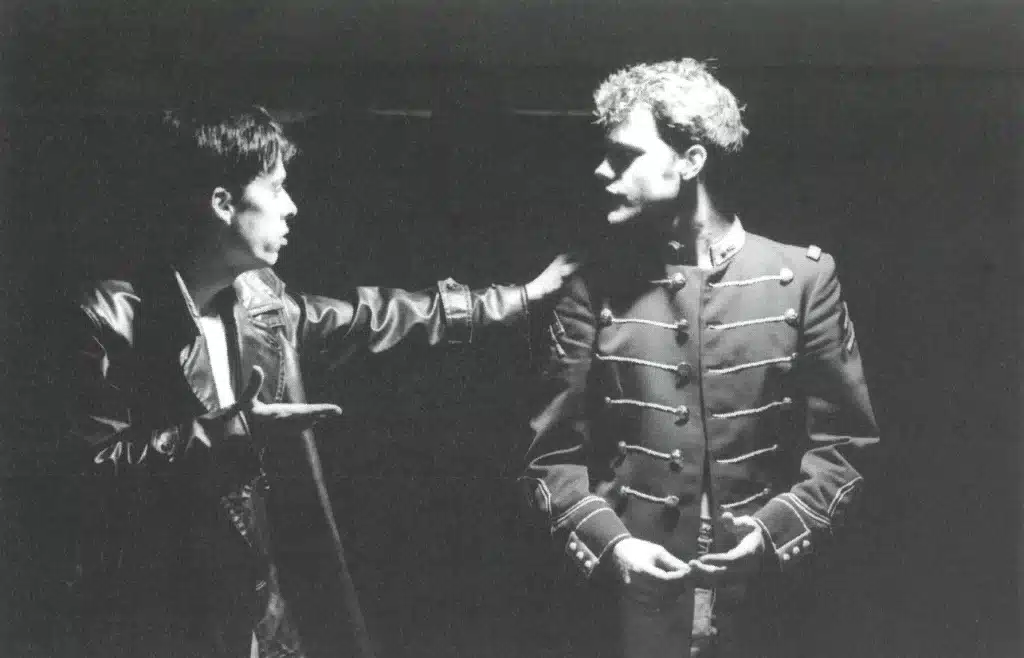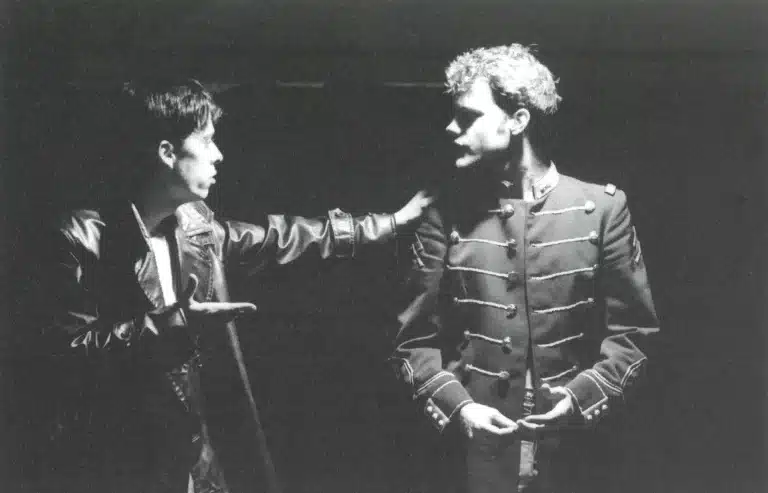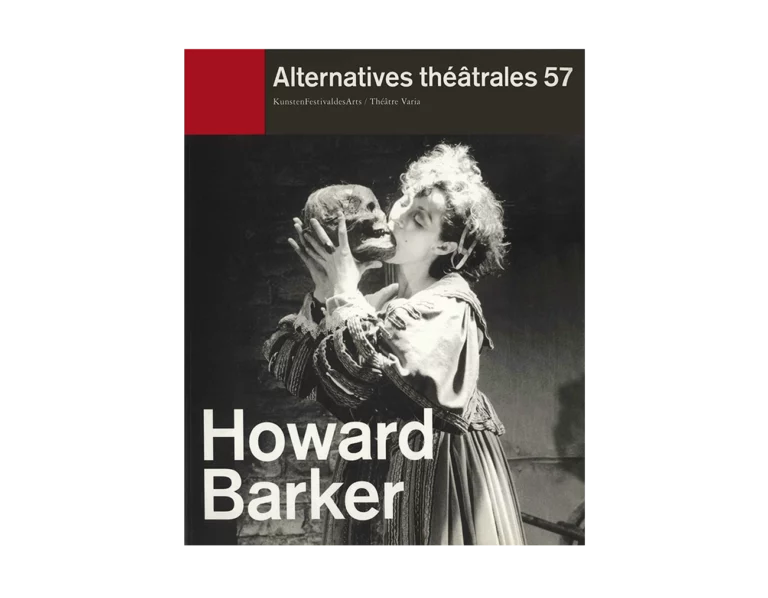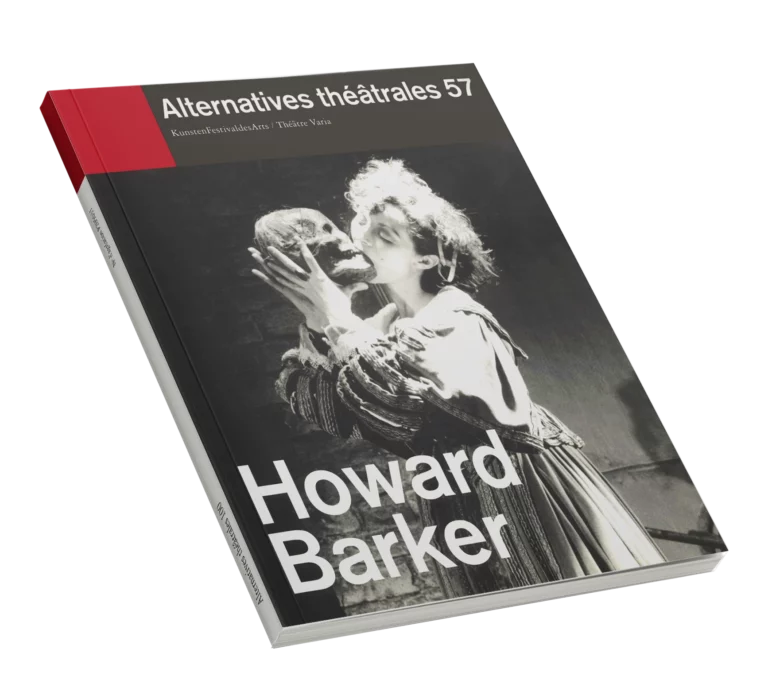MIKE SENS : Tu viens juste de démarrer les répétitions des EUROPÉENS avec ta compagnie Utopia pour la production au Théâtre Varia dans le cadre du Kunsten Festival des Arts à Bruxelles. Qu’est-ce qui t’as guidé dans ton travail dramaturgique durant cette première phase ?
Armel Roussel : Une phrase de Julia Kristéva : « Il y a dans l’abjection de ces violences et obscures révoltes de l’être contre ce qui le menace et qui lui paraît venir d’un dehors ou d’un dedans exorbitant, jeté à côté du possible. ( … )» En relisant la pièce m’est apparu soudainement son côté humain, alors que j’avais toujours vu d’abord son côté politique. Les personnages sont riches et complexes, et je me suis demandé ce qui pouvait les relier cous. Et ce pourrait être cette notion d’abjection. Ce sont cous des personnages abjects. Même chez les plus petits personnages, ceux que l’on ne voie qu’une scène. Et l’abjection est poussée jusqu’à un point de vue psychanalytique. On peut lire la pièce de manière politique uniquement, on peut aussi la lire en ne se concentrant que sur l’humain, et quand on la lit en imagi nant qu’elle a été écrite par un psychanalyste, ça marche aussi complètement. C’est très troublant.
M. S.: À partir de cette notion les personnages commencent à prendre corps ?
A. R.: Kristéva explique ce qu’est « l’abjection personnelle » ; et on pourrait l’appliquer à chacun des personnages et la développer, pour certains la menace semble venir du dedans, pour d’autres ce sera du dehors. L’abjection peut passer par le rejet de soi, le rejet de l’autre, de l’autre sexe, de l’origine, des parents.
L’abjection est une notion très importance pour LES EUROPÉENS, il s’agit de savoir quelle est la limite de leur condition de vivre. Quand Starhemberg va chez les miséreux et dit : « Je l’ai attrapé en flagrant délie, la gueule dans le bide du cadavre », c’est le sommet de l’abjection, c’est la confrontation à la mort identifiée qui est le contraire de la mort signifiée.
M. S.: Comment se passe le travail avec les comédiens ?
A. R.: Avant de travailler en équipe, je fais des rencontres individuelles avec les comédiens, je les vois deux ou trois fois chacun, et on discute uniquement de leur personnage. Chez Barker cout est tellement complexe, qu’il est impossible à la simple lecture de voir les parcours individuels. En faisant cela, il nous est apparu une cohérence totale du trajet des personnages. Une cohérence qui présuppose que les personnages ont continué à vivre dans leur temps d’absence sur scène. Quand les personnages reviennent, ils one vécu quelque chose pendant le laps de temps écoulé où ils n’étaient pas sur scène.
L’impératrice par exemple, je la voyais plus comme une reine de cartes qu’autre chose, et en faisane ce travail-là, on se rend compte que c’est un personnage important, peut-être même plus important que l’empereur Léopold, et on s’aperçoit qu’elle parle uniquement à Starhemberg ou de Starhemberg. Tout d’un coup on voit que cout se répond, une question posée trouve sa réponse cinquante pages plus loin, et coure la pièce est construire de cerce façon là.
M. S.: Serait-elle comme une caisse de résonance pour Starhemberg ?
A. R.: Par exemple, l’impératrice lors de sa dernière intervention dans la scène 3 du ler acte dit à Starhemberg : « Il faut inventer l’Européen mai menant, à partir des morceaux cassés. Coller la tête à l’utérus et ainsi de suite. » Et Starhemberg lui répond pendant la scène 8 : « Je veux fabriquer un nouvel homme et une nouvelle femme mais seulement à partir des morceaux de l’ancien modèle. Le nouvel homme et la nouvelle femme insisreraient sur leur nouveauté absolue. »
Et l’impératrice répond, comme s’il n’y avait pas eu cinq scènes entre les deux répliques : « Je ne pense pas, Starhemberg, que eu aies vraiment saisi le caractère de l’époque, vous ne trouvez pas) Je pense que l’Europe a besoin de rococo et d’un peu de jazz ! »
M. S.: Vertigineux !
A. R.: En ayant fait la totalité des parcours, la pièce ne nous semblait plus quelque chose d’obscur. Mon adaptation resserre la quantité de personnages, il n’y a que neuf comédiens, et ils ont tous des trajectoires forces. Il y a aussi une notion de destin très présence pour chacun d’entre eux. Après avoir fait ensemble une semaine de travail à la table, on a relu la pièce et, très étonnamment, ce qui nous avait semblé un chaos terrible qui devait durer trois heures, nous est apparu clair, fluide : un spectacle de deux heures. Comme si cet objet étranger était devenu nôtre.
M. S.: J’ai eu la même impression en traduisant la pièce. Il faut dü temps pour rentrer dans l’univers barkerien.
A. R.: Barker déroute parce qu’il brise les conventions. Et en même temps, il ne donne pas de réponses. Il insinue des choses et puis il casse ce qu’il vient d’insinuer. C’est donc une pièce de choix, c’est à dire : une pièce où il faut faire des choix à l’intérieur de sa structure même afin de pouvoir la mettre en plateau.
Sans ces choix, à mon avis, elle ne tient pas sur scène. Et c’est là que ça devient intéressant et délicat : il faut faire en sorte que les choix ne soient pas des réponses, il faut sauvegarder l’ambiguïté tout en choisissant. Par exemple encre Starhemberg et la vieille femme dont on ne sait pas si c’est sa mère véritable ou pas. On a décidé de dire que c’était sa vraie mère. Pourquoi cette confusion ?
Je suis intimement persuadé qu’il s’agit d’une relation d’inceste encre Starhemberg et sa mère. C’est clair quand l’impératrice entre et dit : « Madame, votre magnétisme a plus d’effet sur cet homme que toutes les cinq cents chambres du Kaiserhof. Je trouve que votre fils est un porc remarquable. » Je fais le choix de dire : il y a inceste, mais ce choix-là, je ne peux pas le montrer, parce que si je le montre, j’enlève. Ce qu’il faut, c’est que je le signifie. Quand l’impératrice entre, elle doit surprendre quelque chose, une relation, un rapport, une sensation, qui lui disent à elle tout de suite qu’il y a inceste, mais elle ne doit pas les surprendre en train de faire l’amour.
Propos recueillis à Bruxelles le 4 mars 1998 par Mike Sens, et retranscrits par Julie Birmant.