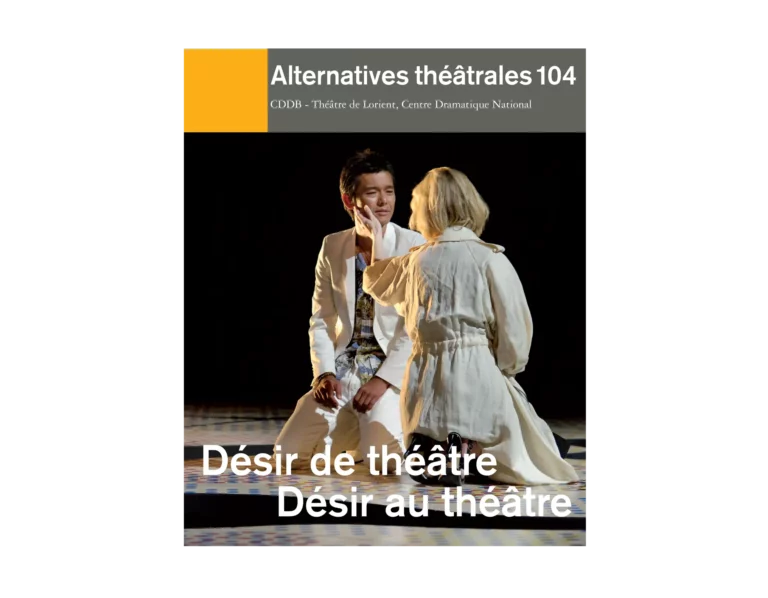LE THÉÂTRE d’Éric Vigner est conçu comme un miroitement kaléidoscopique des secrets inconscients et des projections fantasmatiques. C’est moins l’observation et la retranscription d’événements sociaux ou politiques qui inspirent les choix du metteur en scène que la nécessité d’explorer les territoires de l’intime. Depuis LA MAISON D’OS de Roland Dubillard1, jusqu’à SEXTETT de Rémi De Vos2, en passant par Duras, Racine, Molière, Corneille ou Genet, la scène bruisse d’histoires d’amour, se plaît à raconter l’attraction des corps, la volonté de rejoindre l’autre qui se dérobe, la vie aux prismes des désirs…
Cependant, les spectacles du metteur en scène parlent moins du désir qu’ils ne visent à le faire advenir par l’événement d’une représentation fondée sur les pouvoirs et le plaisir du texte. C’est aux mots qu’il faut prendre le théâtre d’Éric Vigner. Et c’est dans l’attention qu’il porte à ce que la lettre recèle à la fois d’énigmes et de sens, dans sa volonté de concentrer le travail sur l’exploration rigoureuse d’écritures originales, sur leur énonciation particulière qu’il convient de chercher comment la quête esthétique du metteur en scène s’articule autour de la question du désir.
Celui-ci intéresse la représentation moins comme thématique que par ses liens avec le verbe, moins dans les formes qu’il peut prendre que comme pulsion et processus, créateurs de la parole et, plus généralement, d’une œuvre où le langage fait loi.
En ces troublantes matières, il y a fort à parier que la rencontre de l’œuvre de Marguerite Duras fut déterminante.
Dans les livres de celle-ci, la dynamique du désir est fondée sur le manque et l’absence. Elle est à l’œuvre dans les histoires racontées par l’écrivain – histoires d’amour toujours impossibles où le sujet s’évanouit dans la contemplation de l’objet de sa quête, mais histoires circulant et vivant de par leur impossibilité même. Elle sous-tend aussi le geste de l’écriture, vécu comme une exécution, dans tous les sens du terme : écrire, c’est accepter de faire une expérience déceptive, l’œuvre, endeuillée de l’objet qu’elle vise, se consumant à mesure qu’elle s’écrit, tandis que le sujet qui la porte éprouve la disparition de ses limites identitaires. Mais cette aptitude à l’effacement rend immanquablement l’écrit à sa force originelle, à son devenir et lui permet de toujours se recommencer…
En donnant à lire les mouvements paradoxaux du désir – qui cherche à accomplir ce qui ne palpite qu’en son inaccomplissement, qui voudrait réduire la distance avec ce qui lui est éloigné et qui ne vit pourtant que de cet éloignement –, l’auteur de L’AMOUR raconte toujours, de fable en fable, le drame de l’œuvre en train de se faire, du livre infiniment à venir, la part du vide qui constitue l’écriture, dans un geste incessant de perte et de reprise. Chaque texte vise donc à rendre perceptible le processus du désir – violent, inassouvi et charnel – comme étant celui-là même de l’écrit, voire de tout acte de création.
En 1993, Éric Vigner entreprend de mettre en scène, pour un atelier au CNSAD, LA PLUIE D’ÉTÉ de Marguerite Duras3. Le roman narre l’épopée extraordinaire d’Ernesto, fils d’émigrés, aîné d’une horde de brothersandsisters, et qui refuse d’aller à l’école « parce qu’à l’école on [lui] apprend des choses qu’[il] ne sait pas »4. Il vit alors, en marge des institutions, deux expériences initiatiques : sans savoir lire, il déchiffre un livre brûlé, L’ECCLÉSIASTE ; dans le même temps, il fait l’amour avec sa sœur Jeanne… Le désir, ici, est innocent, scriptural et familial, actif et intense en cet âge d’or que représente l’adolescence pour l’écrivain. Il révèle la voie d’un gai désespoir, nécessaire et existentiel.
La scène initiale durassienne – unissant très étroitement inceste et accès mystique à la connaissance originelle, désir du corps et désir du Livre – ouvre au metteur en scène le champ d’un travail théâtral dont il n’avait jusque-là qu’entraperçu la possibilité. Car c’est bien à la découverte de ce livre – LA PLUIE D’ÉTÉ – qu’Éric Vigner, tel Ernesto, doit d’avoir engagé un processus de travail où la quête du plaisir des mots se confond avec l’expérience incarnée du désir.
De Duras, il montera ensuite LA BÊTE DANS LA JUNGLE en 2001 – adaptation des plus « durassiennes », écrite en collaboration avec James Lord, d’après une nouvelle d’Henry James –, SAVANNAH BAY, en 2002, et, pour le festival d’Avignon, en 2006, PLUIE D’ÉTÉ À HIROSHIMA, spectacle construit à partir d’une reprise de LA PLUIE D’ÉTÉ et d’une adaptation du scénario composé pour Resnais : HIROSHIMA MON AMOUR5.
Le parcours confirme les intuitions : le désir est pulsion créatrice, circulante, changeante, à mettre en forme. L’exprimer, c’est faire de l’art le sujet même du travail, c’est raconter comment l’œuvre s’élabore en rompant avec certaines conventions théâtrales. Dans cette perspective, il retient la proposition de l’écrivain qui suggère, dans les années 80, que la mise en scène de ses œuvres appelle « un théâtre lu, pas joué »6, non réaliste, non illusionniste, exigeant des acteurs une découverte progressive de l’écriture, calquée sur la dynamique paradoxale du désir.
La volonté de mettre en scène le désir et ses poten- tialités ne saurait donc se satisfaire du récit d’une histoire d’amour. Elle inspire les moyens de faire vivre au spectateur une expérience sensible où le langage joue un rôle essentiel, où le théâtre – comme le livre, comme l’amour – s’organise, entre absence et présence, création et consomption, pour rendre perceptible non le désir dans l’œuvre (comme thème) mais du désir à l’œuvre (en processus), faisant œuvre – un désir de l’œuvre.
À partir de LA PLUIE D’ÉTÉ, le metteur en scène se plaira à accorder un temps de répétition démesurément extensible aux premières scènes de ses spectacles, aimant y revenir souvent, cherchant toujours à interroger le départ, le début, l’origine comme s’il voulait retarder le moment de la mise en forme définitive…
Il fera durer les périodes de travail à la table où les comédiens, texte en main, ne sont pas encore en train de fixer des personnages ou des mouvements. Il leur demandera une lecture attentive aux rythmes et aux sonorités, ainsi qu’une articulation et une écoute extrêmement vigilantes des mots. Il les arrêtera, obsessionnellement, aux instants où il dira ne pas « entendre le texte », ne pas en percevoir toutes les significations…
À force de relire et redire, les acteurs, parfois un peu perdus, ont vite l’impression de proférer des sons et des rythmes plus qu’une construction syntaxique éclairante. Le droit-fil du sens est dérouté. Les réflexes déclamatoires, les intonations trop vite adoptées et l’expression attendue des émotions sont déjoués. Les comédiens abandonnent la situation proposée par les auteurs et concentrent leur travail moins sur la nécessité de savoir de quoi ils parlent que sur la quête de la pulsion irrationnelle qui innerve le verbe. Ils cherchent non une motivation psychologique mais le désir de parler – un désir qui, comme tout désir, est séparé de son objet, vit de cette absence au point de ne plus s’alimenter qu’au plaisir de désirer, c’est-à-dire, ici, à celui de dire, d’éprouver les possibles de l’écriture : délivrée de son sens premier, la parole révèle la charge signifiante des rimes internes, des assonances, des juxtapositions sonores qui la composent. Elle invite aux digressions et aux associations d’idées et d’images…
Par la reprise, la répétition et le déplacement, l’acteur accède donc aux origines désirantes et souterraines qui ont organisé le texte et fait rayonner les multiples sens, propres et figurés, retenus dans les plis secrets de la langue.
Vigner montera ainsi Racine7, ce Racine « pas détaillé, pas lu, pensé » que Duras appelait de ses vœux. La « musique de Racine »8, ce langage étrange, amoureux, qui doit être « entièrement prononcé », pour en révéler « les champs sonores », les « cré[er] comme chaque fois pour la première fois », les « prononc[er] jusqu’à la résonance du mot, le son qu’il a, jamais entendu dans la vie courante »9. Prenant au pied de la lettre le mot « expirer », récurrent dans la tragédie, et qui désigne à la fois l’acte de mourir et une phase de la respiration – l’absence de souffle et la possibilité de sa reprise –, Éric Ruf (Bajazet) respirait avec force, au rythme des alexandrins qui énonçaient le désir de Bajazet pour Atalide (Isabelle Gardien). Toujours soupirant mais toujours déroulant la confidence des amours interdites, l’acteur rendait physiquement perceptibles les efforts du corps et du souffle pour faire advenir le poème. Et le personnage semblait ainsi étouffer dans sa propre langue, menacé par les mots qui lui donnaient vie, prêt de mourir dans le bruissement de la parole, vif d’avouer le désir qui causerait aussi sa perte. Le chant, près de disparaître, n’en finissait pas de reprendre force : son origine et sa fin se confondaient ; la profération, attachée à restituer le mouvement du texte, rendait organique la dimension tragique de l’amour.
Cherchant à retarder toute mise en forme définitive pour faire apparaître le processus d’élaboration de la parole, Éric Vigner inventera sa structure dramatique de prédilection : dans les premières versions de LA PLUIE D’ÉTÉ et dans PLUIE D’ÉTÉ À HIROSHIMA, les représentations organisaient l’accession progressive des acteurs, d’abord lecteurs et narrateurs, à l’incarnation des personnages de la fable qui se répondaient dans des dialogues intersubjectifs.
LA BÊTE DANS LA JUNGLE s’impose comme une variante de ce dispositif. L’histoire inventée par James est centrée sur des problématiques liées au désir amoureux : John Marcher ( Jean-Damien Barbin) est persuadé d’être voué à un destin extraordinaire ; Catherine Bertram (May Bertram dans la nouvelle, Jutta Johanna Weiss sur le plateau) accepte d’attendre l’événement qui fera de lui un homme d’exception. Les scènes constituent une succession de rencontres pendant lesquelles le spectateur constate que les personnages ne vivront rien du désir qui les lie, désir qui échappe à l’homme, aveuglé de narcissisme. La femme en meurt, sans lui confier ce qu’elle a compris du destin qu’il espère. La révélation aura lieu sur la tombe de Catherine, des années plus tard, alors qu’il contemple un autre homme endeuillé : John Marcher n’a pas vécu son histoire…
Pendant les répétitions, Éric Vigner parla peu d’amour avec les acteurs. Il leur proposa plutôt de transposer la situation : chaque scène fut découpée en séquences autonomes ; chaque séquence devait être envisagée comme une proposition de jeu qu’un comédien faisait à l’autre, qui l’acceptait ou s’en détournait. La fin d’une séquence, marquée par des silences et des changements de position, mettait un terme définitif au numéro et engageait à trouver l’origine et les moyens du suivant. Ainsi, un glissement s’opérait : les acteurs ne cherchaient plus les motivations de leur dialogue dans la situation des personnages, fondée sur la conscience du désir chez la femme et l’incapacité à le reconnaître chez l’homme. Les indications du metteur en scène renvoyaient chacun à la réalité de son travail d’acteur qui donnait à voir comment il inventait la pulsion nécessaire pour jouer. Ce déplacement des enjeux transformait la fable : l’homme devenait aussi désirant et actif que la femme. Il expérimentait avec elle diverses configurations comme autant de possibilités d’être ensemble, autant de figures du désir qui, sans jamais l’épuiser, provoquaient, dans la fiction, la mort de Catherine et, sur le théâtre, de multiples et libres inventions, aux modalités génériques, rythmiques, esthétiques, très diversifiées. Dès lors, le plaisir d’un partage ludique du plateau rendait perceptible le processus de création des acteurs bien plus que les affres du désastre intime imaginé par James.
Les formes de la représentation amoureuse, sous la direction du metteur en scène, peuvent donc surprendre. Éric Vigner n’est pas le metteur en scène des jeux de l’amour et du hasard parce qu’il se veut celui du désir comme processus. Rien de sentimental dans la peinture qu’il propose des couples (quand il y en a); les acteurs ne simulent ni le bonheur de l’attachement ni les émois de la séparation si bien qu’on peut les trouver froids, distants, occupés à exposer le geste de l’écriture et dominant le jeu si habilement que leur ostensible maîtrise, en ces matières, parfois, étonne.
À cela s’ajoute que les dispositifs créent une scission flagrante entre le corps – souvent très sollicité, en mouvement, déplaçant, installant les accessoires et les éléments mobiles de la scénographie (rideaux, escalier sur roulettes, paravents) – et la profération – claire, nette, nettoyée, pourrait-on dire, des intonations que les situations pourraient y imprimer.
Chez Vigner, les mots d’amour se parlent souvent – et de plus en plus souvent – avec force, de façon très articulée, sans être teintés d’émotion feinte, sans se soumettre aux contraintes spatiales, comme s’ils tentaient d’échapper aux humeurs et aux postures qui pourraient atténuer ou corrompre leur dimension sonore. De plus, tout dialogue, aussi intime soit-il, est le plus souvent dit frontalement, face à la salle qui devient la caisse de résonance du texte.
Pour rendre perceptible la chair des mots, il faut nécessairement éviter la monstration des sentiments ; pour parler des désirs physiques, il faut libérer le corps de l’acteur des fusions identificatoires avec la parole ; pour atteindre l’intime, il faut briser l’illusion scénique d’un tête-à-tête intimiste et provoquer un face à face avec le troisième terme regardant – le spectateur.
Pour que le public soit partie prenante, il faut surtout lui donner à entendre autrement la langue de l’amour, trouver une voix – entre-deux du corps et du texte – étrangère…
Aussi, la profération est-elle toujours inquiétée par des tensions vocales.
Je pense à la voix haute, trop haute, si perchée qu’elle en devenait fragile, de Philippe Métro, dans LA PLUIE D’ÉTÉ, voix trouvée par l’acteur en référence aux origines méditerranéennes du père et aux timbres des chanteurs de charme italiens ; je pense aux voix aiguës et nasales, près de se briser, des Ernesto que furent Jean-Baptiste Sastre et Nicolas Marchand10 ; je pense à Micha Lescot qui, à la fin d’OÙ BOIVENT LES VACHES, traversait les sphères fantasmatiques créées par son personnage en poussant la voix, en martelant les mots.

Hélène Babu, Jean-Damien Barbin, Pierre Gérard, Thierry Godard, Micha Lescot, Marc Susini, Jutta JohannaWeiss dans OÙ BOIVENT LES VACHES de Roland Dubillard, mise en scène et décor Éric Vigner, Théâtre Du Rond-Point, Paris, avril 2004.
Photo Alain Fonteray.
Dans ce paysage sonore, exploré parfois jusqu’à saturation, bruissent, par contraste, les voix sourdes de Jutta Johanna Weiss, ou de Jean-Damien Barbin11. Celles-ci se tendent vers le murmure.
Toutes voix confondues, les tensions se manifestent de la façon la plus flagrante dans l’explosion des cris : c’est Ernesto qui désigne soudain en criant l’illimitation du monde avec lequel il veut fusionner ; c’est Roxane (Martine Chevallier) qui hurle ce que Bajazet étouffe, dans un palais muré de silences ; c’est Catherine Hiegel, dans l’ombre du lointain, qui appelle Savannah tandis que Catherine Samie conduit précautionneusement le récit douloureux de sa mort, seule face à la salle : l’émerveillement de l’amour et la violence insupportable de la perte se donnaient alors à entendre dans un même mouvement de récitatif. C’est, plus récemment, dans SEXTETT, le long cri de Micha Lescot, cyclique, interminable, pourfendant les hésitations et la réserve par lesquelles son personnage entend éviter l’amour et la conjugalité.

Micha Lescot, Catherine Jacob et Claude Perron dans JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE de Rémi De Vos, mise en scène et décor Éric Vigner, Théâtre du Rond Point, Paris, janvier 2007.
Photo Brigitte Enguerand.
Aux limites de la tension vocale, le cri déborde le langage, mais il est déjà comme en attente dans la diction surarticulée et mesurée des acteurs. Hélène Babu en offrait la preuve évidente quand, dans LA PLUIE D’ÉTÉ et PLUIE D’ÉTÉ À HIROSHIMA12, elle troublait la pondération des phrases en allongeant la durée d’émission de certaines voyelles (les –a dans Jeanne et Vladimir par exemple). Elle créait alors des associations sonores significatives qui trahissaient les jeux du désir.
Mises en tension des voix, cris où déflagre ce qui ne saurait trouver de mots pour se dire, expansions excessives de certains sons… le désir à l’œuvre dans l’acte de parole ne saurait se satisfaire des conduites verbales habituelles. Il appelle une étrangéification de la parole – entre maîtrise et lâcher-prise, entre réticence et excès – mais aussi, pour intensifier l’inconvenance du langage, une hybridation et un travestissement du corps, parfois jusqu’à la confusion des genres.
Dans les spectacle d’Éric Vigner, les hommes sont fragiles, incertains, faillibles, presque morts (LA MAISON D’OS, BAJAZET) et, le plus souvent, très jeunes (LE RÉGI- MENT DE SAMBRE ET MEUSE, LE JEUNE HOMME…13), voire rajeunis (Micha Lescot, trentenaire, interprétait l’écrivain vieillissant d’OÙ BOIVENT LES VACHES14). Ils portent volontiers la jupe, le corset, l’escarpin.
Les femmes sont fatales, dangereuses, ostensiblement désirables et désirantes, dévoreuses (les mères) – d’une force qu’on attribue traditionnellement à la virilité. Elles ont l’âge pythique de la connaissance (Catherine Hiegel incarnait la « Jeune femme » de SAVANNAH BAY, auprès de Catherine Samie, quand le texte de Duras suggère une bien plus grande différence d’âge entre les personnages). Les attributs du féminin s’affichent, soit dans une version langoureuse et sensuelle (Catherine Hiegel, sublime en robe rouge15 face à la salle), soit dans une version ironique (au sens littéraire du terme) et fantasmatique (Sarah et Walkyrie, la femme-chien, dans SEXTETT,créatures masquées, préfabriquées ou animalisées, jusqu’à la monstruosité16).
Le costume vient donc souligner la quête d’une transgression voire d’une inversion des lois communes de l’amour.
Emblématiquement, on retiendra l’image, très belle, dans LA BÊTE DANS LA JUNGLE, de John Marcher ( Jean-Damien Barbin) qui se laissait corseter par Catherine Bertram ( Jutta Johanna Weiss). Vêtue d’un long manteau de peau de bête, sorte de Vénus à la fourrure17, celle-ci tressait, voix sourde et gestes très lents, d’immenses lacets autour du corps abandonné de son amant. Contrairement à la nouvelle jamesienne, ici, la sexualité n’était pas latente et le personnage féminin paraissait bien moins victime. De même, dans OÙ BOIVENT LES VACHES, Jutta Johanna Weiss incarnait la femme de l’écrivain, Rose, qui, à la lecture, se révélait plus réservée qu’à la scène où l’actrice, dans un justaucorps moulant dont la couleur rappelait le prénom du personnage18, se coulait lascivement contre les murs à la manière d’une strip-teaseuse. Catherine et Rose, sur scène, constituent les doubles inversés, ironiques, des rôles tels qu’ils sont écrits ; d’une certaine manière, elles leur donnent la réplique.

Photo Alain Fonteray.
Pour séduire le public, Éric Vigner aime à explorer les zones frontières – entre les sexes, entre les genres, entre l’interprétation des acteurs et le rôle auquel ils donnent forme, mais aussi entre les comédiens – toujours maîtres de leurs créatures – et le spectateur, pris au piège d’un dispositif spatial qui se dérobe à lui autant qu’il l’accueille, et qui frustre sa pulsion scopique.
Éric Vigner a longtemps imaginé, parfois en collaboration avec Claude Chestier pour PLUIE D’ÉTÉ, BAJAZET, L’ILLUSION COMIQUE… ou assisté de Bruno Graziani pour LA BÊTE DANS LA JUNGLE, SAVANNAH BAY, OÙ BOIVENT LES VACHES…, des récits scénographiques qui se défaisaient, s’effondraient, à mesure que la représentation avançait. Parfois tout à fait dénudée à la fin du spectacle, la scène était rendue à elle-même, affranchie de ses simulacres.
Le feu envahissait le plateau quand s’achevait LA PLUIE D’ÉTÉ ; les derniers mots de BAJAZET mettaient en mouvement une grande pierre noire qui se refermait lentement sur l’aire de jeu signalant la fin de l’histoire. Dans LA BÊTE DANS LA JUNGLE,les portraits peints par Van Dick qui couvraient, au début, la surface du plateau étaient ensuite retournés. Ils changeaient de fonction, devenaient paravents, castelet… Puis, ils disparaissaient, laissant la scène vide avant que l’obscurité ne l’envahisse.
De spectacle en spectacle, s’organisait un lent mouvement d’évidement – qui rappelait ce que l’œuvre devait à la perte et au manque, et provoquait comme un travail de la mélancolie : au cours de ce désœuvrement, le spectateur mesurait ce qui avait été et ne serait plus – le plaisir du récit et l’envie de le prolonger s’éprou- vaient dans le moment même où s’éveillait la conscience de son imminente disparition.
À l’instar de l’expérience qu’il propose au public, le désir de faire œuvre, chez Éric Vigner, se confond toujours avec celui de raconter une histoire en mettant en scène, paradoxalement, des textes dont le plus souvent la fable s’est absentée, est suspendue ou pulvérisée. Sa recherche artistique s’apparente à la quête perpétuelle d’un grand récit fondateur, quête qui nécessite que jamais il ne l’invente pour en entrevoir sans cesse les possibilités, pour que renaissent, immanquablement, ce point névralgique de l’émotion, cet horizon d’attente qui stimule le geste de la création.
Mais, aujourd’hui, le travail sur les comédies de Rémi De Vos l’amène à imaginer un espace moins promis à la disparition et qui « inquiète » bien différemment le regard19.
La faculté de voir, dans les spectacles d’Éric Vigner, était sans cesse mise en doute par des dispositifs qui excitaient la pulsion scopique tout en tronquant, dérobant ou floutant la vision : aux trappes imaginées pour les premiers spectacles et dans lesquelles disparais- saient et apparaissaient partiellement ou intégralement les corps des acteurs succédèrent les miroirs de L’ILLUSION COMIQUE qui renvoyaient l’image évanescente des comédiens. Dans LA BÊTE… et SAVANNAH BAY, le regard était piégé par l’utilisation de rideaux (de bambous dans le premier, de perles de verre irradiantes dans le second) couvrant l’intégralité du cadre de scène et qui, associés à un système mobile de paravents, masquaient ce qui se passait dans la cage de scène tout en le laissant deviner. Ou bien, tout à fait opacifiés par des jeux de lumières, ils constituaient un motif pictural et ornemental qui fermait l’espace et obligeait le spectateur à se concentrer sur ce qui arrivait sur le proscenium.

Marie-France Lambert avec un masque de Erhard Stiefel dans SEXTETT de Rémi De Vos, mise en scène, décor et costumes Éric Vigner, Théâtre du Rond-Point, Paris, novembre 2009.
Photo Pacôme Poirier/Wiki spectacle.
Ces rideaux marquaient le passage à un théâtre qui entend faire éprouver la rupture sémiologique entre la salle et la scène et qui veut que le désir du spectateur en soit stimulé, que ce dernier cherche à percer les mystères derrière les écrans. Au terme des spectacles, le secret était toujours levé et dévoilait la blancheur d’une scène rendue à elle-même.
Les comédies ne captent plus de la même façon les regards. L’espace de JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE20, premier volet de la trilogie imaginée par Rémi De Vos, est le même que celui de SEXTETT21 : pour les spectateurs fidèles, point de surprise, sinon celle de reconnaître l’intérieur d’un pavillon de banlieue. Le rideau a reculé, au fond, à cour. Plus petit, il n’occulte qu’une portion de l’espace dramatique : le jardin, qui jouxte la maison. Quand il s’ouvre, c’est sur un songe : une créature mi-femme mi-chienne, venant des profondeurs d’une nuit que l’œil du spectateur, jusqu’alors confiné dans l’espace visible de l’avant-scène, ne pouvait pas soupçonner. Le dévoilement, ici, n’offre pas au public les frontières d’une aire de jeu mise à nu mais un espace onirique et illimité.
À bien y regarder, les enjeux scénographiques ont donc changé : les trappes, qui trouaient la surface du plateau, racontaient un désir de verticalité et de scissions ; les rideaux, qui séparaient le proscenium de la cage de scène, visaient à rayer la vision, à renvoyer le spectateur à sa position de voyeur pour le projeter finalement dans un espace évidé. Aujourd’hui, les représentations se concentrent dans un lieu plus long que profond, en avant-scène, qui donne l’impression que le proscénium des spectacles précédents s’est démesurément étendu. Les trouées d’obscurité et les altérations de l’image n’interviennent que ponctuellement, au lointain. Comme si les premières expériences formaient l’horizon des nouvelles…
La question du désir, parallèlement, s’est-elle transformée ? A‑t-elle changé de visage comme elle a changé d’espace ?
Si ses principes restent identiques – étrangéification de la langue, inventions de dispositifs paradoxaux de division (du corps et du texte, de la voix et du sentiment, de l’acteur et du rôle, du spectateur et de la représentation), le metteur en scène confesse une mutation qu’il place d’emblée sous le sceau du désir 23. Selon lui, les comédies de Rémi De Vos permettent de passer à un ordre du désir qui rompt avec la mythologie familiale. Tout se passe comme si la scène initiale durassienne – troublante, incestueuse, adolescente – était progressivement effacée au profit du récit de relations moins innocentes, plus adultes, plus manifestement sexuées, à l’Autre, aux autres. Plus égocentrées aussi : les figures de l’altérité semblent les projections imaginaires du sujet central, qui les a façonnées alors qu’il dit en être la victime. Les pièces et leurs mises en scène se déroulent comme des monodrames fantastiques. Le roman de la mythologie familiale a préparé l’éclosion d’un théâtre du moi rayonnant. L’expérimentation originelle du brouillage identitaire, de l’inversion sexuelle, du masquage puis du déshabillage de la scène, du désir comme manque absolu, et de l’œuvre comme absence a fait place à la comédie de l’éros, comme fiction ironique, mettant en scène un désir qui fait œuvre, constitue l’homme en narrateur épique et la femme en créature. Du travail du vide et des profondeurs, où se perdaient parfois les silhouettes, ont émergé des images qui offrent désormais au dévoilement l’écran fragile de leur surface.
Du désir de l’œuvre à l’œuvre du désir, du manque originel aux visions que dessine la pulsion créatrice, le désir, selon Vigner, se reconfigure, cherchant toujours, par une théâtralité avouée, revendiquée, le plaisir protéiforme des rencontres avec le spectateur.
- LA MAISON D’OS, de Roland Dubillard, création en 1991, dans une usine désaffectée d’Issy-Les-Moulineaux. ↩︎
- SEXTETT, de Rémi De Vos, création en 2009 au Grand Théâtre de Lorient. ↩︎
- Cet atelier a donné naissance au spectacle du même titre créé d’abord au Théâtre du Conservatoire le 20 mars 1993. Le rôle d’Ernesto était initialement tenu par Frédéric Mulon auquel succéda Jean-Baptiste Sastre, à la reprise, le 26 octobre 1993, au Stella à Lambezellec. ↩︎
- Duras Marguerite, LA PLUIE D’ÉTÉ, P.O.L, 1990, p. 22. ↩︎
- À noter qu’il organisa aussi en 1998 une lecture de LA DOULEUR, avec Anne Brochet et Bénédicte Vigner. ↩︎
- Duras Marguerite, LA VIE MATÉRIELLE, P.O.L., 1987, p. 14. ↩︎
- BAJAZET de Jean Racine, création au théâtre du Vieux-Colombier, 1995. ↩︎
- Duras Marguerite, LA VIE MATÉRIELLE, P.O.L., 1987, p. 82. ↩︎
- Ibid., p. 14 – 15. L’auteur parle ainsi des Passions selon Saint Jean et Saint Mathieu. Mais en vient, après ces remarques, à évoquer Racine. ↩︎
- Nicolas Marchand fut Ernesto dans PLUIE D’ÉTÉ À HIROSHIMA. ↩︎
- Je ne prends en exemples que les acteurs qui ont joué à plusieurs reprises avec Éric Vigner et dont la personnalité vocale a donc, peut-être, induit le choix de certainsprojets. ↩︎
- Hélène Babu incarnait la mère d’Ernesto et Jeanne dans LA PLUIE D’ÉTÉ et dans PLUIE D’ÉTÉ À HIROSHIMA. Vladimir est le nom d’un ancien amant de la mère, nom qu’elle prête volontiers à son fils… ↩︎
- Le Régiment de SAMBRE ET MEUSE, d’après les œuvres de Alphonse Allais, Louis-Ferdinand Céline, Jean Genet, Roland Dubillard, Georges Courteline et Frantzmarc, création 1992 ; LE JEUNE HOMME, de Jacques Audureau, création 1994. ↩︎
- OÙ BOIVENT LES VACHES, de Roland Dubillard, création en 2003 au Grand Théâtre de Lorient. ↩︎
- Les costumes de SAVANNAH BAY étaient de Paul Quenson. La robe rouge évoquait la robe d’Anne-Marie Stretter (Delphine Seyrig) dans INDIA SONG,le film sans doute le plus connu de Marguerite Duras. ↩︎
- Dans SEXTETT, les costumes étaient d’Éric Vigner et le masque de chien d’Erhart Stiefel. ↩︎
- La Vénus à la FOURRURE de Sacher- Masoch avait, en effet, inspiré le travail dramaturgique sur la pièce. Les costumes étaient de Paul Quenson. ↩︎
- Dans OÙ BOIVENT LES VACHES, de Roland Dubillard, les costumes étaient de Paul Quenson. ↩︎
- « Inquiéter le regard » : la célèbre formule est de Jean-Luc Nancy. ↩︎
- Création en 2007. ↩︎
- La scénographie des deux spectacles cités est d’Éric Vigner. ↩︎