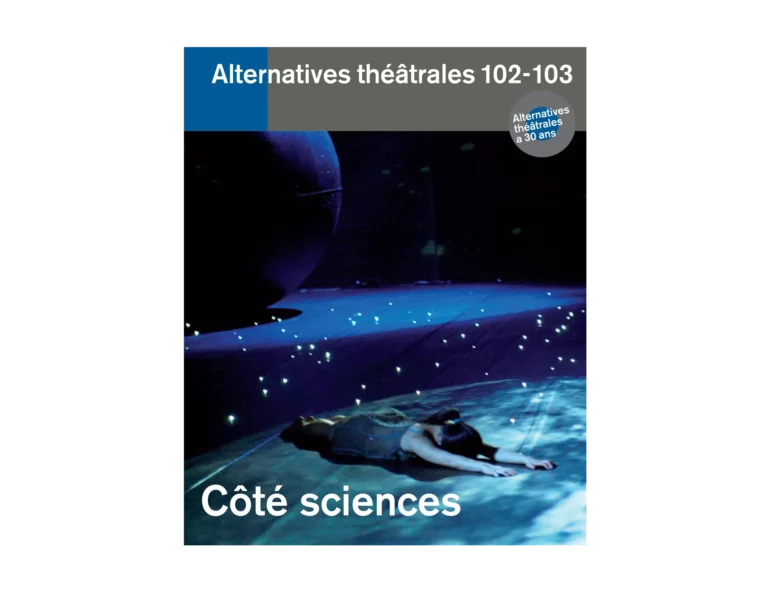REPRENDRE l’idée brechtienne d’un « théâtre de l’ère scientifique », et du même coup « faire du théâtre » plutôt que « produire des mises en scène » 1.Telle serait, sous forme condensée, l’ambition de Jean-François Peyret lorsqu’il s’attaque à des monuments tels que Darwin ou Galilée. Mais pour mieux comprendre ce que visent ces propos rapportés, il convient d’abord de ne pas réduire trop vite « l’ère scientifique » à « l’âge atomique », ni la chose scientifique en général aux dispositifs contemporains de la technoscience. Que la science n’intervienne pas seulement comme un objet de réflexion, lui-même différencié en problèmes singuliers (le vivant et la machine, par exemple), qu’elle ne se présente pas d’abord comme un thème dramatique mais qu’elle joue plus fondamentalement le rôle d’un opérateur capable d’emporter le théâtre plus loin que lui-même, indique bien qu’il y va d’autre chose ici que d’une restitution poétique des questions et des troubles d’époque (« peurs et fantasmes », selon l’expression consacrée). La méthode de travail mise en œuvre par Jean-François Peyret nous incite d’ailleurs à examiner plus particulièrement le genre de connivence que peut entretenir un homme de théâtre avec le mode de pensée des hommes et des femmes de science, au-delà des motifs mythologiques associés aux figures du Savant 2. Biologistes, mathématiciens ou physiciens : mobilisés en chair et en os ou à travers leurs écrits, ces scientifiques ne se contentent pas de nourrir l’inspiration du dramaturge par conversations et textes interposés ; on se dit qu’ils doivent jouer le rôle d’aiguillon, d’échangeurs ou de dérailleurs, qu’ils incarnent une espèce de principe d’instabilité qui empêche la petite machine théâtrale de se fermer sur elle-même.
Si cette intuition se confirmait, il faudrait montrer précisément comment un certain régime de circulation de pensées et d’affects échappés de l’activité scientifique – ressaisie à travers ses moments d’invention, de doute ou de détente rêveuse – vient contrarier les habitudes d’un théâtre moderne encore fondamentalement aristotélicien, autrement dit gouverné par la logique de la fable, ordonné aux cohérences linéaires et aux synthèses psychologiques. Car il y a autant de naïveté à se représenter la science comme un monument glacé, étranger à l’errance et à la passion, réduit à une procession d’abstractions et de protocoles techniques, qu’à s’imaginer qu’il suffit de bouleverser le dispositif de la scène, de briser les lignes narratives ou de distribuer partout des sujets clivés ou des discours divagants, pour échapper d’un coup à la forme du drame traditionnel. Même le chaos a sa poétique. Pour ouvrir le théâtre selon d’autres lignes, ce que Brecht et Artaud avaient tenté par des voies différentes, il devient nécessaire de l’aborder comme une machine, capable de se brancher sur d’autres… À condition bien sûr que ces dernières ne soient pas des usines à gaz (la Politique, le Corps, la Science). Entre un bon drame bourgeois et un « théâtre d’idées » hanté par le démon de l’allégorie, il n’est pas certain qu’on gagne au change.
Il ne serait pas difficile de poursuivre sur ce ton, mais pour être tout à fait franc, et pour mieux préciser du même coup ce qui m’intéresse ici, je dois un aveu au lecteur. Le voici : le théâtre n’est pas mon affaire. C’est un fait, je ne peux m’autoriser d’aucune expérience de spectateur un tant soit peu consistante. J’ai peu de goût, en général, pour les textes mis en scène, et donc aussi pour les pièces de théâtre, du moins lorsque vient le moment de les voir jouées. J’ai lu les tragiques grecs avec enthousiasme, mais je n’ai fait que les lire. Inversement, mes meilleurs souvenirs de théâtre – il m’en reste tout de même quelques-uns – me renvoient à des auteurs que je n’ai jamais lus pour eux-mêmes en dehors du contexte scolaire : Molière m’apparaît aussi essentiellement joué que Sophocle ou Beckett me semblent essentiellement écrits. Et le Petit organon m’est plus familier qu’aucune des pièces de Brecht. Qu’on ne voie dans cet aveu aucune coquetterie : je vous parle d’un point aveugle. Sans doute le philosophe en moi a‑t-il peu d’indulgence pour la langue de bois qui accompagne, comme une rumeur, la production dramatique ordinaire. Mélange grandiloquent de platitudes psychologiques et d’effusion boy-scout, il n’y est question que de « présence », d’«intensité d’expérience », de « partage » et d’«échange ». L’agacement suscité par ce registre pathétique et ses tours de langue ne fait pourtant que confirmer une méfiance plus générale. Au fond, du théâtre, une seule chose m’apparaît dans le registre de l’évidence et de la nécessité ; c’est le comique. Mais comme je le préfère au cinéma, il est clair que quelque chose m’échappe.
Un peu consternés tout de même, des amis qui me veulent du bien m’objectent fréquemment qu’il faut juger sur pièces, voir ce que les dramaturges font plutôt que ce qu’ils disent. On m’explique avec beaucoup de patience qu’entre le texte et la performance, il y a justement le théâtre : son dispositif, le jeu qu’il organise entre la lettre et la voix, l’idée et le corps. Et comme je demande à voir, il arrive qu’on m’y conduise de force : on me sort… C’est ainsi que j’ai rencontré Jean-François Peyret. Le montage du CAS DE SOPHIE K. en fournissait le prétexte. Un ami commun, Dork Zabunyan, tenait à me présenter l’homme de théâtre, parce que, disait-il, son travail touchait à Poincaré, et plus généralement à la science.
Il se trouve que la science, en tant que philosophe, était devenue depuis quelque temps mon affaire. Notre première conversation devait naturellement tourner autour des mathématiques ; il y fut question plus généralement du théâtre comme d’un exercice d’«intelligence artificielle » capable de suggérer d’étranges raccords d’idées, de machiner des affects nouveaux. D’abord un peu méfiant, je n’ai pas eu de mal à entendre ce langage, qui est aussi celui de la philosophie telle que je la conçois. Le mot même de « théâtre » cessait de faire écran. « Je ne monte pas de pièce », m’expliquait d’ailleurs Jean-François Peyret, évoquant un « laboratoire de représentations » qui procèderait par agencement de matériaux – textes et images, biographèmes et mythèmes, démonstrations, représentations médiatiques, souvenirs rapportés, lettres échangées.
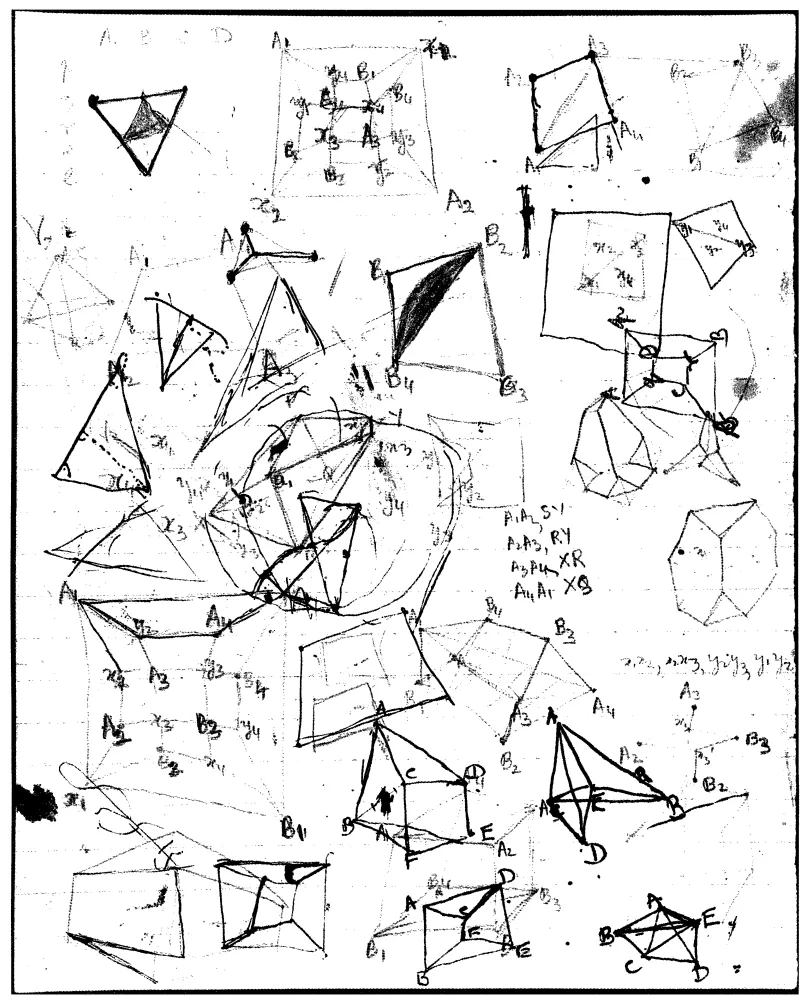
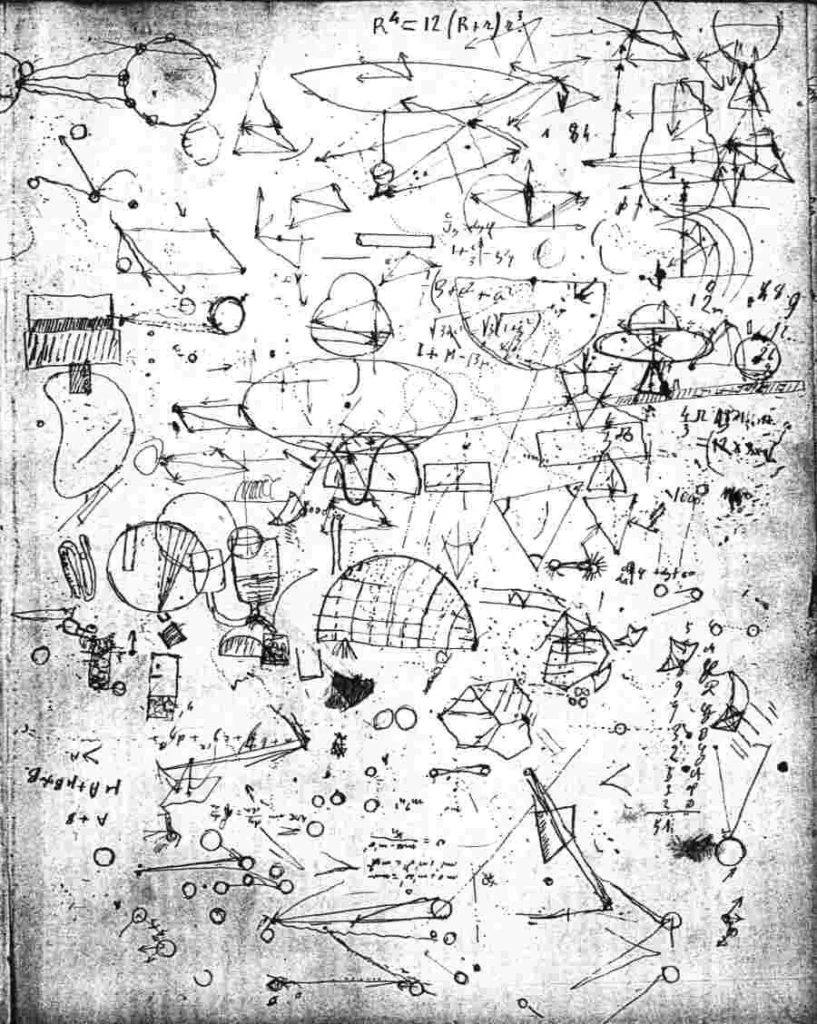
Le travail de composition théâtrale consisterait à rendre sensible un ordre de coexistence entre tous ces fragments hétérogènes. Ainsi la « figure » de Galilée, héros de la science moderne, véritable institution culturelle, a sa place à côté d’une lettre sur les confitures de sa fille Virginie, placée au couvent. Avant d’activer les réflexes critiques et d’identifier les contradictions qui travaillent le discours d’autolégitimation de la science, il faut se rendre attentif au fait même de cette coexistence, et aux manières dont elle peut s’organiser dans l’espace et le temps d’une « représentation ». Si TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE se donne aussi comme un remontage ou un commentaire radiographique de LA VIE DE GALILÉE, c’est en organisant un espace de variation autour de l’Urtext brechtien, et surtout en l’exhibant comme tel, en surlignant volontairement toutes les prises, tous les raccords qui témoignent de la fabrication d’un spectacle de théâtre adéquat au spectacle lui-même si complexe, si stratifié, si hétérogène, de la science moderne.