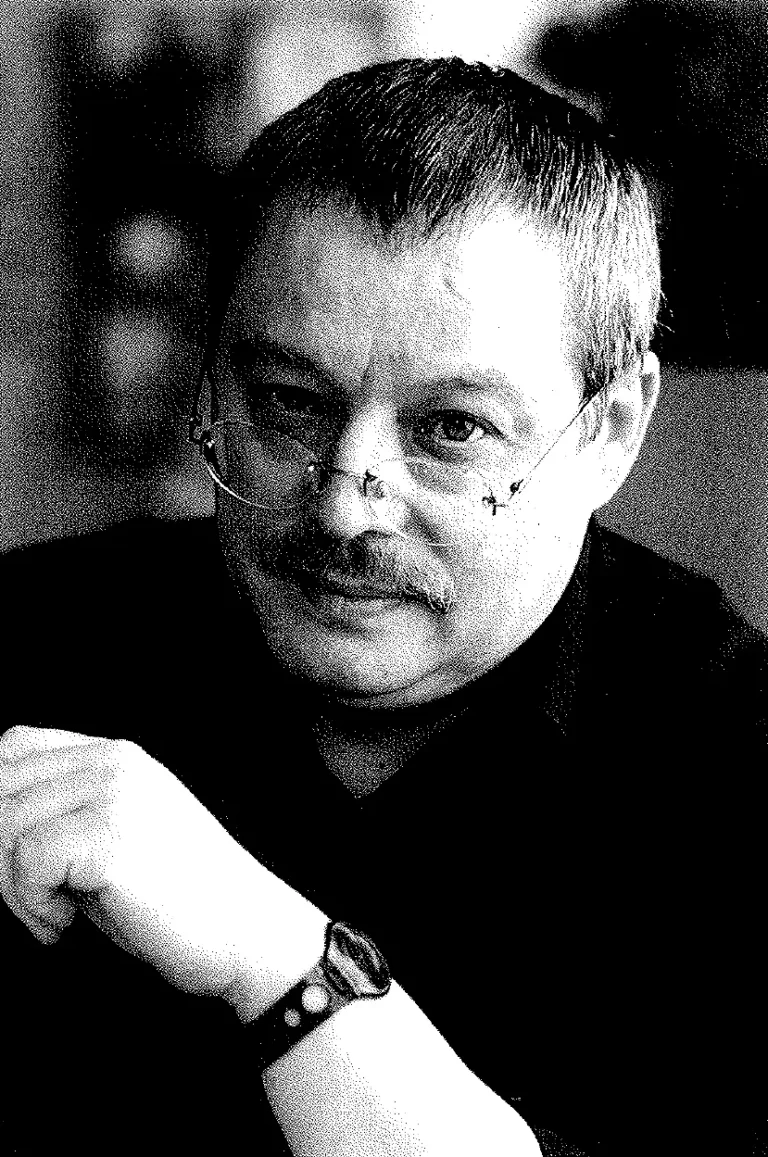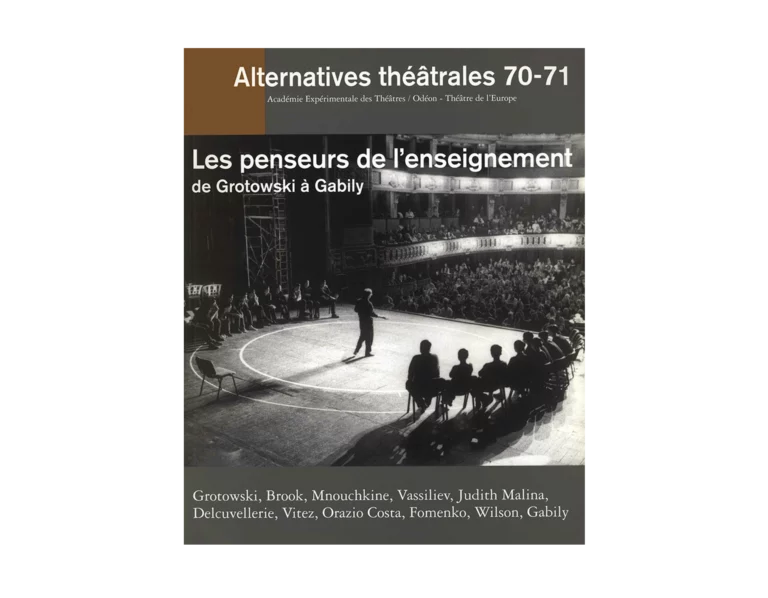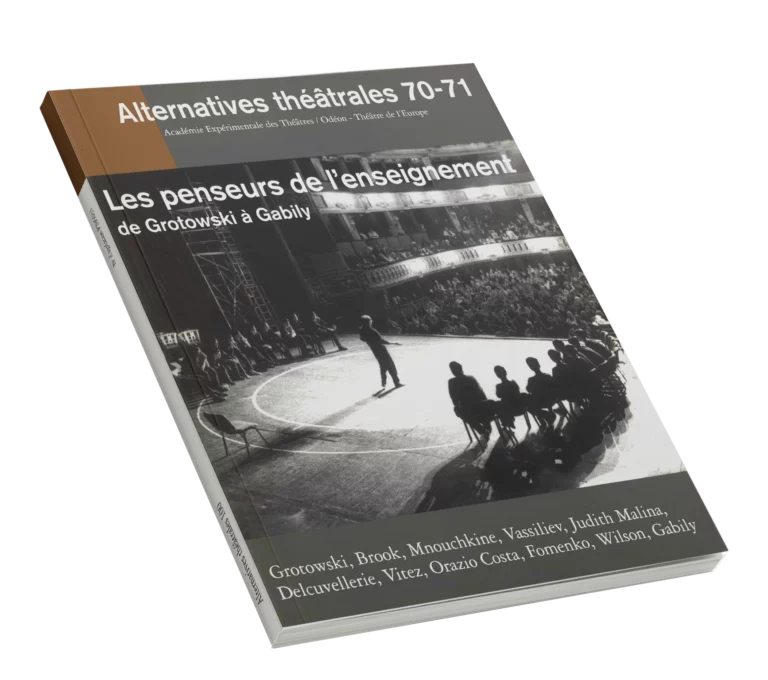Laisse le possible à ceux qui l’aiment.
G. Bataille
CELUI QUI M’A ENSEIGNÉ l’Art d’enseigner l’Art du théâtre est bien vieux maintenant. Lors d’une visite récente, il m’a parlé plus longuement. Comme aux premières années. Parfois, là où il me semblait qu’il pouvait la prévoir, je posais une question.
Je sais qu’il ne renierait pas les termes naifs dans lesquels je rapporte ses propos :
Hier, soirée vide, je regarde la télévision. Face à face Marguerite Duras/Jean-Luc Godard, une rencontre n’a pas lieu. Pourtant, derrière les phrases émues mais toujours péremptoires de Duras, sous les sentences hésitantes, pudiques mais également « définitives » de Godard, je perçois l’unité d’un même pouvoir. Ils parlent d’un lieu semblable, d’où jamais l’acteur ne parlera, même l’acteur le plus porté à la théorisation de sa pratique. Tu vois, je sentais cela profondément, mais pourquoi ? Alors, les vieilles évidences me sont revenues. Mes « dadas ».
Tu te souviens de mon séminaire Les hommes racontent des histoires, les acteurs sont des … avec la provocation de sa conclusion en paraphrase : « Un acteur est un acteur est un acteur est un acteur … » ou un saint ? Ce n’est pas le caractère sacré ou non du type de théâtre qu’il pratique qui autorise cette comparaison, c’est la similitude du processus d’apprentissage ça ne s’apprend pas. On peut apprendre les prières et les rites, mais pas la sainteté. Alors : oui, « les hommes racontent des histoires », et ce n’est pas une mince différence, mais l’acteur, même le plus épique, même le cantastorie, fait encore autre chose. Il met ses pieds et ses mains dans certaines positions, il parle comme on ne parle jamais dans la vie et, dans certains styles de théâtre, de telle sorte qu’on dise qu’il joue « naturellement », il fait beaucoup de choses très difficiles que personne ne doit voir, et d’autres qu’il montre à tous. Parfois on dit qu’il est « possédé » mais, même dans le style le plus détaché, dans son corps c’est la voix d’un autre qui se fait entendre, et parfois celle d’une multitude … Apprendre « ça » diffère de toutes les autres formations.
Un écrivain, par exemple, et aujourd’hui un cinéaste, étudient, créent, donc parlent, au sein d’un champ gni, du point de vue d’un mortel, a les dimensions de l’universel. Tout écrivain peut étudier ses ancêtres créateurs en remontant au moins jusqu’à la Bible. Un auteur aussi moderne que Pierre Guyotat prend évidemment en compte l’écriture biblique aussi bien qu’il bénéficie des aventures de Joyce à travers FINNEGANS WAKE. Il intègre ainsi en un geste créateur personnel plusieurs milliers d’années d’expérience. Cette connaissance existe aussi à travers l’espace. Tu sais Claudel influencé par les Japonais, ou Brecht par la « série noire » américaine. Et la promesse du retour existe : on peut étudier Duras à Tokyo et New-York, les livres y parviennent. Même pour l’auteur « maudit » la promesse existe, dans l’acte même d’écrire matériellement, que la trace puisse être un jour reconnue. Ainsi, sous la parole de Duras, consubstantiel à ses phrases faites de souffle et de mouvements subtils de langue et de glotte, quelque chose de dur résonne qui dit : « Parlant depuis des siècles, j’énonce en cet instant pour un vaste prochain et pour les siècles des siècles ».
Ne crois pas que j’exagère. S’ils ne pensaient … Non, s’ils ne sentaient pas ainsi, viscéralement, je ne crois même pas que l’acte d’écrire leur serait une tentation. La « nécessité », le besoin irrépressible, la vocation d’écrire, celui qui s’y consacre n’en perçoit que l’obligation intérieure à l’instant, mais elle ne le saisirait pas sans le savoir implicite qu’il a de la condition d’écrire, qui est précisément celle-là.
Et le cinéaste, c’est pareil ?
Non, évidemment, mais cela ils le partagent. Tout le cinéma, de Mélies à Godard, de Vertov à Jarmusch, est connaissable par expérience directe. Les films sont là. Le corollaire aussi, toute oeuvre peut espérer une reconnaissance contemporaine ou ultérieure, proche ou étrangère. Et donc, tout autrement, si on le force à parler (mais c’est déjà très différent de l’écrivain, plus biaisé dans le recours aux mots), le cinéaste parle dans l’ordre des Tables de la Loi. Qu’il bégaie n’y change rien.
Alors, une fois de plus, vous ne différenciez l’acteur que par le caractère éphémère de son art ?
Pas du tout. Tu as déjà oublié le début de notre conversation … Mais que son art soit définitivement situé dans l’ici et le maintenant, voilà une évidence brutale dont nous ne sommes pas si nombreux à éplucher les conséquences. Retourne au plus simple pense à tous ces jeunes acteurs que tu as formés. À combien de générations pouvaient-ils se référer, par expérience directe, pour tenter d’inscrire leur création propre ? Un acteur de vingt ans peut, au mieux, voir jouer quelqu’un de l’âge de Minetti. Marie Marquet avait connu les grands acteurs du XIXe siècle et nous avons vu Marie Marquet. La transmission au deuxième degré ne remonte pas au-delà. Ainsi l’art de l’acteur dont les racines plongent au-delà de l’écrit et peut-être au-delà de la tradition orale laisse-t-il chaque génération dans la connaissance la plus étroite de son héritage spécifique. Or, comme tu le sais, aucun autre art n’a davantage besoin de l’expérience directe. Le texte de Sophocle est accessible tel quel. Rien des acteurs de l’époque ne subsiste, rien de leur art, sinon ce qu’on croit en pressentir au travers des textes, des masques, des bribes de témoignages et des résidus d’architecture. Une exaspération du désir, le meilleur usage qu’un acteur puisse en faire. Et dans cette étude, il comprend très vite que son art personnel connaîtra le même sort. Pas de deuxième chance, pas de signe dans les siècles des siècles.
Le cinéma a changé les données l’acteur fait désormais partie des arts de la trace, non ?
Lui, oui … mais pas son art ! Réfléchis bien à cela. D’ailleurs, aussi scandaleux que cela te paraisse, je dirai que le cinéma n’a pas besoin d’acteurs. Pas du tout. Que de vrais acteurs s’y soient illustrés, j’en conviens, mais je propose de laisser tomber la question du cinéma ce soir. Tu verras après si c’est un pur artifice ou non …
Le confinement dans l’espace est de moins en moins strict ; les troupes voyagent, et d’ailleurs ne l’ont-elles pas toujours fait ?
Ah oui ! La belle histoire, encore à écrire, des malentendus. Celui d’Artaud avec les Balinais, inspirant, et celui, stérile et réducteur, du public français avec les comédiens italiens quand ils sont revenus au XVIIIe siècle. Oui, on voyage, et parfois cela donne des choses. Grotowski, Barba, Schechner, ont beaucoup étudié les Orientaux. La fin des Orientaux très exactement puisque même le Kathakali ou l’Opéra de Pékin sont rendus minoritaires par la culture urbaine, dont le cinéma, et ils en sont secoués de l’intérieur dans leur langage même. Mais si la circulation d’influences est plus grande, la création d’un acteur n’est toujours accessible qu’à quelques dizaines de milliers de personnes réparties sur deux ou trois générations et sur quelques continents, dans les grands cas. Par contre, l’image de synthèse permet déjà d’envisager de nouveaux films avec Bogart ou Marilyn et, pourquoi pas ?, de les faire coucher ensemble ! Que le cinéma puisse se passer des acteurs et que le théâtre …
Vous ne divaguez pas un peu, non ?
Soit. Alors voici l’essentiel si, en Occident, l’art de l’acteur, resté le plus archaïque de tous, s’appuie sur une connaissance directe très étroite, et une connaissance indirecte (livres, photos, traces diverses) indispensable mais insaisissable dans ses effets réels, alors, mon fils, le théâtre reste nécessairement le dernier endroit où l’apprentissage professionnel transite par ce très vieux système la relation Maître-Élève.
Même s’il s’agit partiellement d’un leurre, même si, dans les plus mauvais cas, c’est d’une utilité purement symbolique, le Maître est chargé par l’Élève d’incarner pour lui cent mille générations d’acteurs à jamais inconnaissables.
Face à ce paradoxe constitutif de son art « Rien pour toi d’essentiel ne peut être appris d’autrui que par expérience directe ; or, l’art de ceux qui t’ont précédé est mort avec eux », l’acteur n’a de ressource qu’à se remettre entre lé!s mains d’un Maître qu’il investit de la fonction suivante : « Toi, je puis te rencontrer vraiment, sois pour moi le signe de tous ceux qui nous ont précédés. Apprends-moi ».
Alors, bien sûr, il n’y a pas qu’une manière d’interpréter cette première fiction où s’inscrivent Maître et Élève, d’où les différentes « méthodes » … mais retiens bien ceci : si le Maître se dérobe à cette discipline, s’il feint — lâche ou prétentieux — de jouer un autre rôle (copain plus expérimenté, par exemple, ou inversement exemple à copier servilement), ou si l’Élève est assez sot pour ne pas reconnaître qu’en se constituant Élève il s’est situé d’emblée dans ce rapport d’investiture d’un Maître, alors rien ne peut s’apprendre. Rien de vrai, de vivant, rien d’ « artistique » comme disait Stanislavski. Il n’y a pas d’exception à cette règle. D’excellents spectacles sont portés par des collectifs, avec toujours cependant une distribution inégale du pouvoir, et il s’y apprend des choses. Oui. Mais pas la formation de base d’un acteur.
Jamais.
En admettant votre point de vue, à quoi se ramène une bonne relation Maître-Élève aujourd’hui ? Je veux dire qui ne peut rester semblable à celle, absolue, des maîtres orientaux, ni même à celle pratiquée à l’époque de Jouvet ?
Pour moi, ce qui ne change pas c’est ceci l’Élève doit se taire, le Maître ne doit pas parler.
Mais dans vos cours, nous parlions beaucottp, tous !
Et vous encore plus !
Pas toujours. Souviens-toi …
Oui, il y avait ces grands ateliers « Hic et Nunc » de plusieurs semaines où nous n’avions pas droit à la parole. Mais vous les annonciez justement comme des périodes exceptionnelles, où cette dictautre nous obligeait à faire énergie de tout ce qui nous arrivait sans pouvoir nous en débarrasser par aucun entretient sécurisant. C’était l’exception !
L’exception n’était qu’une forme concentrée de la pratique plus quotidienne de notre relation. C’est très paradoxal, mais le fond de l’affaire c’est que si vous parliez, j’étais extrêmement attentif à vos paroles mais que jamais, en réalité, vous n’y aviez « droit » …
Je vois que tu ne comprends pas. Prenons-le autrement. Le Maître n’enseigne pas au sens transmettre un savoir acquis. Ça, c’est pour les formateurs de singes. Son rôle c’est placer à chaque moment l’Élève dans une épreuve (au sens très fort, où l’on peut se briser), et lui donner une chance de s’en sortir par lui-même. Je veux dire en étant dans la contrainte impérative de créer ses propres moyens de s’en sortir, donc d’assimiler réellement l’épreuve. Dans ce sens, je te le dis en sachant très bien toutes les ambiguïtés que cela éveille aussitôt c’est un processus voisin de l’initiation.
Ils te l’ont tous répété les rites initiatiques des sociétés non-fossilisées ne sont pas des séries d’actes à reproduire. C’est une véritable épreuve où l’on peut mourir et où, si votre formation a été bonne, une chance existe de trouver la réponse, c’est-à-dire l’acte juste.
Une identité.
Ce qui différencie notre apprentissage de ces initiations, c’est qu’un rituel d’épreuves fixes, identiques pour tous, n’a aucun sens pour la formation de l’acteur. Il faut même, au contraire, créer des situations où c’est l’acteur qui décide du degré de risque auquel il consent. Avec un Maître, il sait que le choix d’un risque inférieur à ses capacités le disqualifierait plus que tout échec.
Le jardinier d’acteurs sait bien qu’on ne fait pas pousser les fleurs en tirant dessus. Il fonde son pari là dessus parce que c’est vrai : « Tu sais plus que tu ne sais. Il y a plus en toi, acteur, et c’est la meilleure part, que ce que tu peux tenter d’en dire. « Le problème n’est donc jamais de « dire » mais de bien « chevaucher le tigre ». C’est-à-dire d’inventer au fur et à mesure les règles de maîtrise de ce qui nous mène et qu’on ne connaît pas, qui pourrait vous détruire, qui doit risquer de vous détruire, et qu’on surpasse sans cesse.
Je dis : « Il y a dans la mémoire de tes muscles et de tes nerfs une part unique, singulière de « l’âme historique » présente. C’est cela, non pas le talent, mais ton talent ».
Celui qui n’aide pas l’acteur à accoucher progressivement, toute sa vie, de cela, ne l’aide pas à le découvrir et le développer ensuite par lui-même (grâce à d’autres techniques), celui-là ne forme pas d’acteurs.
D’ailleurs …
Excusez-moi, mais je reviens sur quelque chose dont vous avez fait image tantôt, je ne sais pas jusqu’à quel point. La formation de l’acteur n’implique pas le danger mortel ?
Oh si, bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui se tuent, il y en a, mais je trouve mortel, pour un vrai talent, le risque d’abandonner ou de prendre la voie du tricher toujours. Entre son désir constitutif de reconnaissance publique et l’amour du théâtre, la voie étroite et souvent obscure, l’acteur qui n’apprend pas bien peut devenir fou, ou aigri, ce qui est aussi une « mort ».
C’est pourquoi vous commenciez tous vos discours d’accueil aux nouveaux élèves par le fameux : « Il est encore temps de partir » ?
Hmm … Une ficelle un peu grosse, je le reconnais. Mais enfin, déjà une petite « épreuve ». Au reste, j’aurais mieux fait de ne rien dire. À quoi sert d’annoncer à un débutant que statistiquement, le plus probable, c’est le chômage ? C’est vain. Il le sait, mais il ne le croit pas. Tu vois, dès que le Maître doit parler, c’est qu’il y a une insuffisance dans son art d’enseigner.
Bon. Allons‑y. Le maître ne parle pas. Que fait-il, alors ?
Il fait en sorte que, pour la vie entière, tout, pour l’acteur, soit toujours « comme si » c’était la première fois.
« Comme si » … Le travail sur la mémoire intérieure de Stanislavski ? Revivre les émotions les plus originelles possibles ?
Non. Ou plutôt, pas seulement… Mon propre Maître disait souvent : « Stanislavski n’a pas tout dit, tout exploré, mais il a tout si tué ».
Son idée était qu’il nous arrive bien de découvrir et d’explorer quelque chose de nouveau, mais toujours à l’intérieur de la géographie instituée par Stanislavski. C’était très restrictif, mais généralement vrai à cet endroit du monde. Simplement, à mon usage, je me suis fixé deux tâches.
À jamais la première fois, j’y reviens. C’est le grand travail sur les émotions.
Ne te méprends pas, j’y inclus tout ce qui concerne l’observation, la reproduction-transposition du réel. Si tu prends les exercices de Bertolt Brecht sur le jeu narratif, ils ont d’original le privilège qu’ils accordent à la reproduction stylisée du « réel ». Mais ce qui fait qu’un acteur te touchera suffisamment en profondeur pour que cela t’ « étonne » jusqu’à te faire réfléchir, pour que l’effet‑V fonctionne, cela passe nécessairement par la qualité émotionnelle de ce qu’il a ressenti en observant, d’abord, en le rejouant dans son corps et sa voix, ensuite. Si cette fraîcheur disparaît, il reste la démonstration laborieuse, pas le théâtre. Bertolt Brecht était un sensuel de l’intelligence. Que les choses restent vivaces en toi « comme si » c’était la première fois, cela passe par la plongée de l’Élève dans des expériences très douloureuses.
Principalement.
Dans vos cours, vous parliez souvent du plaisir …
Y a‑t-il un plus grand plaisir que les alexandrins de Phèdre, pourtant expirante ? Y a‑t-il rien de plus douloureux que les pitreries de Sganarelle tentant de conjurer l’impiété de Don Juan ? Que l’art, c’est-à-dire la maîtrise incertaine, transcende toujours une grande souffrance, c’est une banalité. Mais dans la pédagogie, ce n’est pas vraiment admis. Disons même de moins en moins.
Et la deuxième grande tâche du Maître, c’est quoi ?
D’abord je voudrais que tu comprennes bien le premier point. Tout ce que cela implique de physique. Quel intérêt de veiller à la relaxation, par exemple, si ce n’est pas pour favoriser cette éternelle fraîcheur de la première fois ? Les corps bloqués n’exposent que leur propre travail. Pense à tous ces acteurs qui se dépensent sur scène et dont le premier message, avant les vraies larmes qu’ils versent ou les cris qu’ils poussent, tient simplement à ceci : « J’essaie de faire le mieux possible ». Rien n’est plus insupportable.
Mais justement, dans le moment où les choses adviennent « pour la première fois », on ne les maîtrise pas. La joie, la souffrance ou la surprise vous emportent. Il n’y a pas d’intelligence de l’expérience. Un théâtre des « premières fois », n’est-ce pas une succession d’agitations stériles ?
Bien sûr. Nous savons qu’il s’agit d’une fausse première fois mais « comme vraie ». Toute proportion gardée, mais je n’ironise pas, il faut entendre l’appel de celui qui disait : « Si vous ne devenez semblables à ces petits enfants … » Dans l’enfance, sans avoir la maîtrise de ce qui arrive, l’être doit survivre. L’enfant n’est jamais prêt. Le gosse de quatre ans battu par un parent sadique n’est pas « prêt ». Celui qui perd sa mère très jeune n’est pas « prêt ». Celui qui tombe à dix ans amoureux d’un professeur dont les orientations personnelles vont peutêtre conditionner toute sa vie non plus … Vont-ils en mourir ou intégrer l’épreuve ? Rien n’est plus ennuyeux que ces spectacles où tout le monde est « prêt ». Ils ne sont évidemment « prêts » à rien puisque rien d’inconnu n’est à affronter. Tout est derrière eux. Ce qui est à pleurer c’est qu’en ce cas précisément on ose dire qu’ils ont du « métier ».
Ce que vous venez d’expliquer, ça s’applique vraiment à toute la formation de l’acteur ? N’y a‑t-il pas des parties purement techniques ?
Aucune. Je vais te donner un exemple qui a une importance considérable dans la formation dite « traditionnelle » : la diction. Le but de l’apprentissage de la diction n’est pas du tout de parler expressivement une langue pure, mais de faire en sorte que la langue à jamais soit neuve dans la bouche de l’acteur. À jamais la langue « comme pour la première fois », voilà le but. Pour cela, il faut une « première-fois-de-la-langue » dans la bouche de l’acteur. Une révélation étonnée des pouvoirs du verbe, par sa bouche à lui. Alors, bien sûr, ce ne peut être celle de sa naissance, de son enfance, de l’habitude. Pour qu’une « première fois » existe, il faut défaire dans l’art de jouer la langue acquise et trouver cette autre langue, artificielle mais si proche, qu’on parle sur la scène.
En défaisant les impuretés, les limites respiratoires, les contractions, en élargissant la tessiture, etc., on crée des chances pour une autre vérité de la langue dans les organes de l’Élève. Dans les traditions orientales, c’est plus clair — comme pour les chanteurs. En Europe, une part importante du métier consiste à parler « comme si » c’était dans la vie quotidienne, alors la création d’une « première fois de la langue » est plus délicate. Mais sans elle, pas d’art, pas d’acteur. Les voix de Sarah Bernhardt, de Jouvet, de Cuny, de Blin ou de Bouquet sont d’éternelles « premières fois », comme le masque lorsqu’il est réussi, c’est-à-dire transcendé par l’acteur qui l’accepte.
La capacité de recréer la « première fois » était pour vous une des deux grandes tâches du maître, la …
Cela s’applique à lui aussi, évidemment !
Méfie-toi de tout ce que je dis ce soir. Rien de tout cela ne peut te servir directement. Bien sûr, tu as avantage à imiter d’abord. La vieille pratique des peintres qui consistait à faire copier les élèves n’est pas sans pertinence. Copier c’est non seulement imiter, mais c’est surtout mesurer sa différence. Tu peux copier, c’est utile. Mais tu ne peux rien reprendre. Maintenant que tu enseignes à ton tour, je te le dis tu n’enseigneras jamais rien mieux que ce que tu découvres en même temps que ton élève.
Et la seconde grande tâche ?
C’est faciliter l’intelligence historique. Oui.
N’ayons pas peur.
Au sens marxiste, comme Bertolt Brecht ?
Si tu veux, mais il ne faut pas le déranger pour ça. Il y a des acteurs très populaires qui sont de bons acteurs, ils illustrent généralement des types sociaux assez précis et leur succès vient de la reconnaissance de cette typologie par le public.
Mettons Bourvil, par exemple. S’il n’y a pas d’intelligence historique de leur art, s’ils laissent donc l’outil expressif dans l’état où ils l’ont trouvé, leur « oeuvre » ne peut inspirer. Leurs personnages meurent avec eux, et c’est très bien ainsi.
Qui, par exemple, n’a pas fait cela ?
Tous ceux qui ont lié leur création à celle d’une nouvelle aventure du théâtre. On peut admirer Bourvil, on ne s’en inspire pas. L’acteur avant ou après lui, c’est pareil. Pour s’engager dans la même voie que lui, il n’y a pas besoin de lui. Un acteur de ce type dira qu’il aimait Bourvil ou Fernandel, mais s’il reprenait leur « oeuvre » le succès populaire ne serait même pas au rendez-vous. Il n’en va pas de même pour Karl Valentin, pas entièrement. L’intelligence historique … Et il n’en va pas de même pour Dario Fo, Julian Beck, Hélène Weigel, ou Richard Cieslak.
Que l’intelligence historique d’un acteur passe par la réflexion sur les conditions générales de production de son art, cela ne lui est pas propre. Mais plus que pour les « artistes de la trace » cela implique sa participation à une aventure fondatrice.
Est-ce qu’il n’y a pas un grave danger à un enseignement qui prescrive aux acteurs une telle ambition ? Après avoir suivi vos cours, plusieurs se sont lancés dans la fondation de petits théâtres « créateurs ». La plupart ont disparu très vite et sans laisser, non plus, de traces.
Qui peut dire avec certitude où resurgira la « trace » ou l’ « ombre » dont parle Eugenio Barba ? 1
Si ceux-là devaient ne pas laisser de trace dans une pratique autonome, je doute qu’ils eussent été plus doués pour le théâtre « traditionnel » … J’ai formé aussi quelques acteurs qui s’accommodent parfaitement du système dominant. J’en connais qui jouent presque uniquement du vaudeville, et très bien. Je ne crois pas qu’ils aient à se plaindre des jours où je leur ai jeté dans les pattes Heiner Müller ou Peter Brook. Les meilleurs sont restés assez malicieux.
Alors, vraiment, vom n’avez jamais tué personne ? ( Ici, le vieux fit une longue pause. Pendant cette minute, je ne sus pas exactement s’il ménageait un effet ou si, réellement, il se recueillait pour une réponse méditée. Il avait toujours su préserver une part de cabotinage séduisant, mais c’est quand on croyait le prendre sur le fait que l’attaque la plus vive surgissait au milieu de toutes vos défenses. Aussi, jouant mon rôle, je me tus. Finalement, il dit : )
Il n’y a rien dans la morale que je me suis bricolée durant toutes ces années qui puisse me préserver de tout soupçon. À dire vrai, si l’on prouvait ma responsabilité dans l’échec de ceux qui sont restés sur le carreau, je ne l’admettrais pas. Mais il me serait tout aussi difficile de la nier. Car, plus grave que tout, m’apparaîtrait la faute de l’indifférence de notre rencontre, à eux et à moi. Aussi, sans doute parce que je ne suis pas encore aussi vieux que tu le crois, c’est-à-dire parce que j’ai encore des projets, je préfère ne pas y penser. Oui, tout simplement ce n’est pas important !
Plissant les yeux, il disait cela si gravement que je ne pud m’empêcher de rire aux propos de l’espiègle vieillard. Et comme je le sermonnais sur la flexibilité excessive de sa morale, il voulut répliquer et brandir un livre.
Non ! dis-je, non ! Vous êtes cuit ! Votts avez avoué ;
Vae victis ! Et toute cette sorte de choses …
Mais je voulais juste te lire une histoire, dit-il. Elle devrait tempérer ton enthousiasme. Écoute dans ce petit livre devenu rare, consacré à Stanislavski, Nina Gourfinkel rapporte un souvenir de Mm, Lioubov Gourévitch venue visiter le maître à Moscou en 1920 : « Nous parlâmes longuement de choses et d’autres. Mais lorsque je lui demandai sur quel rôle il se proposait de travailler, son visage s’assombrit soudain : « Je ne peux plus aborder aucun nouveau rôle … articula-t-il. Mais vous l’ignorez encore … » Et il se mit à raconter, par saccades, qu’en 1917, pendant la préparation du VILLAGE STEPANTCHIKOVO où il jouait l’oncle Rostaniev, tout en travaillant à la mise en scène avec Némitovitch-Dantchenko, ce dernier lui fit une réflexion, pendant une répétition, après quoi il lui fût impossible de continuer à préparer son rôle, et il fut remplacé par un autre acteur : « Vous comprenez, je n’ai pas accouché du rôle. Depuis, je ne peux plus jouer » — Je l’entends encore prononcer ces mots extraordinaires « Pas accouché du rôle ». Sa voix était sourde, ses lèvres tremblaient. Même alors, il ne proféra aucun mot dur, aucune plainte à l’adresse de Vladimir Ivanovitch, mais il était impossible de ne pas éprouver son mal, de ne pas sentir que son âme avait reçu une blessure inguérissable. Ni à ce moment, ni plus tard, je n’osai le questionner … »
Comme tu sais, Némirovitch-Dantchenko et Stanislavski avaient jeté ensemble les bases du Théâtre d’Art lors d’une nuit légendaire, le 22 juin 1897. Depuis vingt ans ils travaillaient côte à côte. C’était Stanislavski qui avait crée en 1891 le VILLAGE STEPANTCHIKOVO dans sa propre et excellente adaptation du roman de Dostoïevski. Le rôle du colonel Rostaniev était, disait-on, le rôle qu’il préférait de toute sa carrière d’acteur, avec celui du Dr Stockmann, et il y avait remporté un succès considérable … Or, en 1917, Némirovitch-Dantchenko voulut imposer à Stanislavski une conception radicalement différente du rôle. Au lieu d’un homme pur, noble et bon, il en fit un vieux butor de soldat en retraite. Stanislavski en fut profondément blessé mais fit l’impossible, de tout son talent, pour y parvenir. En vain. À la veille de la première, Némirovitch-Dantchenko le fit remplacer. L’acteur Verbitski raconte : « Lorsque, après la générale du VILLAGE STEPANTCHIKOVO, Némirovitch-Dantchenko reprit à Stanislavski le rôle du colonel Rostaniev pour le confier à Massalitinov, les acteurs, horrifiés, retinrent leur souffle dans l’attente de ce qui allait se passer… Et bien, il ne se passa rien. Sans proférer un mot, Stanislavski se soumit à l’autorité du metteur en scène, bien qu’il considérât le personnage du colonel comme son meilleur rôle … Nous n’entendîmes de lui ni murmure ni protestation ».
Et une autre actrice, Madame Birman, complète ainsi l’histoire : « Un souvenir encore, le principal Constantin Sergueïévitch, complètement maquillé, répétait le rôle du colonel Rostaniev. Quelque chose pesait lourdement sur son travail. Au cours des générales, il faisait retarder le lever du rideau il pleurait. Impossible d’oublier ces larmes. Bien qu’il eût paru dans plusieurs générales, ce n’est pas lui qui joua ce rôle ».
Est-ce que tu sais le plus beau ? Aucun des deux hommes ne souffle un mot de cet incident dans ses souvenirs et tous les témoins attestent qu’extérieurement, en 1920, leurs rapports semblaient inchangés. Pourtant, durant ces trois années, Stanislavski avait refusé de créer tout nouveau rôle, et sa voix tremblait encore en racontant l’incident à sa visiteuse …
Je n’ai jamais pu lire cet épisode sans que les larmes ne me viennent, de manière incontrôlable. Non pas, tu t’en doutes, dans un apitoiement quelconque sur les malheurs de la création stanislavskienne, mais dans le tremblement qui nous saisit à l’approche de quelque chose de véritablement grand. Comme si, dans cette histoire, l’essentiel, indicible, se disait sur l’art de l’acteur, que rien ni personne ne pourrait formuler mieux qu’en rapportant cette fable, d’un échec.
Il n’y avait plus rien à écouter et je pris rapidement congé. Filant par le jardin, je glissai encore un oeil dans la bibliothèque le vieux avait rallumé la télévision … Dans la nuit froide et belle, une fois de plus, je n’avais rien à faire. Absolument rien. Je connaissais par coeur la fin de l’histoire :
Le 7 août 1938, jour de sa mort, Stanislavski, à demiconscient, demanda soudain : « Mais qui donc s’occupe de Némirovitch-Dantchenko ? Il est maintenant comme une voile blanche solitaire 2 … N’est-il pas malade … Ne manque-t-il pas d’argent ? ».