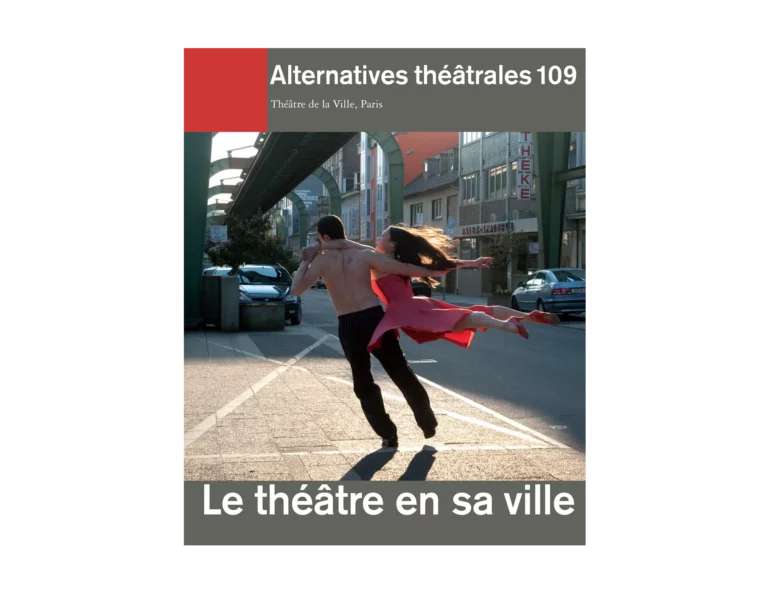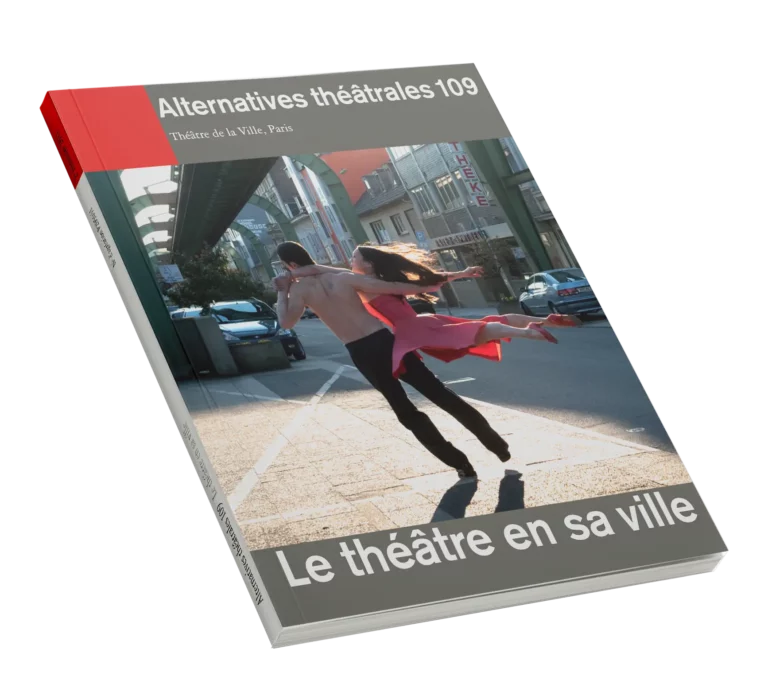Bernard Debroux : Serais-tu d’accord de dire que le Théâtre de la Ville pourrait être présenté comme le lieu de l’expression de la multiplicité des arts dans la ville ?
Emmanuel Demarcy-Mota : Des arts vivants, oui, je suis d’autant plus d’accord que cela correspond à la définition qu’en a donné Jean Mercure, le fondateur du Théâtre de la Ville en 1968 : « l’art dans la diversité de ses formes, théâtrales, chorégraphiques et musicales ». L’alliance des arts et des forces vitales de la création contemporaine, dans toutes les disciplines, fonde le caractère unique du projet du Théâtre de la Ville, celui d’une trajectoire que nous souhaitons défendre : un théâtre de notre temps, ouvert au monde entier et à ses inventivités artistiques, résolument ancré sur l’accompagnement des artistes. C’est une idée importante, non seulement parce qu’elle est fondatrice de l’identité du Théâtre de la Ville, mais aussi parce qu’elle correspond à ce qui m’anime dans la direction de ce lieu : un théâtre qui cherche à réfléchir sur l’identité de chaque discipline, leur évolution historique, et surtout les liens qui peuvent se créer entre elles. C’est pourquoi je crois que ce que nous développons aujourd’hui s’inscrit dans une continuité de conviction, tout en cherchant à inventer des dramaturgies plurielles. J’aime observer et accompagner des mouvements artistiques divers, comprendre comment le Théâtre peut être poreux à la danse, aux arts plastiques, comment les autres arts participent à l’art théâtral… C’est aussi cela ma joie depuis deux ans. Il y a aussi quelque chose qui vient de plus loin pour moi, dans mon goût pour la question des arts dans une ville, des liens entre des artistes et une ville. Si un théâtre arrive en lui-même à travailler sur cette pensée, à l’accomplir et à la développer, alors il est, je crois, capable d’inventer une aventure nouvelle à partir de son époque.
Sylvie Martin-Lahmani : On parle beaucoup aujourd’hui d’hybridation des arts, de transdisciplinarité…
B. D. : …d’interdisciplinarité… de synergies…
E. D.-M. : Ce sont des catégories un peu scolastiques. Hybridation, pourquoi pas… J’aime le mot théâtre, j’aime le mot danse et j’aime le mot musique. Et dans le même mouvement, je revendique une extrême attention à ce que j’ai appelé « les intersections », et que nous défendons, précisément pour rendre visible cet « art des intersections ». Je me réjouis particulièrement de partager avec d’autres artistes la volonté de modifier les frontières entre les arts, en inventant chaque fois de nouvelles modalités et de nouvelles formes de leurs rencontres. Un artiste authentique, je crois, est tout a fait capable de refonder sa discipline. Mon père, auteur-metteur en scène, m’a donné le goût de l’espace, du temps de l’écriture scénique. Ma mère, comédienne portugaise, m’a appris l’amour d’une langue, d’un poème. J’ai été élevé dans ce rapport à l’art. Mon adolescence est passée par une ouverture à toutes les formes de théâtre et de danse. Je pense à EINSTEIN ON THE BEACH de Bob Wilson ou aux spectacles de Tadeusz Kantor, aux ballets de Maurice Béjart, de Merce Cunningham… Pour moi c’est une évidence que le théâtre ne veut pas dire uniquement le texte ; que la danse ne veut pas dire uniquement le ballet classique. Il n’y a pas qu’unthéâtre, il y a des théâtres. Par exemple, dans le dernier spectacle de Patrice Chéreau, RÊVE D’AUTOMNE de Jon Fosse que nous avons présenté, la question qui se pose sur les corps vivants ou morts est centrale. Et en un sens, à travers l’arrivée muette de Michelle Marquais au début du spectacle, habillée de blanc, pieds nus, on peut rêver à une trace de Pina Bausch. J’ai toujours cherché, déjà lorsque je dirigeais la Comédie de Reims, à étendre cette « constellation des singularités », toujours pensé que la perméabilité entre les arts devait être interrogée, parce qu’elle est une question posée à l’art scénique, à l’art vivant. Autant de sujets qui me passionnent. Quand à la question des « catégories », je pense qu’elle doit d’abord être renvoyée à l’artiste lui- même, plus qu’au programmateur. Si on parle avec Jan Fabre, est-ce qu’il fait du théâtre ou est-ce qu’il fait de la danse quand il fait telle œuvre ? Lui-même répond que cela dépend des projets. Et il ne veut pas que ce soit mis en interdiscipline ou en mélange des genres. Il dit : « non ça c’est du théâtre », « ça c’est de la danse ». Parce que la conception qu’il a du théâtre, lui aussi, n’est pas restreinte à la présence ou non du texte, du mouvement, l’acteur ou du danseur. Donc ça déborde, si je puis dire. Il est intéressant de remarquer qu’en France, au Portugal, en Angleterre, en Allemagne, une nouvelle génération d’artistes semble être à nouveau encline à des expériences collectives, à partir du plateau plus que du seul texte. Ce que Witkiewicz appelait dans les années trente « la logique interne du devenir scénique ». Si on évoque Va Wölfl, le chorégraphe et plasticien allemand qui est venu cette saison pour la première fois au Théâtre de la Ville, c’est un artiste, formé aux arts plastiques et qui se situe, aujourd’hui, comme chorégraphe. Mais c’est bien le lien entre arts plastiques et chorégraphiques qui est vivant chez lui.
S. M.-L. : Jusqu’à quel type de formes es-tu prêt à ouvrir le Théâtre de la Ville ? Parce qu’on y voit du théâtre de marionnettes, des formes qui empruntent au cirque, etc. Est-ce qu’il y a vraiment une politique d’ouverture à toutes les formes ? Y compris dites « mineures » ?
E. D.-M. : Je n’aime pas l’expression « formes mineures ».
S. M.-L. : Moi non plus, mais il est courant d’opposer les arts « mineurs » aux arts « majeurs ».
E. D.-M. : Tant que c’est vivant, je prends ! Je laisse ce qui serait mort. Or rien de plus vivant que les marionnettes, le cirque. Si un acte artistique est à l’origine… Et je peux penser, avec Kleist ou même avec Vitez, que les marionnettes ne sont en rien un art mineur. Et si on aborde la question des différentes formes, de la marionnette… je crois qu’il est intéressant de revenir aussi à la question des espaces et des lieux. La reconstruction du Théâtre de la Ville en 1968 est influencée par le colloque de Royaumont de 1963, « le lieu théâtral dans la société moderne ». Jean Mercure avec les deux architectes Fabre et Perottet et le scénographe René Alliot souscrivent à l’idée d’un nécessaire abandon de l’architecture théâtrale classique, dite « à l’italienne » et recherchent des formes nouvelles. Jean Mercure dit que si l’on veut plusieurs disciplines artistiques dans un même lieu et inventer un projet de théâtre populaire, il faut supprimer la « ségrégation du public » dans la salle et permettre une scénographie contemporaine. Démocratisation de la salle et ouverture de la scène. En créant un espace unique regroupant la salle et la scène passant par la suppression du cadre de scène et la création d’un grand gradin de mille places. Tout cela correspond à une idée démocratique de l’art théâtral, reliée à la vision politique d’un théâtre qui occupe une place importante dans sa ville. Ces deux points sont joints : la question de l’architecture du Théâtre de la Ville et la diversité des formes. Les travaux qui sont faits ici en 1967 – 68 datent de quelques années avant ceux de Chaillot. Ce sont les mêmes architectes qui vont contribuer à inventer la MC93 de Bobigny, le Théâtre de Sartrouville et plus tard le Théâtre National de la Colline. C’est toute une pensée, qui est spécifique à l’architecture théâtrale à Paris. Tout ça est organisé par une volonté par laquelle le Théâtre de la Ville va s’inscrire dans l’Histoire récente. C’est assez fascinant…
B. D. : Un lieu de théâtre est porteur de mémoire. Le Théâtre de la Ville est aussi le théâtre de Sarah Bernhardt, le lieu où s’est déroulé le Théâtre des Nations. J’ai pensé à ce rapport à la mémoire en me disant que cela t’avait peut-être guidé dans ton choix d’inviter le Berliner Ensemble dans le cadre des Chantiers d’Europe…
E. D.-M. : Le choix premier était aussi de retrouver sur le grand plateau, face à mille personnes, le théâtre en langues étrangères (qui en était absent depuis les années quatre-vingt et la mise en scène des NÈGRES de Genet par Peter Stein). La volonté de faire entendre aujourd’hui la part poétique des langues sur un plateau, en invitant la trilogie de Guy Cassiers sur le pouvoir, trois spectacles en néerlandais, aux termes desquels nous nous amusions à entendre les spectateurs dire : « c’est une très belle langue, le néerlandais ! » Je crois profondément que si, sur une scène de théâtre, résonnent plusieurs langues – sans que la langue nationale de ce théâtre cesse d’être célébrée, bien sûr – l’expérience humaine n’en est que plus riche, plus politique et je le dis avec force, plus poétique ! Quant au Théâtre des Nations, bien sûr, cela fait partie de la problématique. Le Théâtre des Nations a été un lieu de formation, de découverte pour toute une génération, un lieu de pensée sur le théâtre et les arts en même temps que sur le monde. Lorsque nous avons participé au lancement du livre PARIS CAPITALE MONDIALE DU THÉÂTRE, LE THÉÂTRE DES NATIONS d’Odette Aslan, Ariane Mnouchkine a rappelé combien cela avait été fondateur pour elle d’être spectatrice au moment du Théâtre des Nations. De découvrir de grandes troupes étrangères, d’appréhender des esthétiques inconnues, de connaître une autre partie du monde à travers l’art théâtral ou chorégraphique.