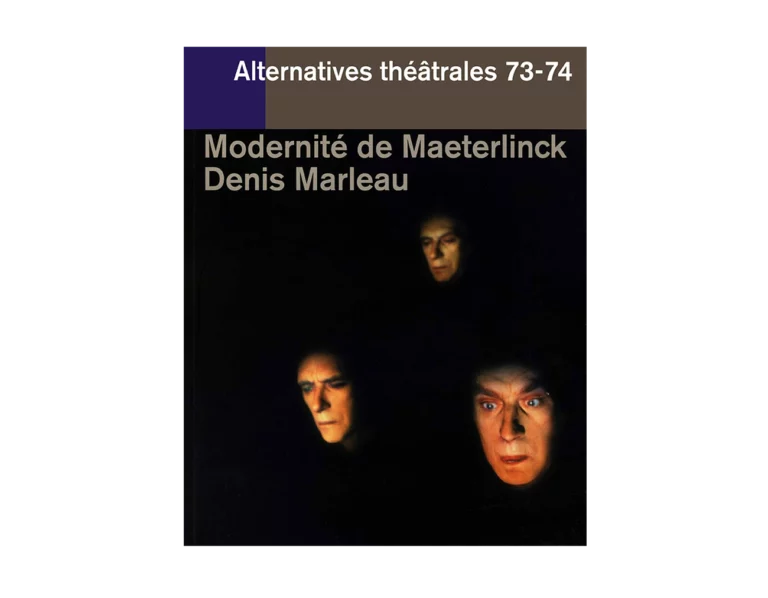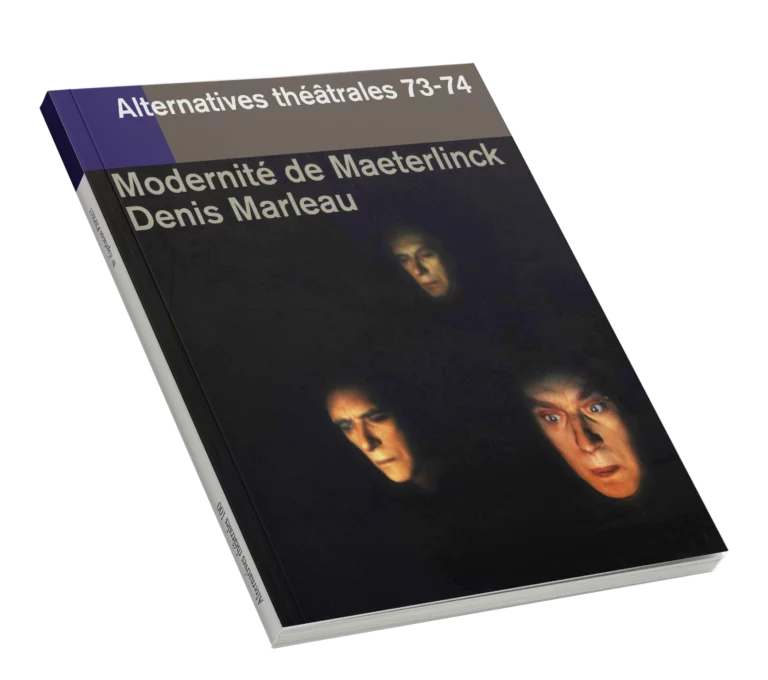L’OISEAU BLEU fut créé à Moscou le 30 septembre 1908, dix ans après LA MOUETTE. Ce rapprochement n’est pas fortuit car Stanislavski découvrit Maeterlinck grâce à Tchekhov1. Comme Meyerhold pour qui « le nouveau théâtre naît de la littérature », Stanislavski, alors à un tournant de son activité, expérimente de nouvelles formes à partir des pièces symbolistes de Maeterlinck (dès 1904 il monte L’INTRUSE, LES AVEUGLES, INTÉRIEUR) et des œuvres de Blok, Andreev, Hamsun, Ibsen, Hauptmann.
En 1904, la mort de Tchekhov et le départ de Gorki pour l’Italie privent le Théâtre d’Art d’auteurs qui ont été des compagnons de route et dont l’écriture lui est devenue familière. Dès lors, le metteur en scène cherche un nouveau souffle, son système de formation de l’acteur est en gestation, il se passionne pour les danses d’Isadora Duncan, l’eurythmie de Jaques-Dalcroze, les travaux sur la psychologie, les improvisations sur canevas selon le modèle de la Commedia dell’arte (il esquissera un projet dans ce sens avec Gorki à Capri durant l’hiver 1911). Il espère découvrir de nouveaux modes d’approche qui lui permettront de monter des auteurs qui lui résistent (Shakespeare) ou des « œuvres irréelles » telle LA VIE DE L’HOMME d’Andreev ou le mystère de Byron, CAÏN.
Pour monter HAMLET, Stanislavski invite Craig et se propose, dans un travail commun sur la mise en scène, d’apprendre auprès de l’artiste étranger, admis du bout des lèvres par les actionnaires du Théâtre. Dans L’OISEAU BLEU, féerie traduite en russe dès 1906 avant que le texte ne soit publié en français, il voit l’occasion d’expérimenter de nouvelles techniques d’éclairage et des procédés illusionnistes qui ne relèvent pas de la machinerie théâtrale traditionnelle2. En testant les effets d’un travail sur le velours noir3, sans rien modifier au processus de travail intérieur de l’acteur, Stanislavski s’aventure dans des voies qui vont s’écarter radicalement du réalisme historique ou psychologique qui a fait jusque-là la réputation du Théâtre d’Art.
Polémiquant avec Meyerhold, dont il a ouvertement critiqué la mise en scène de LA VIE DE L’HOMME d’Andreev, et pas uniquement parce qu’elle concurrençait la sienne4, il estime qu’à partir d’un point de départ commun (exprimer les émotions de l’âme) sa démarche s’oppose à celle de son ancien disciple essentiellement dans le domaine du jeu. Stanislavski n’accepte pas la convention introduite par Meyerhold dans LA MORT DE TINTAGILES par exemple où, visant « l’harmonie presque inaudible des voix », « le tremblement intérieur du frémissement mystique », Meyerhold exige des comédiens une absence totale de tension, un débit sans précipitation, car le « théâtre immobile » de Maeterlinck doit transcender l’humain, pour atteindre une sérénité épique faisant « quitter la terre pour le monde des rêves »5.
Stanislavski s’attelle à un travail colossal qui va rester dans les annales, par sa longévité (la pièce figure aujourd’hui encore au répertoire du Théâtre d’Art, après avoir subi dans les années 1970 une cure de rajeunissement), par les difficultés techniques qu’il a dû résoudre et qui entraînèrent un retard de deux ans dans la programmation, et enfin par la très étonnante reproduction du spectacle en 1911 à Paris, à la demande de Réjane et de Georgette Leblanc-Maeterlinck.
C’est l’histoire des contacts réguliers qui se sont établis entre les Maeterlinck et Stanislavski à propos de la création mondiale de la pièce à Moscou, puis de son exportation-reproduction au Théâtre Réjane que je voudrais retracer ici. Le cas est exceptionnel, Stanislavski n’acceptera la copie de sa mise en scène qu’après beaucoup d’hésitations et parce qu’il n’avait pas vraiment d’autre choix. Seul le metteur en scène tchèque Kvapil sera autorisé en 1906 à monter LES TROIS SŒURS sur le modèle du Théâtre d’Art de Moscou.
Le discours à la troupe
Le 11 novembre 1906, W. Bienstock, traducteur de L’OISEAU BLEU avec Z. Vengerova, demande des nouvelles du projet de mise en scène : Maeterlinck a donné au Théâtre d’Art le droit exclusif de créer le spectacle et de publier la pièce en Russie après la Première. Un retard repousserait la publication de la pièce dans d’autres pays et retarderait la réalisation d’autres mises en scène prévues à Londres, Munich, Vienne et New York. Maeterlinck viendra à Moscou, car, écrit Bienstock, il « a entendu parler de vous et de votre troupe en des termes enthousiastes par La Duse, aussi a‑t-il une très grande confiance en votre intuition artistique ».6
Après quelques essais en mars 1907 (Nemirovitch Dantchenko décrira ironiquement la centaine de comédiens, sélectionnés pour imiter oiseaux et animaux : « Toute cette foule miaulait, aboyait, piaulait, criait, et il était aux anges »), Stanislavski, au début avril, prononce un discours devant sa troupe dont le texte est envoyé à Maeterlinck quelques jours plus tard et dont la traduction paraît dans Le Mercure de France le 15 juin 1907. Le metteur en scène distingue trois objectifs :
– initier tous les participants au mysticisme de l’auteur afin d’«exprimer au théâtre l’inexprimable » : « Le mystère, le terrible, le beau, l’incompréhensible dominent la vie humaine. Ce mystère envahit les êtres pleins de jeunesse et de force, couvre de neige les aveugles vieillards ou nous étonne et nous éblouit de ses beautés. (…) Nous étouffons dans la fange et la poussière de la vie créée par nous-mêmes et, vainement, nous y cherchons le bonheur. (…) Les enfants sont plus près de la nature. » La mise en scène sera composée avec la fantaisie pure d’un enfant de dix ans. Elle sera « naïve, simple, légère, joyeuse et illusoire comme un songe enfantin, belle comme un rêve et en même temps grandiose comme la vision d’un poète et d’un penseur génial ».
– captiver le public : une salle bruyante et irrespectueuse troublerait les visions de Maeterlinck, perturberait la beauté du rêve enfantin. « Il faut détourner la foule de ses préoccupations et la calmer après les fatigues du jour. (…) Aujourd’hui, pour captiver le spectateur, il faut autre chose. Les anciens moyens ne valent plus rien. Ils sont par trop théâtraux. Le théâtre ne veut plus divertir. (…) Heureusement, nous prendrons des moyens nouveaux, différents de ceux de jadis. »
– trouver des moyens scéniques qui ne soient ni grossiers, ni lourdement théâtraux pour représenter des songes, des pressentiments, « délicats comme une dentelle ». « Nous rejetons les décors et les costumes criards et les remplaçons par une peinture simple et des étoffes aux teintes douces ». Stanislavski rejette la théâtralité qui risque de transformer le rêve du poète en une féerie ordinaire. Pour cela il ne réalisera pas à la lettre les didascalies de l’auteur et notamment sa description des costumes qui, sur scène, deviendront vulgaires et choquants : « À la place d’âmes errantes, nous aurons des personnages de mascarade ». Stanislavski, pour sortir des sentiers battus de la machinerie théâtrale, va utiliser des dessins d’enfants.
Cette quête de procédés inattendus afin de donner une illusion complète au public (dans un brouillon du texte, il utilise le terme de obman, tromperie) est associée à un travail d’interprétation « sincère » des personnages de conte (la fée), des objets animés (le pain, le sucre), des éléments (le feu, la lumière) ou des animaux.
« Pour forcer la foule à saisir toutes les nuances de votre interprétation, vos sentiments doivent être profondément sincères. Il est plus facile de percevoir les sentiments précis que les vibrations insaisissables d’une âme poétique. (…) vos observations personnelles de la vie élargiront votre fantaisie et aiguiseront votre sensibilité. Liez-vous d’amitié avec des enfants, contemplez la nature et les choses, devenez amis d’un chien, d’un chat, regardez à travers leurs yeux dans leur âme. »7