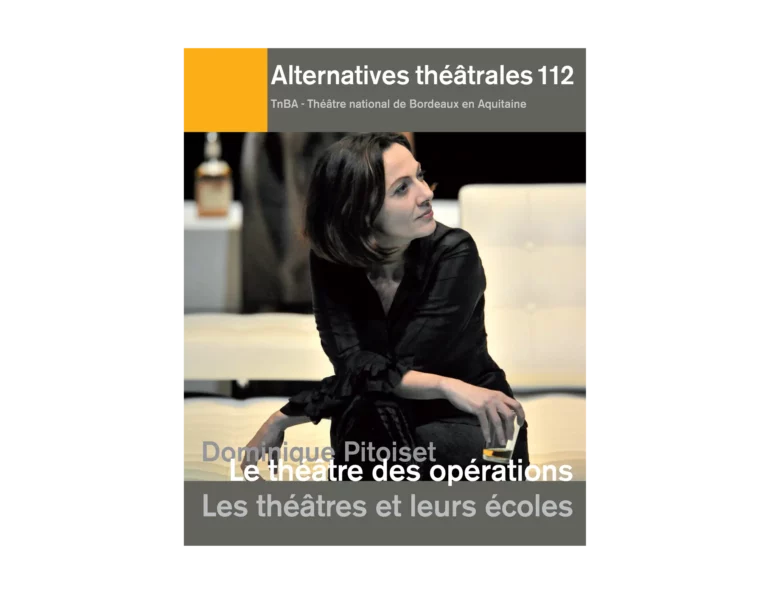ÉCRIRE sur l’École du Théâtre National de Strasbourg, née en 1953, c’est se poser d’emblée la question qui est au cœur de sa richesse et de son identité : faut-il en parler diachroniquement, comme d’une institution dont la longue histoire particulièrement significative donne sens à chaque nouveau chapitre qu’on y écrit ? Ou synchroniquement, dans le rapport complexe qu’elle entretient à un projet artistique donné (en l’occurrence celui de Stéphane Braunschweig auquel j’ai participé de 2000 à 2008)? Doit-on l’envisager du point de vue de la tradition et de la mémoire qui incontestablement s’y perpétuent, ou du point de vue de sa réactivité artistique aux changements qui affectent le théâtre qui l’abrite ? Une école comme celle-ci a la particularité d’être à la fois pérenne dans ses structures (ses fondations solides et pensées en ont fait une des trois écoles nationales françaises, la seule à être implantée dans un théâtre), et transitoire dans ses orientations successives, liées au projet du metteur en scène directeur du TNS, qui, statutairement, est aussi directeur de l’École. Paradoxalement, sa capacité à muer est un élément essentiel de sa forte identité – du moins est-ce ainsi que nous la percevions lorsque nous y sommes arrivés en 2000, Stéphane Braunschweig et moi, lui comme directeur, et moi comme conseillère artistique et pédagogique, responsable de la nouvelle section Dramaturgie — mise en scène qu’il avait décidé d’y créer.
L’idée que nous nous faisions de cette École était donc avant tout celle d’un endroit où la formation pouvait être fortement en lien avec un projet artistique et dialoguer avec lui. Comme je m’en aperçus bien plus tard, lorsque je réalisai le numéro d’OutreScèneconsacré à l’histoire de l’École, cela n’était pas une évidence : son fondateur Michel Saint-Denis, neveu de Jacques Copeau, n’avait accepté d’assumer la direction du Centre Dramatique de l’Est que parce que c’était la condition pour y créer et diriger l’École. Il s’intéressait beaucoup plus à la formation qu’à la mise en scène et, dans la droite ligne du rigorisme de son oncle, chercha à instaurer à Strasbourg un enseignement qui protège les élèves de tout contact trop précoce avec le métier, cloisonnant donc fortement l’École et le théâtre. Hubert Gignoux, qui dirigea le Centre Dramatique de l’Est de 1957 à 1971 (et le fit transformer en Théâtre national de Strasbourg), fut plus pragmatique : l’École ayant selon lui pour mission première de former des artistes pour la Décentralisation, il considérait les échanges et les rapports avec la troupe comme positifs, et les favorisa. Sa personnalité, marquante sur ce point comme sur tant d’autres, amena donc un infléchissement majeur. Mais ce qu’il s’agissait alors de partager entre théâtre et école, c’étaient plutôt une déontologie, un positionnement, des finalités, qu’une orientation artistique. Ce n’est qu’au tournant des années soixante-dix – une époque de profonde mutation pour la Décentralisation, où les animateurs de l’ancienne génération cédèrent progressivement la place aux metteurs en scène-artistes – que l’École du TNS se mit à se regarder elle-même comme un laboratoire de formes nouvelles : à la fin de son mandat, Hubert Gignoux avait commencé à y faire entrer comme professeurs, non plus des pédagogues, mais des metteurs en scène en pleine recherche, initiant ce qui devait devenir une des plus remarquables caractéristiques de l’École.
Sans que nous nous en rendions bien compte, c’était donc en bonne part pour des raisons générationnelles que s’était implantée en nous l’idée de l’École du TNS comme un foyer artistique : lorsque nous avions commencé le théâtre dans les années quatre-vingt, les jeunes acteurs issus de cette École que nous rencontrions avaient traversé l’expérience du TNS dirigé par Jean-Pierre Vincent (1975 – 1983), une expérience très particulière mais qui pour nous définissait « le TNS ». Nous savions par eux que la radicalité de cette période avait entièrement saisi l’École, que celle-ci avait pleinement participé à cette aventure intellectuelle aussi bien qu’artistique et politique, que le collectif de dramaturges, de metteurs en scène et d’acteurs réuni par Jean-Pierre Vincent y avaient œuvré, que certains des jeunes comédiens qui y avaient été formés avaient été engagés dans la troupe (à salaire égal avec les anciens) à leur sortie. Peut-être ce moment d’osmose particulier constituait-il dans nos esprits la norme de cette École, ou une version concrète de l’utopie qui s’attache à la présence d’une école dans un théâtre.
Nous étions bien entendu renforcés dans l’idée qu’une École de théâtre n’est pertinente que si elle a une « ligne artistique » par le paysage qu’avaient constitué, dans nos années de formation, l’École de Chaillot (où Stéphane Braunschweig avait été élève) et celle des Amandiers, créée par Chéreau, alors que le Conservatoire, dirigé par Jean-Pierre Miquel depuis 1983, ne faisait plus guère parler de lui depuis le départ d’Antoine Vitez. Et l’empreinte de ces deux écoles était si forte, si éclatante, que nous avons été surpris, lorsque nous avons participé aux premières réunions organisées au Ministère de la Culture pour la mise en place de la « plate-forme de l’enseignement supérieur d’art dramatique », de constater que nos interlocuteurs de la DMDTS considéraient, tout au contraire, qu’une école de théâtre doit former des comédiens en les outillant d’une panoplie de savoir-faire les plus variés possible, les rendant aptes à toute esthétique, dans une neutralité de bon aloi, conforme selon eux aux missions éducatives de la République.
Ce que faisaient apparaître ces discussions, de manière intéressante, c’était la spécificité du cas de l’École du TNS. En tant qu’elle est une des deux écoles nationales dépendant du Ministère de la Culture, dont les élèves sont par la suite aidés par un dispositif d’insertion bien doté, elle ne peut certes se revendiquer d’un projet exclusivement lié à une aventure artistique singulière, comme l’était celui de l’École de Chaillot (dont le budget modeste fut pris sur celui du budget du théâtre) ou celui de Nanterre. En même temps – et bien que la pédagogie de la plupart des écoles soit désormais alignée sur celle, alors novatrice, mise en place par Michel Saint-Denis (cours techniques le matin, travail collectif sur la durée d’un stage l’après-midi) – on ne peut ignorer qu’à la base, cette école n’avait rien de neutre. Sa fondation est partie prenante d’une rénovation esthétique radicale (la filiation de Copeau) et d’un positionnement citoyen voire poli- tique (la Décentralisation). Tandis que le Conservatoire perpétuait une tradition dramatique, l’École du TNS formait avant tout à une éthique théâtrale indissociable de ce qui y était enseigné comme art du théâtre, un théâtre nouveau adressé à un public nouveau.

Photo Élisabeth Carrechio.