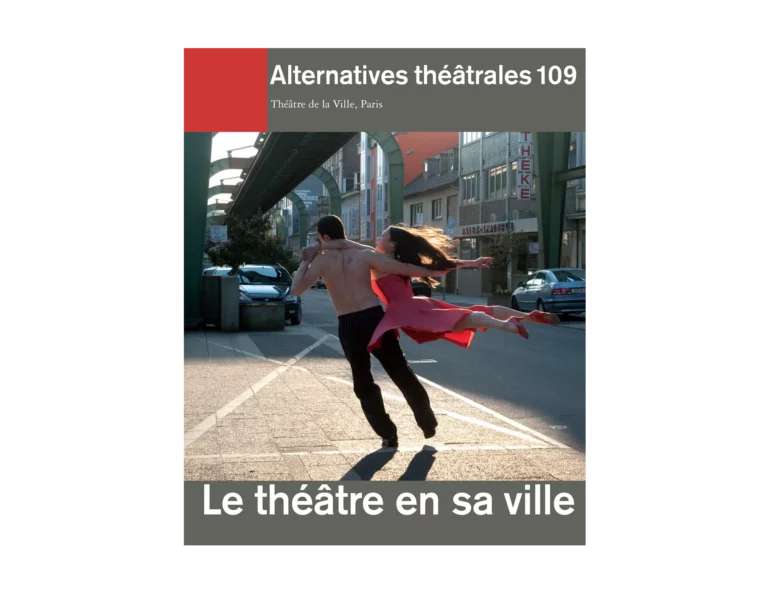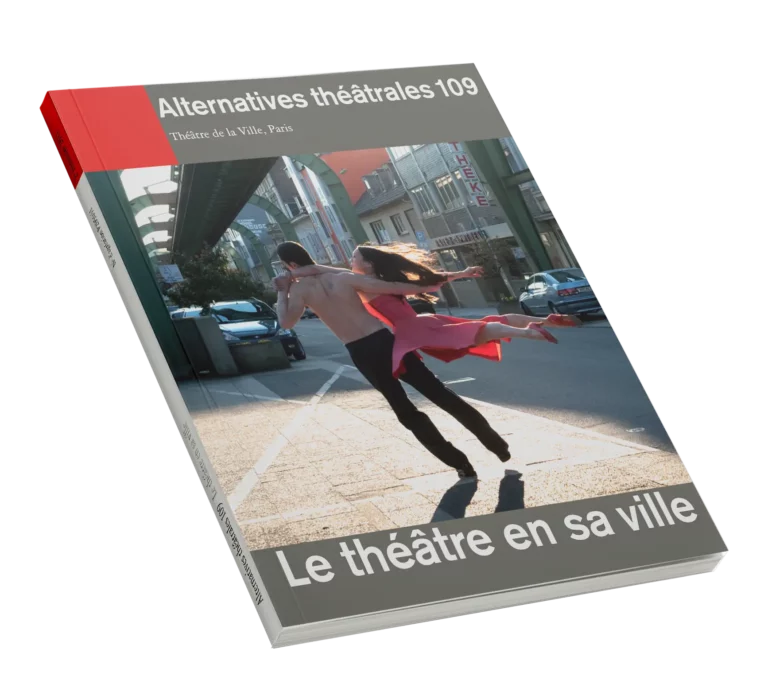Depuis un an environ, pour des raisons de santé, Luca Ronconi a abandonné la direction à temps plein du Piccolo Teatro de Milan, mais il reste lié au Piccolo du directeur Sergio Escobar, et pas seulement par un contrat de consultant artistique. Le grand metteur en scène noue avec le premier, le plus important et le plus prestigieux théâtre public italien la relation la plus longue et la plus stable de toute sa carrière : il y travaille depuis douze ans, il y a signé certains de ses chefs‑d’œuvre, de l’audacieux INFINITIES qui transportait dans une ancienne usine les élucubrations mathématico-philosophique de l’essayiste John Barrow, au parfait PROFESSEUR BERNHARDI de Schnitzler en 2005, jusqu’aux récents IL SOGNO de Shakespeare en 2008 et LA COMPAGNIA DEGLI UOMINI d’Edward Bond, sa dernière mise en scène au Piccolo qui a obtenu un succès retentissant. Soixante-quinze ans, dont presque soixante de théâtre, Luca Ronconi a passé plus de vingt ans de sa carrière dans les théâtres publics italiens, à Turin de 89 à 94, à Rome de 94 à 98, avant d’accoster au Piccolo. Il y est arrivé en 99 quand il prit en main la direction artistique dans la phase très délicate de l’immédiat après-Strehler, avec un cahier des charges ardu : conduire l’avenir d’un théâtre jusque-là lié entièrement à l’identité artistique, humaine et professionnelle de son fondateur, Giorgio Strehler, qui, avec Paolo Grassi et Nina Vinchi, a été non seulement le directeur unique du Piccolo jusqu’à sa mort le 25 décembre 97, mais aussi l’inventeur dans l’immédiat après-guerre du « théâtre public » en Italie et d’un modèle qui résiste encore aujourd’hui.
Anna Bandettini : Partons des origines. D’où vient le Piccolo Teatro et, en même temps que lui, le théâtre public en Italie ?
Luca Ronconi : Par rapport aux autres pays européens, l’Italie a toujours été une anomalie : il n’y a pas eu de capitale pendant des siècles, et le pays a été longtemps partagé en divers États. D’un point de vue culturel, la langue n’a jamais été un élément unifiant. Le théâtre a toujours été chez nous un théâtre dialectal, qui s’est beaucoup développé dans les différentes régions. Le théâtre de langue italienne était un « teatro di giro » (un théâtre de tournées) : des compagnies qui tournaient de ville en ville, et qui montraient un répertoire adapté à différents publics. Cela signifie que le teatrostabile, qui a été à la base du développement de tant de théâtres à l’étranger, a manqué chez nous.
A. B. : Vous considérez cela comme un handicap de base ?
L. R. : Bien sûr, ce fut dommage, parce que la sédentarité, le rapport au territoire, est un élément fondamental du théâtre même, c’est la condition nécessaire pour porter le récit de ce territoire sur scène. Quand le Piccolo est né en 1947, il était le premier théâtre public en Italie à s’être posé ce problème. Le Piccolo est même né de cette perspective : porter sur scène le récit du territoire, d’une ville, Milan, qui, surtout en ce temps-là, rassemblait les institutions sociales, politiques, les espoirs les plus vifs du pays. Le Piccolo l’a fait en obtenant même un financement public, donc en imposant pour la première fois l’idée que le théâtre soit soutenu par l’État et par les administrations locales comme un bien public. Pendant de nombreuses années le Piccolo a servi de modèle à bien d’autres théâtres publics en Italie. On y compte actuellement quatorze théâtres « stables », financés par l’État – mais progressivement de moins en moins – et par les organismes locaux, régionaux et municipaux. En contrepartie ces théâtres effectuent un travail de promotion culturelle pour différentes couches de la population.
A. B. : Quelle est selon vous la différence entre théâtre public et théâtre privé en Italie ?
L. R. : Le théâtre est une forme de divertissement. Le problème est d’identifier ce divertissement comme un but ou comme un moyen. Personnellement je crois que c’est un moyen, une nécessité. Mais bien sûr, il existe des formes et des destinations différentes, des possibilités de divertissement différentes. C’est à cela que se mesure la différence.
A. B. : Quel est alors le rôle d’un théâtre public ?
L. R. : Comme je le disais, un théâtre public doit être lié à un territoire. L’histoire du théâtre italien nous enseigne que le meilleur moyen d’établir ce rapport est l’usage du dialecte. Je pense à Naples, par exemple, où il existe un théâtre napolitain très développé lié à la langue et aux conditions particulières de la ville. Pour moi, le rapport entre théâtre et territoire ne doit pas être exclusivement le privilège local ou le respect des traditions locales, mais plutôt l’attention, l’observation et la critique des développements sociaux, culturels et politiques de ce territoire. Le Milan d’aujourd’hui n’est pas le même que celui d’il y a deux mille ans ni celui d’il y a quinze ans. Quand j’ai pris les rênes du Piccolo en 1999, Milan était une ville complètement différente de celle de 1947, quand le Piccolo est né. Et je crois que le Piccolo ne peut pas ne pas être en rapport avec ces changements. Dans ce scénario, le rôle et la fonction du théâtre, et de celui qui le dirige, consiste, selon moi, à choisir, à décider si le rapport avec les mutations et les difficultés liées aux changements sociaux doit être valorisant, illustratif ou critique et dialectique. Personnellement je considère que ce dernier est le rapport le plus juste, parce qu’il stimule le public, c’est-à-dire la citoyenneté, à des dialogues et des points de vue divers.