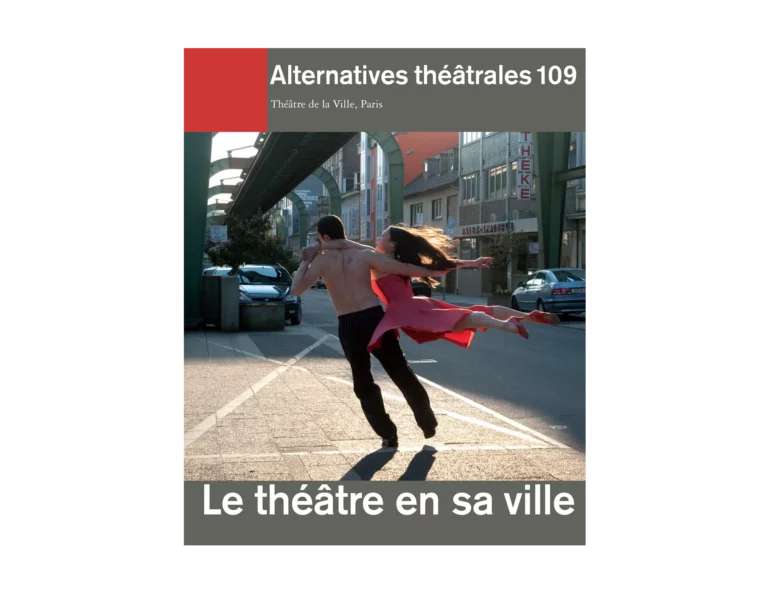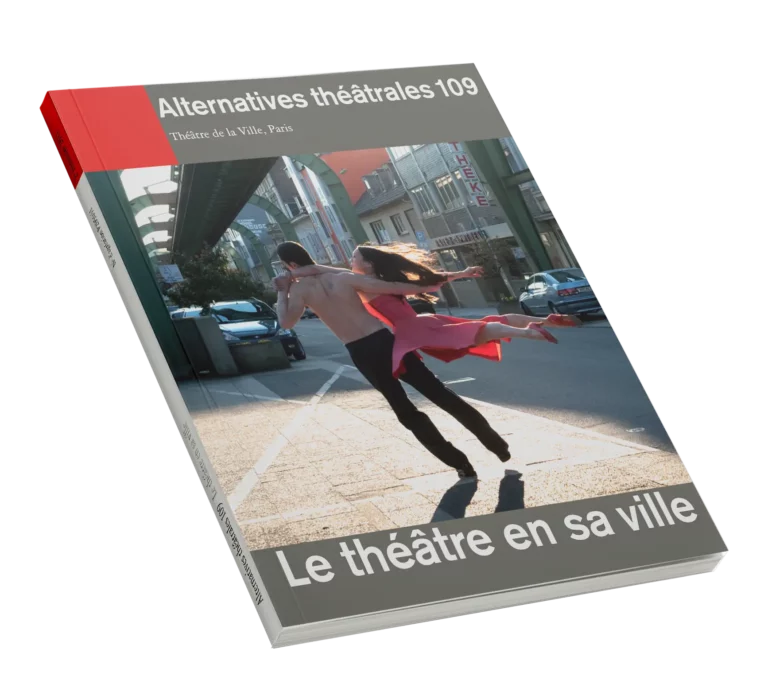Barbara Engelhardt : Vous avez été directeur de théâtres municipaux très variés : Stuttgart – Bochum – Vienne – Berlin pour n’en citer que les plus importants. Chaque ville et son théâtre fonctionnent d’une façon différente. Deviez-vous élaborer des conceptions différentes ? Aviez-vous une relation très étroite avec chaque ville et chaque situation sociale ? Comment cela se présente-t-il aujourd’hui au Berliner Ensemble ? Comment voyez-vous le rôle et les tâches, la chance et les difficultés du Berliner Ensemble dans une ville comme Berlin : surendettée, mais dotée d’une immense offre culturelle et d’une densité théâtrale exemplaire ?
Claus Peymann : Pour moi, le Berliner Ensemble est un couronnement après tous les défis précédents car c’est probablement le théâtre de langue allemande le plus intéressant, riche d’une longue histoire. C’est une maison qui ne commence nullement avec Brecht car dans les années trente, ce fut le lieu le plus important pour la découverte de la littérature contemporaine. LES TISSERANDS de Gerhard Hauptmann, LE JOYEUX VIGNOBLE de Zuckmayer, PIONNIERS À INGOLSTADT de Marieluise Fleißer, L’OPÉRA DE QUAT’SOUS de Brecht ou encore LA NUIT ITALIENNE de Horváth y ont été créés.
Le Berliner Ensemble sera la dernière étape de mon parcours en tant que directeur. J’ai commencé au théâtre universitaire de Hambourg, et j’ai été invité avec plusieurs productions par Jack Lang, dans le cadre du légendaire festival de Nancy, comme Patrice Chéreau et beaucoup d’autres. Après Hambourg, j’ai mis en scène au TAT (Theater am Turm) à Francfort, ensuite fondé avec Peter Stein la Schaubühne am Halleschen Ufer à Berlin. La Schaubühne était une tentative de pratiquer la prise de décision collective au théâtre. Mais j’ai échoué, du fait de dissensions esthétiques et politiques. Durant les différentes étapes de ma carrière théâtrale, j’ai fait l’expérience de tous les modèles du Stadt- und Staatstheater, c’est-à-dire le système théâtral dans les pays de langue allemande. Durant cinq ans, j’ai été directeur du théâtre de Stuttgart : nous y avons mis en scène les pièces de Thomas Bernhard, fait sensation par notre redécouverte pour la scène des classiques tels que LES BRIGANDS de Schiller ou LA PETITE CATHERINE DE HEILBRONN de Kleist, IPHIGÉNIE de Goethe et FAUST I ET II (une mise en scène de dix heures réparties sur deux soirées!). Après quelques années couronnées de succès, j’ai provoqué le scandale : lors de « l’automne allemand » de 1977, j’avais versé un don de 350 DM pour les soins dentaires d’Ulrike Mainhof et Gudrun Ensslin, emprisonnées à Stammheim. L’industriel Hans Martin Schleyer était alors entre les mains de la RAF (Fraction armée rouge); plus tard, son cadavre a été découvert dans le coffre d’une voiture. Il fallait donc trouver des coupables de substitution. Je fus de ceux-là, comme Heinrich Böll ou Volker Schlöndorff. J’ai quitté Stuttgart avec tous les comédiens et les collaborateurs artistiques, ainsi que quelques techniciens, pour le théâtre municipal de Bochum. J’y avais le titre pompeux de « directeur général ». Bochum est une ville industrielle de la Ruhr. Ce fut une période formidable. Nous avons été invités partout en Europe, en Belgique et en France notamment. Les créations de Thomas Bernhard, de Heiner Müller et de Peter Handke, ainsi que quelques classiques légendaires tels que LA BATAILLE D’ARMINIUS de Kleist (présenté au Théâtre de l’Odéon dans le cadre du Festival d’Automne 1984) et TORQUATO TASSO de Goethe ont été des « hits », et pas seulement dans la Ruhr… Durant sept ans, nous avons été le théâtre municipal le plus en vogue en Allemagne.
B. E. : Théâtre municipal au sens où vous pouviez développer avec la troupe permanente des projets à long terme pour une ville ? Avec des acteurs, auteurs et metteurs en scène de renom qui étaient liés de manière permanente à ce théâtre ?
C. P. : Nous avons établi des rapports étroits avec Heiner Müller et Matthias Langhoff par exemple. Bochum était – même par rapport à la situation en Allemagne – un théâtre richement doté, un théâtre dont on ne peut, en Belgique ou en France, que rêver. La ville de Bochum a réservé l’intégralité de son budget culturel à la scène du théâtre parlé – et ne s’est pas payé en plus, comme d’autres villes allemandes, un opéra, un ballet ou un orchestre de taille importante. Et, deux stylites très contradictoires ont été les deux antipodes de mon travail à Bochum : d’un côté Heiner Müller, de l’autre Thomas Bernhard – tous les deux, dans leur genre, des anarchistes et des terroristes du théâtre.
Après cela, j’ai été nommé directeur du plus grand théâtre subventionné de langue allemande, le Burgtheater de Vienne. En comparaison du Burgtheater, la Comédie- Française est presque une petite entreprise. Mon travail au théâtre national autrichien a été mon « étape reine ». Treize ans de lutte pour l’art ont divisé le public viennois comme jamais auparavant dans l’histoire de ce théâtre. Notre arrivée à Vienne a été qualifiée de Tsunami… Plus de la moitié des représentations au Burgtheather – pas moins de 1500 places – ont été consacrées aux auteurs contemporains : Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard, Peter Handke et le grand George Tabori dans la grande salle. La création de PLACE DES HÉROS de Bernhard a provoqué un scandale dans tout le pays et transformé l’Autriche. Le jour de la première, des opposants ont déversé devant le théâtre des camions entiers de purin, j’ai été agressé devant le théâtre, des ministres ont exigé ma démission, le cardinal a voulu interdire le spectacle, dix mille signatures ont été rassemblées pour empêcher la prolongation de mon contrat… Avec PLACE DES HÉROS, Thomas Bernhard a dévoilé l’antisémitisme profond des Autrichiens. Après ce scandale, le mensonge confortable qui consiste à affirmer que l’Autriche a été la première victime des nazis ne pouvait plus tenir. Le Burgtheater devint un tribunal, Vienne et l’Autriche étaient jusqu’alors aux mains des conservateurs. Ainsi c’est instaurée une tension idéale entre notre théâtre, à la fois politique et expérimental, et la ville.
B. E. : Vienne est une ville exceptionnellement passionnée par le théâtre à qui elle réserve un rôle important. C’est évidemment un bon point de départ pour tester la pertinence sociale d’une pièce.