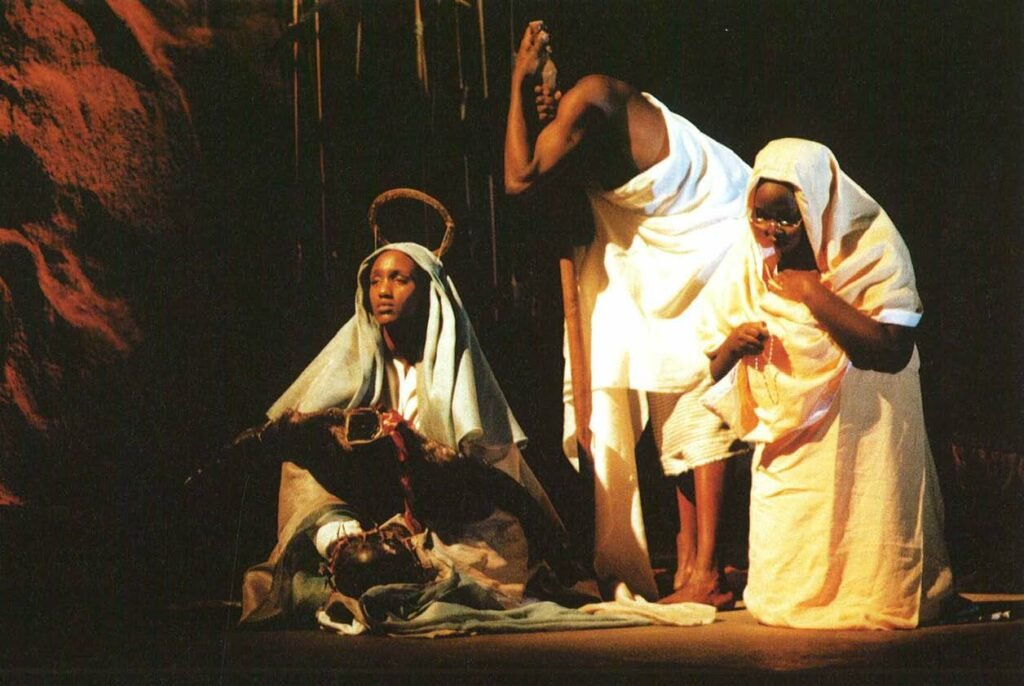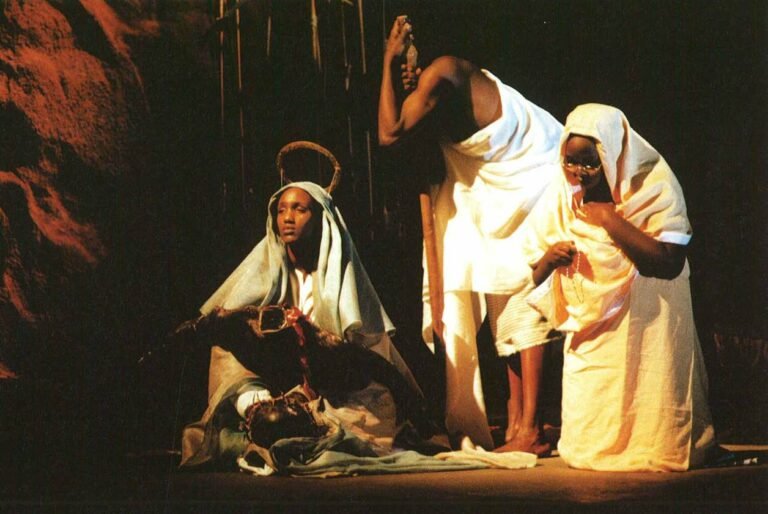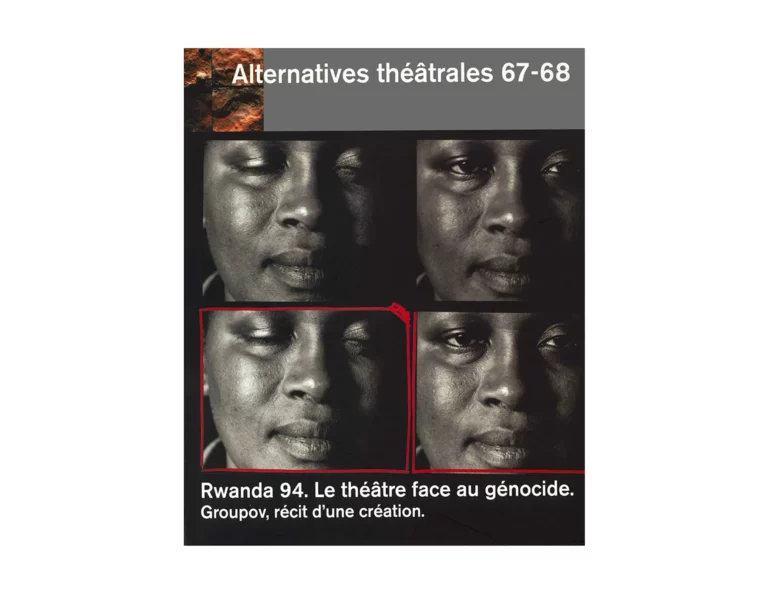BERNARD DEBROUX : Alors que depuis une douzaine d’années tu écris au théâtre une œuvre singulière, pour le projet RWANDA 94 tu as travaillé à partir d’un cadre « imposé ». Il ne s’agissait pas d’une « commande » au sens habituel du terme mais de production de textes demandés par Jacques Delcuvellerie à des auteurs autour de sujets proposés mais traités en toute liberté, dans la forme qui leur convenait. Concrètement, comment cela s’est-il passé pour toi ?
Jean-Marie Piemme : Il faut dire tout d’abord que c’est ma première collaboration avec le Groupov et Jacques Delcuvellerie. J’ai un long trajet de compagnonnage avec eux, j’ai vu beaucoup leurs spectacles, mais je n’avais jamais travaillé directement avec eux. Très concrètement, les choses se sont passées de la façon suivante : Jacques et des acteurs du Groupov, acteurs qui ne devaient pas nécessairement se retrouver dans le spectacle et qui ne s’y sont d’ailleurs pas tous retrouvés, ont commencé à travailler sur la matière du génocide, et en cours de route, relativement tôt dans le processus d’élaboration mais en cours de route néanmoins, Jacques m’a contacté en me demandant de collaborer au projet, me disant qu’il ne s’agissait pas d’une commande au sens habituel du terme, mais d’une mise en commun de forces de travail, qu’il y aurait d’autres auteurs qui seraient sollicités ; qu’eux-mêmes au Groupov écriraient des choses. Donc lorsque j’ai commencé le travail, c’était dans un schéma tout à fait autre que celui dans lequel j’évolue habituellement.
Il a fallu tout d’abord que je me mette au courant de la matière. Si j’en avais une perception globale, je n’en avais certainement pas une perception détaillée, encore moins une vision historique claire et précise. Le document que Jacques avait déjà rédigé (Note d’intention, 1997), que je trouve remarquable, m’a beaucoup aidé.
Ensuite nous avons eu beaucoup de réunions collectives où nous apprenions énormément de choses, nous réfléchissions ensemble à la manière de faire un spectacle sur un génocide ; ce qui, bien sûr, n’est évident pour personne.
Jacques avait bien des idées directrices dans la tête mais il y avait une grande part de liberté par rapport aux directions qu’on pouvait prendre. Comme nous avons un peu les mêmes origines théâtrales, les mêmes références, cela a facilité les choses. On partage les mêmes points de vue sur le théâtre et la fonction du théâtre. Cette proximité a sans doute aidé à ce que l’amalgame prenne facilement.
Il a donc fallu chercher à résoudre cette question centrale, « comment fait-on un spectacle sur un génocide ? » dès l’instant où on veut rencontrer l’émotion et la douleur que ça suscite, le faire dans le respect que ça mérite, tout en y mêlant un point de vue historique, un point de vue critique, un point de vue analytique, absolument indispensables.
Donc trouver quelque chose qui fasse que le spectacle ne soit pas une messe consolatrice, mais un acte vivant, à la fois un acte de témoignage sur ce qui s’est passé et un regard qu’il faut projeter dans l’avenir, une mise en garde, un signal qui permette d’attirer l’attention sur ce qu’on avait dit qui n’arriverait plus jamais, à savoir le génocide. Telles étaient les directions dans lesquelles on a travaillé. Il s’agissait aussi de rechercher des formes et là, il y avait en référence d’autres auteurs qui avaient déjà abordé le sujet du génocide, en particulier par exemple Peter Weiss avec L’INSTRUCTION.
B. D. : On trouve effectivement dans la « Note d’intention » les dramaturgies de référence (y compris d’ailleurs tes propres pièces) : les tragédies grecques, Shakespeare, Brecht, Genet, Weiss, Claudel, Müller, Maïakovski, etc. T’es-tu, toi aussi, inscrit dans ces filiations ? Une des trois visions de la journaliste Bee Bee Bee, celle de la rencontre du fantôme de François Mitterand avec son fils Jean-Christophe, fait directement référence à Hamlet lorsqu’apparaît le fantôme de son père. On retrouve presque mot pour mot le début de la pièce.
J.-M. P. : Je ne suis pas arrivé tout de suite à ces visions. J’ai fait des approches qui n’ont pas trouvé leur pertinence. Par exemple, on savait qu’on démarrait par une émission de télévision. J’ai donc fait du texte pour un faux débat télévisuel, comme si on avait un panel avec des gens qui développent des points de vue et expliquent des choses, etc.
On s’est vite rendu compte des limites de cette tentative : on ne donnait pas une information très significative ; en même temps on était dans une forme théâtrale terriblement molle parce qu’à force de ressembler à un panel télévisuel, elle n’était qu’un panel télévisuel. Voilà déjà une chose qui a été écartée.
Puis, on s’est dit qu’on pourrait avoir recours à une forme de procès. Le procès est une forme canonique du théâtre. On pense à L’INSTRUCTION bien sûr, et si on remonte plus loin, Athéna dans L’ORESTIE fait un procès pour savoir si la vengeance doit poursuivre Oreste ou si on doit au contraire instaurer un tribunal qui arrête les vendettas. J’ai donc écrit quelques scènes autour d’un procès fictif du colonel Logiest, un protagoniste important dans l’histoire de la présence belge récente au Rwanda. Là aussi les limites sont rapidement apparues. Le travail se révélait inadéquat au projet dans sa totalité, j’en étais d’ailleurs le premier convaincu.
Alors est venue l’idée que dans un univers de témoignages, dans un univers d’explications où il y avait la conférence, le témoignage de Yolande, peut-être fallait-il
une part de fiction. Pourquoi la fiction n’aurait-elle rien à dire sur le réel ?