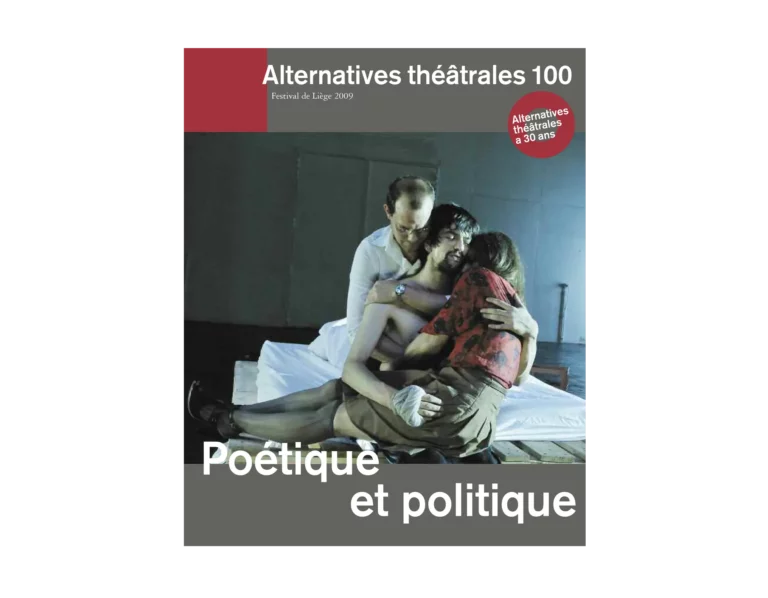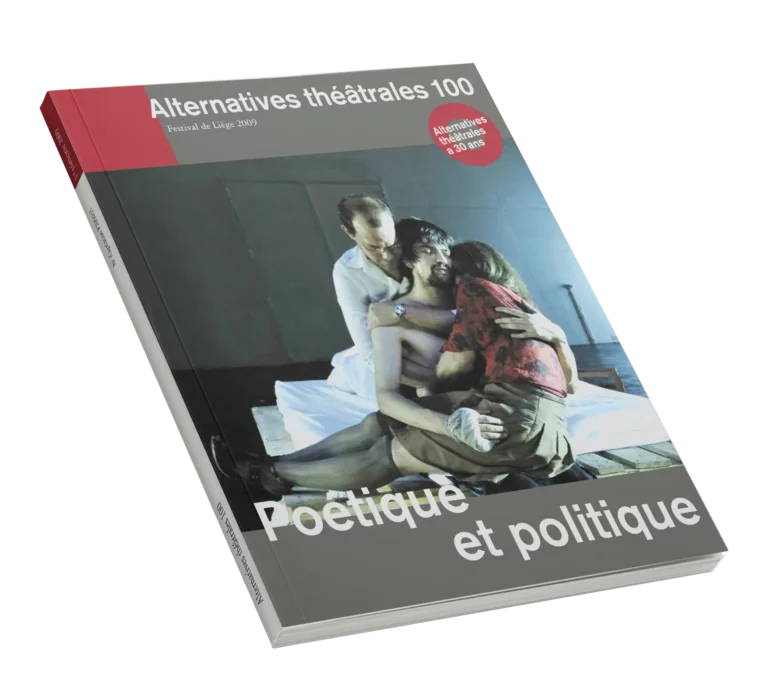ALEXANDRE CAPUTO : Comment êtes-vous venus au théâtre ?
David Bobee : C’est la rencontre avec le travail d’Éric Lacascade qui m’a décidé. Au départ je viens du monde du cinéma. Étudiant en arts du spectacle à l’université de Caen, j’ai rencontré Ronan qui étudiait la philosophie. Les discussions politiques et esthétiques que nous avons eues ont pris forme sur le plateau. La rencontre avec l’équipe technique s’est également déroulée à l’université.
Ronan Chéneau : La manière de faire du théâtre par le groupe animé par David m’a séduit. Il me semblait que la liberté que l’on pouvait trouver au théâtre était supérieure à celle que l’on pouvait trouver dans d’autres disciplines que j’avais explorées auparavant telle la musique ou les arts plastiques.
A. C. : Est-ce que vous partagiez un regard particulier ou atypique sur le monde ?
R. C. : Nous avions de nombreuses interrogations et les discours de l’époque dans lesquels on aurait pu se reconnaître ( les discours de gauche ) ne nous satisfaisaient pas. Mais il y a aussi la rencontre personnelle, deux manières différentes et complémentaires d’être au monde, une volonté d’affirmer nos choix, fussent-ils atypiques.
D. B. : Nous nous sommes également retrouvés sur la difficulté de prendre la parole, de développer des discours. Nous nous sommes servis du théâtre, non pas pour tenir des discours mais pour partir à la découverte. Le théâtre est ainsi devenu pour nous un terrain de recherche.
R. C. : Je côtoyais beaucoup de gens de gauche, notamment des anarchistes. Leurs discours étaient frontalement anti-américains. Du coup, des aspects fondamentaux de notre société tel notre rapport à la consommation n’était pas pensé. De même, le rejet de la culture populaire, de ce qui a du succès, des chansons que l’on fredonne. Aspects qu’il ne suffit pas de simplement condamner mais sur lesquels faut réfléchir parce que devenus incontournables. Ce que faisait par exemple Gilles Lipovetsky dans L’ÈRE DU VIDE qui dépeignait de façon révolutionnaire la paix liée à la société capitaliste. Un regard plus ambivalent permet de mieux penser les phénomènes liés à notre société.
A. C. : La paix que vous évoquez se limite à nos contrées. Des soldats occidentaux continuent à se battre sur d’autres continents.
R. C. : Oui, le capitalisme n’a pas évité la guerre, il l’a repoussée. Mais selon Lipovetsky, il nous a évité des catastrophes telles les guerres nucléaires et nous maintient dans une sorte de paix létale, qui n’en est pas moins insupportable, puisque cela veut dire aussi que toute contestation radicale est neutralisée, d’où une mise en cause du politique…
A. C. : Vous avez nommé votre compagnie Rictus. Pourquoi ?
D. B. : J’évoluais dans des milieux de gauche mais moins radicaux. Il me semblait que ceux-ci, par contre, acceptaient le monde tel qu’il était, quitte à se fondre en lui, ce qui ne me convenait pas non plus. Ronan et moi partagions une attitude « en biais », plus contradictoire, plus complexe et fragmentaire, moins dogmatique.
Les idéologies de nos parents, ces espèces d’autoroutes de la pensée, avaient complètement explosés. Et en explosant, des fragments de sens, d’idéologie se sont retrouvés à la surface des choses. Notre démarche était de gratter la surface pour recomposer du sens. Rictus, c’est cette attitude ambivalente, à la fois un sourire, à la fois une grimace.
Cette diagonale du regard nous situe en biais, ni dans une acceptation, ni dans un rejet total du monde. J’aime cette approche critique et la disposition d’esprit que demande une telle grimace.
A. C. : Votre premier spectacle RES / PERSONA est sous-titré NOUS QUI AVONS ENCORE 25 ANS. La thématique générationnelle semble être centrale dans votre travail. Dans votre trilogie1 , vous abordez notamment la difficulté d’entrer dans l’âge adulte, de prendre place dans cette société. Par ailleurs la mode, la musique, le design, les outils de communication
mais aussi Spiderman (le film), bref, tout ce que l’on qualifie généralement de produits de consommation nourrit vos spectacles. Outre la critique portée à notre mode de vie, ne s’agit-il pas également d’une déclaration d’amour à notre société ?
R. C. : La prouesse n’est pas d’arriver à faire une déclaration d’amour à Ikea mais simplement de reconnaître que cela sculpte le sensible. Que l’on aime ou rejette pour des raisons politique ces choses-là, qu’on le veuille ou non, cela détermine notre perception du monde. Je ne vois pas comment l’on peut travailler sur le réel – ce qui me semble la fonction principale d’un artiste – sans forcément aborder ces choses-là et sans immédiatement vouloir les juger, les balayer.
Notre génération a été stigmatisée comme apolitique, et cela par nos parents qui eux effectivement étaient la génération la plus politisée. Il y a aujourd’hui une articulation générationnelle difficile avec nos parents, une difficulté de se faire une place au monde. Nous avions donc, avec David, l’envie d’affirmer notre culture, fut-elle très américanisée et aussi affirmer non pas notre apolitisme mais notre façon particulière de penser la politique.