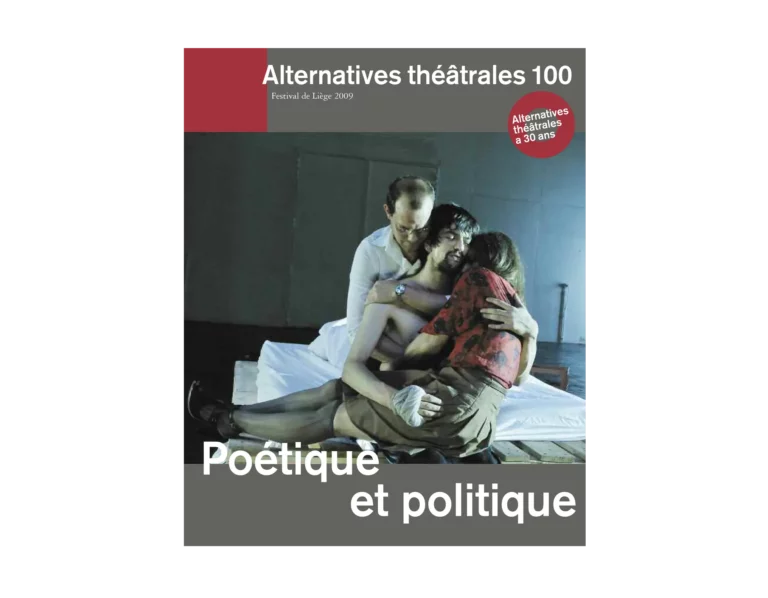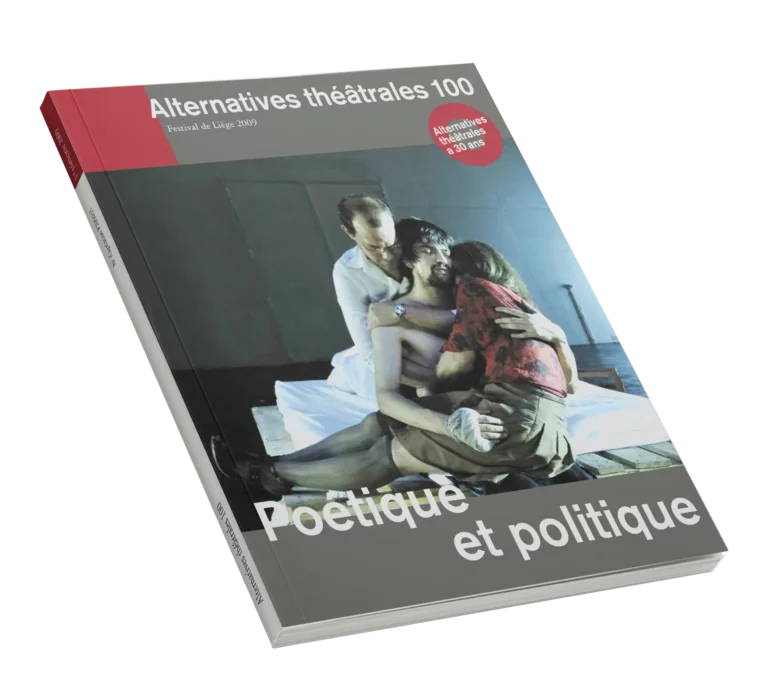ANTOINE LAUBIN : En Belgique, la « S.P.R.L. » est une « société privée à responsabilité limitée ». Dans ton texte, l’appellation sert à la fois pour désigner la structure d’entreprise, mais aussi la cellule familiale et, à un niveau beaucoup plus large, notre société dans son ensemble. C’est donc la notion de responsabilité qui est ici pointée à chaque niveau.
Jean-Benoît Ugeux : La manière dont le monde s’organise naît pour moi de l’intersection entre la sphère familiale et celle du travail. Ce n’est plus seulement l’artiste qui a une vie complètement précaire. Aujourd’hui, dans tous les boulots, tout le monde est sur la sellette. Même dans le secteur public. (Rappelons nous la faillite de la compagnie aérienne Sabena). Même les gars qui pensaient être à l’abri depuis des années n’ont plus la garantie de leur emploi. Comme le monde travail oblige à être beaucoup plus souple qu‘avant, que tu ne reprends plus le boulot de ton père dans la même entreprise que lui, tu sais maintenant que, quel que soit ton choix, il va avoir une influence sur la famille. Il y a toujours eu des boulots qui ne permettaient que peu de vie « à côté » (agriculteur, boulanger, etc.). Dans le domaine artistique, dès le début, tu sais qu’il n’y aura pas de stabilité, qu’il va falloir se battre. Le spectacle parle en effet principalement de la responsabilité.
A. L. : Dans ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ et HANSEL ET GRETEL, tes deux projets précédents, cette question de la responsabilité était déjà centrale.
J.-B. U. : Les familles présentées dans les deux projets précédents étaient beaucoup plus nucléiques que celle-ci. Dans SPRL, j’ai eu envie d’ouvrir un peu plus et de ne plus me limiter au couple. La question est la même : comment, ne voulant pas assumer la responsabilité de choix posés, la roue de l’histoire vous revient dans la gueule de façon très violente : personne ne veut assumer ce qu’il a fait – que ce soit mal ou bien. C’est cela qui m’intéresse : ne pas pouvoir pointer un ennemi fixe. J’aime qu’il n’y ait pas de véritable coupable, qu’on s’aperçoive que chacun mène sa barque, sans être capable de poser les choix qu’il faudrait au moment où il faudrait, et se retrouve coincé.
A. L. : Tu poses donc des questions morales en refusant d’y répondre de manière morale.
J.-B. U. : Dans SPRL, je veille à ne pas dire « la faute c’est le capital » ou « la faute c’est la famille », etc. Chacun entretient un système duquel il est tributaire. Certains personnages permettent au spectateur d’entrer dans l’histoire et de s’identifier à eux. Ici, c’est une étrangère qui vient passer un test d’embauche. C’est une manière plus délicate et sensible de faire croire au public qu’il est du bon côté, mais finalement la personne qui croit être du bon côté se retrouve aussi coupable qu’une autre.
A. L. : C es personnages permettant au public d’«entrer » dans le sujet privé ne te ressemblent-ils pas un peu ?
J.-B. U. : Oui et non. Ce qui me ressemble, c’est peut-être le fait que ces personnages cherchent la solution et ne la trouvent pas. Ils s’aperçoivent du magma dans lequel ils sont parce qu’eux-mêmes le fabriquent et le cautionnent. Ils apparaissent finalement aussi coupables que le gros dégueulasse ou le méchant assassin.
A. L. : Est-ce parce qu’ils sont tous excusables ou parce qu’ils sont tous définitivement corrompus ?
J.-B. U. : Les deux. Ils ont tous de bonnes raisons. J’essaie de créer un univers qui suggère les causes de la situation dans laquelle ils se trouvent. À la fin, on ne doit pas trop savoir qui a gagné.