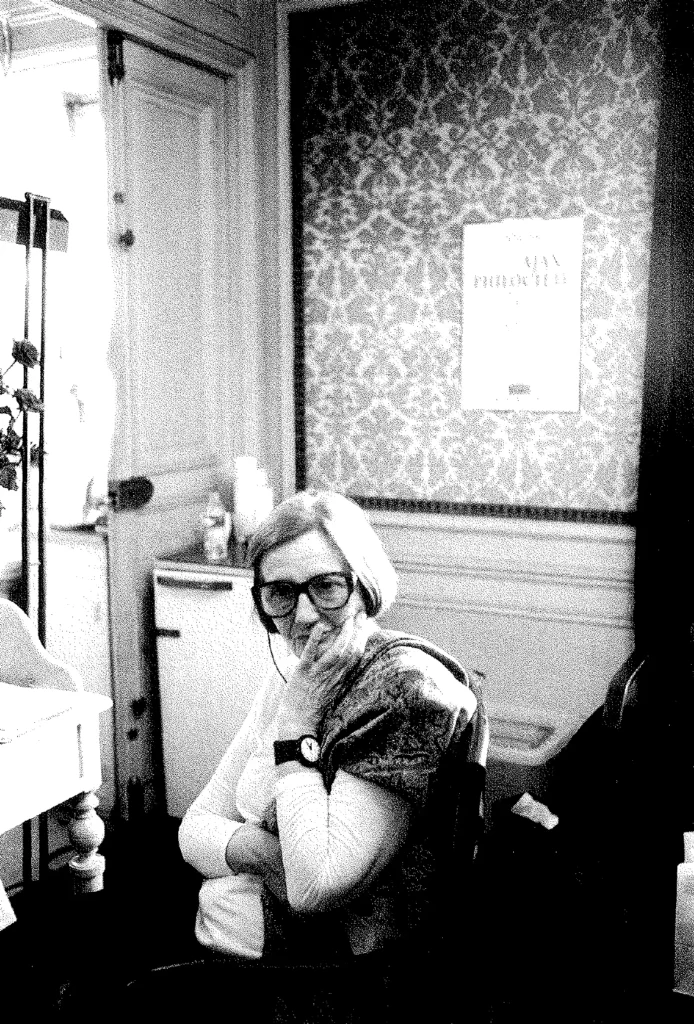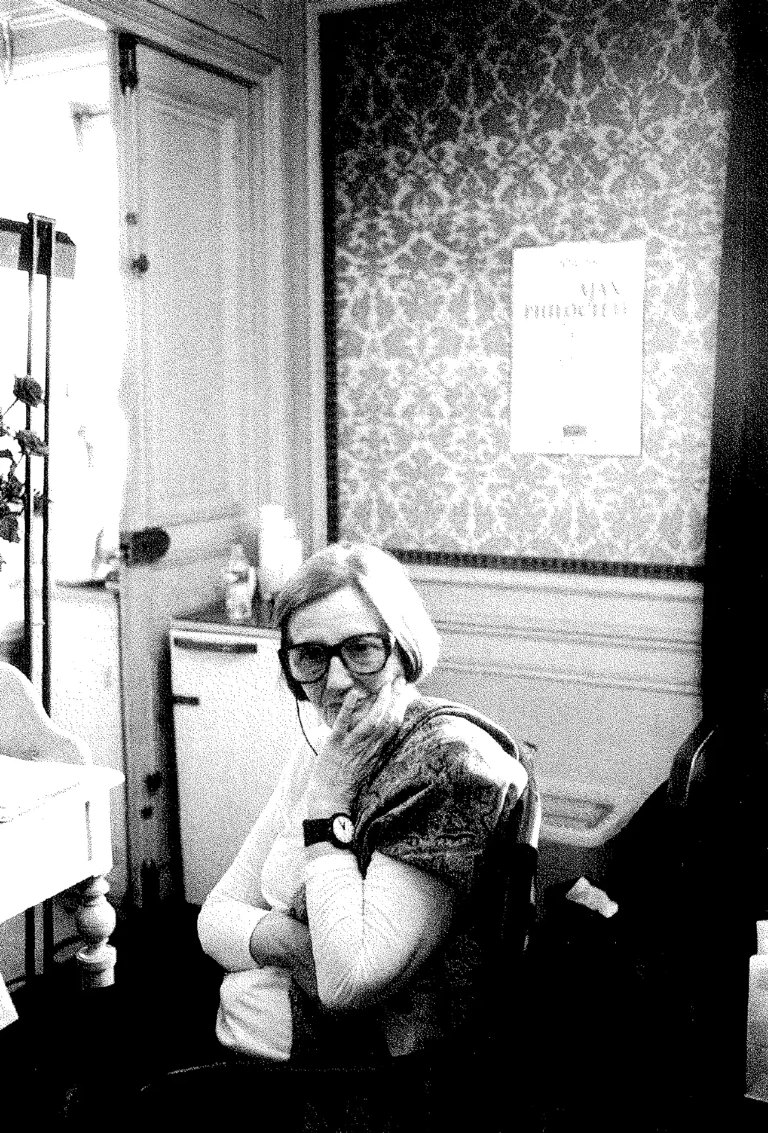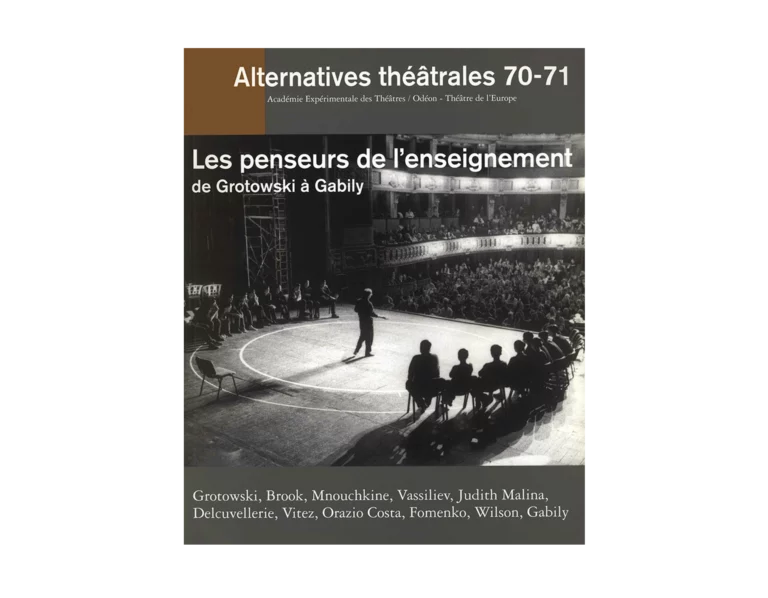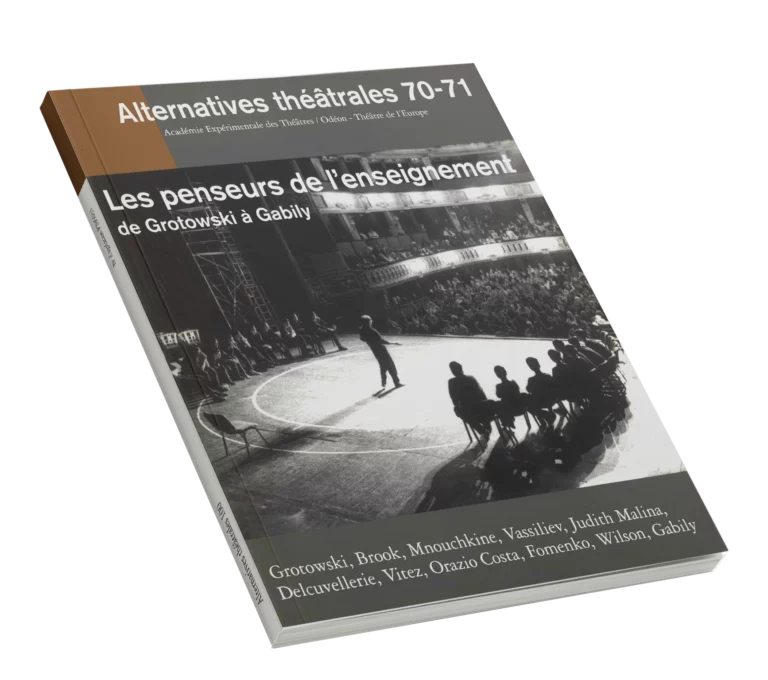PARLER DE LA LANGUE FRANÇAISE, c’est un peu présomptueux. Je ne suis ni professeur de français, ni linguiste, ni un puits de science.
On peut ajouter à cet intitulé plusieurs petits points de suspension, plusieurs points d’interrogation, d’exclamation, etc.
Les étrangers s’extasient sur la beauté, la fluidité de notre langue, mais nous qui la parlons tous les jours, la déformons, la maltraitons, on est souvent bien désarçonnés quand il faut en retrouver la pureté.
Il se trouve que comme actrice j’ai été amenée, peut-être par hasard (il y a toujours du hasard dans le parcours des acteurs) en tout cas par chance, à interpréter ce qu’on appelle : « les beaux textes, les grands textes ». J’ai bien dû me poser, consciemment ou inconsciemment d’ailleurs, le problème du langage. Et pour finir, c’est donc par le texte, par sa composition, ses sonorités que je commence à imaginer une interprétation. Quelques mots, prononcés à haute voix, peuvent me donner une clé que je ne trouverai pas par d’autres procédés.
Mais je ne me voyais pas enseigner, enseignante ; je ne m’imaginais pas transmettre cette manière d’aborder le jeu.
C’est Antoine Vitez qui m’a incitée à entreprendre un atelier à l’École de Chaillot. On sait à quel point il tenait à l’existence d’un espace d’expérimentation au sein d’un théâtre de cette importance. On connaît son texte, les « douze propositions pour l’école ». Je lui suis très reconnaissante de m’avoir fait connaître : « l’école, le plus beau théâtre du monde » selon son expression.
C’était donc un beau cadeau.
Je ne sais pas si on démêle toujours bien les raisons qui vous donnent envie d’être interprète. Peut-être qu’un musicien instrumentiste a tout de suite le goüt des sonorités de tel ou tel instrument et par voie de conséquence de telle ou telle partition. Pour l’aspirant acteur ou l’aspirante actrice, il me semble, une fois l’histoire connue, qu’on se représente une personne dont les agissements, le caractère, la psychologie vous passionnent et qu’on voudrait incarner.
Mais est-ce qu’on la visualise d’abord ou est-ce qu’on l’entend ?
Un peu des deux probablement.
Cependant, pour certains le mouvement entraîne la parole, pour d’autres la parole entraîne le mouvement. C’est bien sûr cela qu’il est précieux de détecter quand on enseigne.
Pousser un élève à une action physique d’où la parole va surgir (courir à perdre haleine, tomber, se coucher sur le dos, sur le ventre, avoir un comportement anarchique, une démarche irrégulière, ne pas être éternellement planté sur ses deux pieds comme une armoire normande — qui, elle, ne peut pas faire autrement car elle en a quatre -), ou chercher avec le plus de précision possible le sens et la construction de la phrase, la respiration, la diction particulière à chaque écrivain (parler : dans le noir, tout bas, chuchoter ou au contraire de très loin, d’une autre pièce, ou au milieu de l’auditoire, etc.).
À vrai dire, il y a tant d’individus différents que le travail est empirique, et je crois que j’ai toujours improvisé les méthodes, sur l’instant.
Mais, de toutes manières, à un moment ou à un autre, il va bien falloir parler.
C’est quelquefois une grande surprise et souvent une grande angoisse de s’entendre avoir l’audace de s’emparer des mots d’un auteur réputé sublime qui a orchestré avec art un certain nombre de syllabes, surtout si, à la fin du compte, cet assemblage est un alexandrin. Et de tout cet appareil respiratoire, vocal, buccal qui est le nôtre, il sort des sons, des mots qui ne retraduisent pas du tout ce qu’on avait le désir d’exprimer.
Alors, bien sûr, le travail technique peut venir à notre secours. (Exercices de respiration, de chant, d’articulation, parallèlement au travail physique, danse, expression corporelle.) Toutes les écoles offrent maintenant des cours de ces disciplines.
Mais il y a comme une résistance à l’émission « vocale », au langage. Il est quelquefois plus facile de dénuder son corps que sa voix. À la limite se mettre tout nu, on peut le faire avec une certaine audace, une idée de provocation. Mais en se mettant nu, on ne montre que son extérieur. D’ailleurs les morceaux du corps habituellement cachés le sont au résultat d’un climat, d’une civilisation, d’une culture … En faisant entendre sa vraie voix, on découvre quelque chose de très intime, son âme en quelque sorte. Il y a comme un trait d’union à trouver entre sa propre intériorité et la parole de l’écrivain.
Dès qu’on aborde les textes des grands auteurs dramatiques, des poètes, on ne peut pas indéfiniment se cacher derrière un ton convenu, des intonations approximatives, un sens flou. Il s’agit de trouver la sincérité de sa voix.
Il n’est naturellement pas question de belle voix, de jolie voix, mais de sa vraie voix, même s’il faut l’augmenter selon les lieux (trop grand, acoustique plus ou moins adéquate à la représentation théâtrale …). Ce n’est pas facile, ce n’est pas toujours réussi, il faut batailler. D’un auteur proche de nous comme Claudel, par exemple, on peut avoir quelques renseignements car il s’est beaucoup exprimé sur la langue française.
Mais Racine et son alexandrin dont on nous vante la perfection … Ces douze syllabes sagement rangées côte à côte par groupes de six, ces finales qui se répètent deux par deux sempiternellement, que faire ?
Le fils de Racine, Louis, rapporte que quand son père lisait ses pièces, son auditoire versait des torrents de larmes. Il rapporte aussi que La Champmeslé, interprète privilégiée du grand dramaturge, perdit totalement son talent dès lors qu’elle fut privée des conseils de son auteur-professeur-metteur en scène et amant.
Est-ce le timbre de la voix, le rythme qui permet de donner vie à tous ces personnages aux passions exacerbées ? Sûrement, avant tout, l’émotion, la sincérité. Mais comment s’y abandonner, contraint de rendre compte de l’alexandrin ? Quel malheur de ne pouvoir entendre Racine dire lui-même quelques-uns de ses vers.
Car cette écriture raffinée, c’est le langage de personnages jaloux jusqu’au crime, usant de chantage, de menaces, tels ces quelques vers d’Agrippine à l’adresse de Néron dans la scène du quatrième acte où elle s’insurge contre l’ingratitude de Néron, où elle relate son propre mariage avec son oncle, en fait :
Agrippine :
Mais ce lien du sang qui nous joignait tous deux
Écartait Claudius d’un lit incestueux.
Il n’osait épouser la fille de son frère.
Le sénat fut séduit. Une loi moins sévère
Mit Claude dans mon lit, et Rome à mes genoux.
C’était beaucoup pour moi, ce n’était rien pour vous.
On ne peut être plus brutale : « Mit Claude clans mon lit, et Rome à mes genoux. / C’était beaucoup pour moi, ce n’était rien pour vous ». Trivial même !
On raconte que la grande tragédienne Rachel remit au goût du jour la tragédie classique tombée en disgrâce avec l’arrivée et le succès du drame romantique et du mélodrame.
C’était un peu une fille des rues, ses parents étaient colporteurs et bien qu’elle ait eu d’éminents professeurs (Samson), elle n’avait pas vraiment d’instruction et n’avait pas fréquenté les beautés de la langue française dès l’enfance.
Et pourtant sa gestuelle parfaite, son beau visage austère et sombre mais aussi son timbre de voix grave et envoûtant impressionnèrent vivement le public qui se passionna de nouveau pour Hermione, Roxane, Phèdre, etc.
Autre « sublimissime » Phèdre : Sarah Bernhardt. D’elle, on possède un enregistrement. Vu l’époque de l’enregistrement, on ne peut pas juger de sa tessiture vocale et on est bien en peine d’apprécier cette voix qu’on disait « d’or ». Mais elle semble, dans la scène dite « de la déclaration à Hippolyte », animée d’une fébrilité incandescente.
Par contre, elle n’a rien à faire des « e » muets, ni des diérèses, ni des incidentes, ni des rimes féminines ; contrairement à l’idée reçue, je crois qu’on se préoccupe plus à notre époque de toutes ces choses. On en discute, on s’oppose, on écrit des livres, des traités, etc.
Mais alors où est le mystère de la fascination que certains interprètes ont exercée ?
Il y a un texte de Balzac, retenu par Claudel dans son journal et aussi par Michel Bernardy dans son livre LE JEU VERBAL. Il s’agit de l’héroïne du Lys dans la vallée :
« Le souffle de son âme se déployait dans les replis des syllabes, comme le son se divise sous les clés d’une flûte ; il expirait onduleusement à l’oreille d’où il précipitait l’action du sang. Sa façon de dire les terminaisons en i faisait croire à quelque chant d’oiseau. Le ch prononcé par elle était une caresse, et la manière dont elle attaquait les t accusait le despotisme du coeur. Elle étendait ainsi, sans le savoir, le sens des mots, et vous entraînait l’âme dans un monde surhumain. Combien de fois n’ai-je pas laissé continuer une discussion que je pouvais finir, combien de fois ne me suis-je pas fait injustement gronder pour écouter ces concerts de voix humaine, pour aspirer l’air qui sortait de sa lèvre chargé de son âme, pour étreindre cette lumière parlée avec l’ardeur que j’aurais mise à serrer la comtesse sur mon sein ».
Au même titre qu’un joli corps, un beau visage, la voix et la diction de l’héroïne ensorcellent le héros balzacien.
Pour revenir au travail que j’ai commencé à Chaillot, il s’agissait de mettre l’accent sur l’alexandrin classique, celui de Hugo, le vers libre de Claudel, ce que j’avais le plus expérimenté en jouant.
On avait baptisé cet atelier « La parole proférée », ce qui implique une idée d’emphase, de grandiloquence qui ne manquera pas de faire sourire. En effet, Racine, lui, n’a pas besoin « des grandes orgues » comme on dit ! Grossir ou pousser la voix dans ses textes ne sert à rien. Cela n’exclut pas le cri mais c’est tout autre chose. Mais on fait quelquefois un amalgame avec ce qu’on imagine de la voix projetée par le masque et la scansion des textes des tragiques grecs, probablement parce qu’ils sont sa source d’inspiration. À moins que ce ne soit une réminiscence de l’ampleur que nécessite le vers hugolien, par exemple, qui serait, par tradition, venue du XIXe siècle jusqu’à nous. Toujours est-il qu’on avait choisi cette appellation pour opposer le parlé-chanté, comme dit Antoine Vitez, à un supposé naturel. D’ailleurs, voici deux textes de lui à propos de ses mises en scène de PHÈDRE et de BRITANNICUS.
Voici une citation d’Antoine Vitez à propos des héros raciniens :
« Ces gens ne sont occupés que d’eux-mêmes, ils se font des plaies horribles ou se disent des choses tendres de tout près avec élégance en alexandrins ; l’alexandrin ici n’est pas une gêne, il est l’instrument même de la cruauté ».
Plus tard, quand il met en scène BRITANNICUS :
« Voilà qui surprend toujours : Racine est le poète du naturel. Le naturel apparaît inattendu dans un vers qui sonne soudain comme une phrase ordinaire, banale ; on croit qu’elle est en prose et pourtant c’est bien un vers ; on compte jusqu’à douze : oui, cela est la vertu moderne de Racine, cette désinvolture qui le distingue des tragiques avant lui. En cela il ne ressemble qu’à Mozart ».
Quoi de plus simple en effet que ce vers de Roxane dans BAJAZET :
Bajazet, écoutez, je sens que je vous aime
On peut le dire, on l’a peut-être dit. Il suffit de trouver un prénom de trois syllabes qui nous soit familier (car on n’a pas toujours l’occasion de déclarer son amour à quelqu’un prénommé Bajazet).
Ou bien cette réponse de Junie à Néron.
Après le discours de Néron volontairement encombré dont voici les quatre derniers vers :
Songez‑y donc, Madame, et pesez en vous-même
Ce choix digne des soins d’un prince qui vous aime ;
Digne de vos beaux yeux trop longtemps captivés,
Digne de l’univers à qui vous vous devez.
Est-ce que les répétitions ne sont pas bannies en français ? Trois fois l’adjectif « digne » !!! Évidemment, Racine l’emploie sciemment. Voilà ce que je pense devoir signaler au jeune acteur, à mon élève. C’est un support pour lui et non un discours monotone, c’est un support pour jouer l’insistance odieuse de Néron.
Réponse de Junie, simplicité parfaite :
Seigneur, avec raison je demeure étonnée.
Je me vois dans le cours d’une même journée.
Comme une criminelle amenée en ces lieux :
Et lorsqu’avec frayeur je parais à vos yeux,
Que sur mon innocence à peine je me fie,
Vous m’offrez tout d’un coup la place d’Octavie.
J’ose dire pourtant que je n’ai mérité
Ni cet excès d’honneur, ni cette indignité.
Il y a un usage admirable des rimes féminines chez Racine.
Ici la voyelle « é » (accent aigu) accolée à l’ « e » muet (journée / étonnée), et plus loin le « i » accolé à l’ « e » muet (fie / Octavie) permettent de donner une légère durée à ces quatre syllabes finales. C’est comme des ondes qui prolongeraient une note de musique tenue.
Ces rimes, comme suspendues, expriment l’appréhension et en même temps la pudeur de Junie.
Si je fais ressentir à l’actrice ces petits événements dans la respiration et dans la diction, j’espère qu’elle sera guidée pour jouer la situation et trouver sa propre émotion.
Autre problème : la césure à l’hémistiche. Quand on est en proie à ces deux fois six syllabes, le vertige vous prend devant cette régularité. Racine en déjoue parfaitement les pièges.
Il fait dire à Phèdre s’adressant à Œnone dans la scène dite « de la jalousie » au quatrième acte :
1 2 3
Ils s’aiment ! Par quel charme ont-ils trompé mes yeux ?
Comment se sont-ils vus ? Depuis quand ? Dans quels lieux ?
1 2 3 4
Tu le savais. Pourquoi me laissais-tu séduire ?
De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m’instruire ?
On est naturellement amené à faire un petit arrêt dans le premier vers après « Ils s’aiment », donc après la troisième syllabe, et dans le quatrième vers après « Tu le savais », donc après la quatrième syllabe. Donc chez Racine, exit l’obligation d’indiquer une césure à l’hémistiche. En désorganisant le texte, l’actrice, ici aussi, est guidée pour éprouver le chaos intérieur de Phèdre. C’est-à-dire que Racine nous met sur le chemin de l’expression, de l’émotion au lieu de nous barrer la route.
Et cet « e » muet, objet de tant de soucis !!!
Si on le prononce avec la même valeur que les autres syllabes on tombe dans la récitation scolaire :
La cigale ayant chanté tout l’été
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Cependant, on ne peut pas l’occulter comme dans la prose, puisqu’il compte pour un pied. Mais par exemple, dans ces quatre premiers vers de Phèdre, à son entrée :
N’allons point plus avant. Demeurons, chère Œnone.
Je ne me soutiens plus. Ma force m’abandonne.
Mes yeux sont éblouis du jour que je revois,
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi.
Hélas !
En allégeant les « e » muets de « force » et de « dérobent », ce qui entraîne un léger étirement de la syllabe précédente, une fois encore le vers se déséquilibre.
N’allons point plus avant. Demeurons, chère Œnone.
Je ne me soutiens plus. Ma force m’abandonne.
Mes yeux sont éblouis du jour que je revois,
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi.
Hélas !
Ces deux petites dépressions produites par le rétrécissement de l’« e » muet, c’est comme un faux-pas.
Je peux alors parler avec l’interprète de l’état proche de l’évanouissement de Phèdre.
En d’autres occasions, on peut au contraire lui donner toute sa valeur à cet « e » muet, pour rendre le discours plus lourd, plus volontaire, autoritaire ; Agrippine toujours dans la scène avec Néron :
De Claude en même temps épuisant les richesses
Ma main, sous votre nom, répandait ses largesses.
Les spectacles, les dons, invincibles appâts
Vous attiraient les coeurs du peuple, et des soldats.
Ici, cette pesanteur accentue le reproche fait à Néron.
Mais ne nous a‑t-on pas expliqué cent fois qu’il n’y a ni longues ni brèves en français, qu’une phrase est composée d’un certain nombre de syllabes de valeur égale, terminée par un accent tonique qui donne le sens ?
Bien sûr, un mot français ne comporte à priori pas d’accent fort ou faible comme en italien, par exemple.
Mais cette phrase française, cette ligne horizontale peut comporter de légers étirements ou resserrements comme un fil qui se tend ou se détend, comme un influx nerveux qui se précipite, se casse, s’épuise ou se calme.
Et puis, est-ce que les doubles ou triples voyelles n’allongent pas légèrement la prononciation ?
Par exemple ce vers célèbre d’Hippolyte dans PHÈDRE :
Le jour n’est pas si pur que le fond de mon cœur
Autre subtilité racinienne, le déséquilibre de l’ordre logique de la phrase par l’emploi des incidentes, des inversions, des rejets …
Claudel note, à propos des premières lignes de SALAMMBÔ de Gustave Flaubert qu’il n’apprécie pas du tout
- voici donc le texte de Flaubert :
« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. Les soldats qu’il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d’Eryx et comme le maître était absent et qu’ils étaient très nombreux, ils mangeaient et buvaient en pleine liberté … »
Claudel note :
« Le défaut du français qui est de venir d’un mouvement accéléré se précipiter la tête en avant sur la dernière syllabe n’est ici pallié par aucun artifice. L’auteur semble ignorer le ballon des féminines, la grande aile de l’incidente qui, loin d’alourdir la phrase, l’allège et ne lui permet de toucher à terre que tout son sens épuisé ».
Ce n’est pas, bien sûr, Racine qui ignore « le ballon des féminines », ni « la grande aile de l’incidente » — témoins les premiers vers d’Oreste à Hermione.
Hermione :
Le croirai-je, Seigneur, qu’un reste de tendresse
Vous fasse ici chercher une triste princesse ?
Ou ne dois-je imputer qu’à votre seul devoir,
L’ heureux empressement qui vous porte à me voir ?
Oreste :
Tel est, / de mon amour / l’aveuglement funeste.
Vous le savez, Madame, et le destin d’Oreste
Est de venir sans cesse adorer vos attraits,
Et de jurer toujours qu’il n’y viendra jamais.
Sans endiguer l’imagination de l’acteur, il est intéressant de lui faire prendre conscience de l’incidente. En opposant immédiatement le mot « amour », dans la bouche d’Oreste, au mot « devoir » prononcé par Hermione, Racine indique tout de suite à quel point l’aveu de cet amour lui brûle les lèvres.
Andromaque, également, à Pyrrhus parlant de son fils Astyanax :
Hélas ! il mourra donc. Il n’a pour sa défense,
Que les pleurs de sa mère, et que son innocence
En projetant « pour sa défense » comme premier élément de la phrase, Andromaque culpabilise immédiatement Pyrrhus.
Et pour faire sentir cette construction particulière, on peut laisser un petit espace comme un soupir en musique, avant et après l’incidente :
Hélas ! il mourra donc. Il n’a pour / sa défense, /
Que les pleurs de sa mère, et que son innocence
Il faudrait aussi parler des diérèses et des synérèses.
Bérénice à Antiochus à la quatrième scène du premier acte, répondant au discours amoureux plutôt mal venu de celui-ci :
Je n’en ai point troublé le cours injurieux.
Je fais plus. À regret je reçois vos adieux.
« injuri-eux », diérèse, « adieux », synérèse, la même sonorité et pas tout à fait le même rythme, comme sur une partition musicale, deux croches, une noire.
Et puis, il y a chez Racine une science miraculeuse des exclamations, des mouvements du coeur pourrait-on dire.
Bérénice quand Antiochus lui révèle la trahison de Titus.
Antiochus :
Je connais votre cœur. Vous devez vous attendre
Que je le vais frapper par l’endroit le plus tendre.
Titus m’a commandé …
Bérénice :
Quoi ?
Antiochus :
De vous déclarer
Qu’à jamais l’un de l’autre il faut vous séparer.
Bérénice :
Nous séparer ? Qui ? Moi ! Titus de Bérénice !
Antiochus :
Il faut que / devant vous / je lui rende justice.
Tout ce que / dans un cœur / sensible et généreux
L’amour / au désespoir / peut rassembler d’affreux,
Je l’ai vu dans le sien. Il pleure, il vous adore.
Mais enfin que lui sert de vous aimer encore ?
Une reine est suspecte à l’empire romain.
Il faut vous séparer, et vous partez demain.
Bérénice :
Nous séparer ! Hélas, Phénice !
Phénice :
Hé bien, Madame !
Il faut ici montrer la grandeur de votre âme.
Le coup est tel que le cerveau n’enregistre plus.
« Nous séparer ? Qui ? Moi ! Titus de Bérénice ! »
Antiochus alors se lance dans de fumeuses explications et pendant ce temps je voudrais entraîner l’actrice à comprendre ce vide, ce rien dont est victime Bérénice. Ce qu’on croit ordinairement réservé à un théâtre plus récent, à Tchekhov par exemple, l’aider à trouver au fond d’elle-même cette vacance.
Autre exclamation géniale chez Oreste encore, avec Hermione, voulant la convaincre de quitter Pyrrhus.
Oreste :
Madame, faites plus, et venez‑y vous-même.
Voulez-vous demeurer pour otage en ces lieux ?
Venez dans tou les cœurs faire parler vos yeux.
Faisons de notre haine une commune attaque.
Hermione :
Mais, Seigneur, cependant s’il épouse Andromaque ?
Oreste :
Hé Madame !
Hermione :
Songez quelle honte pour nom,
Si d’une Phrygienne il devenait l’époux !
Au cri du coeur d’Hermione, seulement cette petite interjection : « Eh Madame ! » pour faire entendre sa déception, la fin de son espérance amoureuse.
On pourrait, à l’infini, trouver dans Racine des sujets d’émerveillement, c’est un puits sans fond. Peut-être la fameuse déclaration de Phèdre à Hippolyte est-elle parfaitement exemplaire de tout l’art de Racine, les rimes féminines, les « e » muets, les incidentes …
Voici le texte :
Hippolyte :
Je vois de votre amour l’effet prodigieux.
Tout mort qu’il est, Thésée est présent à vos yeux.
Toujours de son amour votre âme est embrasée.
Phèdre :
Oui, Prince, je languis, je brûle pour Thésée.
Je l’aime, non point tel que l’ont vu les Enfers,
Volage adorateur de mille objets divers,
Qui va du dieu des morts déshonorer la couche ;
Mais fidèle, mais fier ; et même un peu farouche,
Charmant, jeune, traînant tous les coeurs après soi,
Tel qu’on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois.
Il avait votre port, vos yeux, votre langage,
Cette noble pudeur colorait son visage
Lorsque de notre Crète il traversa les flots,
Digne sujet des voeux des filles de Minos.
Que faisiez vous alors ? Pourquoi sans Hippolyte,
Des héros de la Grèce assembla-t-il l’élite ?
Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors
Entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ?
Par vous aurait péri le monstre de la Crète,
Malgré tom les détours de sa vaste retraite.
Pour en développer l’embarras incertain
Ma soeur du fil fatal eût armé votre main.
Mais non., dans ce dessein je l’aurais devancée.
L’amour m’en eût d’abord inspiré la pensée.
C’est moi, Prince, c’est moi dont l’utile secours
Vous eût du labyrinthe enseigné les détours.
Que de soins m’eût coûtés cette tête charmante !
Un fil n’ eût point assez rassuré votre amante.
Compagne du péril qu’il vous fallait chercher,
Moi-même devant vous j’aurais voulu marcher,
Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendue,
Se serait avec vous retrouvée, ou perdue.
Mais, dans ces rencontres que j’ai pu faire, ici ou là avec de jeunes comédiens, ce n’est bien sûr pas pour faire uniquement des explications de texte, c’est pour leur donner le plus possible le moyen d’approcher ces personnages, de les investir, de les incarner.
Après tout, on ne sait pas comment parlaient Racine et ses contemporains. Les liaisons se font de moins en moins, l’oreille de l’auditeur peut être surprise, voire amusée par des assemblages obsolètes, désuets. Le célèbre vers d’Andromaque
« Et peut-être après tout en l’état où je suis »
Alors, « l’état où je suis » ou « l’état / où je suis » ?
Est-ce bien nécessaire de se poser éternellement la question du hiatus et malgré les règles de l’époque qui voulaient que toutes les syllabes se lient dans un vers, une jeune comédienne ne peut-elle pas choisir, en disant ces deux vers de Bérénice, entre :
Cette bouche, à mes yeux s’avouant infidèle
M’ordonnât elle-même une absence éternelle
ou bien
Cette bouche, à mes yeux s’avouant infidèle
M’ordonnât / elle-même / une absence éternelle
Car, malgré l’Académie qui protège farouchement notre langue comme une vierge intouchable ou une veuve respectable, on ne peut empêcher que le langage, l’émission ne changent !
Cet « e » muet, si difficile à négocier, revient là où on ne l’attendait pas :
chez les présentateurs de télévision, « l’Arc(que) de triomphe », par exemple, dans le langage populaire, « bonjour(e) … »
Ce même langage populaire actuel n’a pas de rapport avec celui qu’on entendait il y a une cinquantaine d’années ; le grasseyement du titi parisien qui faisait le charme des films de Marcel Carné et la gloire d’Arletty — « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère » — tend à disparaître.
Les jeunes des banlieues, des quartiers sensibles comme on dit, ont une émission, un rythme, des accents toniques inconnus autrefois et ce sont eux qui sont détenteurs d’un nouveau phrasé qui forcément influencera le langage. L’accent tonique sur la première syllabe qu’on détecte chez les présentateurs de télévision, à cause de la lecture du prompteur je présume, finira bien par se glisser dans une parole très académique, très soignée. D’ailleurs le grand écrivain, le grand poète, Paul Claudel a remis en question l’alexandrin et beaucoup d’idées préconçues sur notre langue ; il faut absolument lire POSITIONS ET PROPOSITIONS SUR LE VERS FRANÇAIS pour trouver, retrouver l’envie de faire de la parole l’élément essentiel de l’expression théâtrale.
Je vous lis ce texte que tout le monde connaît peut-être mais qui est essentiel :
« On ne pense pas d’une manière continue, pas davantage qu’on ne sent d’une manière continue ou qu’on ne vit d’une manière continue. Il y a des coupures, il y a intervention du néant. La pensée bat comme la cervelle et le coeur. Notre appareil à penser en état de chargement ne débite pas une ligne ininterrompue, il fournit par éclairs, secousses, une masse disjointe d’idées, images, souvenirs, notions, concepts, puis se détend avant que l’esprit se réalise à l’état de conscience dans un nouvel acte. Sur cette matière première, l’écrivain éclairé par sa raison et son goût et guidé par un but plus ou moins distinctement perçu travaille, mais il est impossible de donner une image exacte des allures de la pensée si l’on ne tient pas compte du blanc et de l’intermittence.
Tel est le vers essentiel et primordial, l’élément premier du langage, antérieur aux mots eux-mêmes : une idée isolée par du blanc. Avant le mot une certaine intensité, qualité et proportion de tension spirituelle ».
Ces blancs, ces interventions du néant proposés par lui sont des indications qui m’ont été très précieuses autant pour jouer moi-même que dans l’enseignement que j’ai pu donner. Ce vers libre, c’est comme un ressort à l’intérieur de soi qui vous projette sur le vers suivant par une reprise de respiration.
Tel est son presque premier texte dit par Cébès dans TÊTE D’OR :
Me voici
Imbécile, ignorant
Homme nouveau devant les choses inconnues
Et je tourne ma face vers l’arche pluvieuse, j’ai plein mon cœur d’ennui.
etc.
Cette écriture ne permet pas l’anecdote, elle pousse l’acteur à l’essentiel.
Claudel pourfend violemment l’alexandrin comme mode d’expression pour l’écriture dramatique (mais non pas pour le poème épique).
Voilà ce qu’ il écrit :
« L’erreur la plus grossière de l’alexandrin qui devient insoutenable dès que l’oreille s’est formée à la règle que je viens d’énoncer plus haut, c’est qu’il fausse le principe essentiel de la phonétique française en attribuant à chaque syllabe une valeur égale, tandis qu’une forte longue par exemple a besoin pour sa pleine résolution non seulement d’un grand blanc qui l’accueille, mais d’un nombre suffisant de brèves et de longues moindres qui la préparent. La musique du langage est une chose vraiment trop délicate et complexe pour qu’elle se contente d’un procédé aussi rudimentaire et barbare que simplement compter. Il y a un proverbe qui dit que le français sait compter. C’est pourquoi à la scène les acteurs sont forcés de transformer les alexandrins, d’avaler les rimes, de déplacer les césures, de changer le nombre des syllabes, en un mot de faire quelque chose qui ne ressemble plus en rien au texte écrit. C’est la vie qui reprend ses droits. Du moment où l’alexandrin a perdu son caractère mnémotechnique et lapidaire, pour s’essayer à la musique, il était condamné à la ruine. L’oreille n’a aucune raison de se contenter d’une seule combinaison assez pauvre au lieu de mille autres plus riches et plus agréables.
Secundo, mais laissons là le secundo et le numéro trois et la quatrièmement ! Et admirons bien plutôt sur le visage de notre interlocuteur cette satisfaction honnête et apostolique qui convient aux bienfaiteurs de l’humanité. Quelle joie pour lui d’avoir apporté la délivrance enfin à tous ces Andromèdes de sous-préfecture qui ayant dans leur innocence donné le jour à un vers du genre de celuici : « Le soleil s’est couché dans l’or et dans la pourpre » ont vu leurs plus belles années se flétrir dans l’attente de l’oiseau miraculeux qui leur apportera la rime indispensable et impossible ! Voici l’homme qui a séparé enfin le couple maudit d’arbre et marbre et a rafraîchi l’étreinte de ces vocables damnés, oncle et furoncle ! »
Cela dit, s’il a repoussé les faiseurs d’alexandrin en bloc au début de sa vie, il est revenu, à l’égard de Racine, sur son opinion. Dans ses MÉMOIRES IMPROVISÉES, entretiens avec Jean Amrouche, il dit :
Puisque j’en ai l’occasion, je dois dire que dans les trois grands drames de Racine, BRITANNICUS, PHÈDRE et ATHALIE, dans aucue langue au monde, ni dans Shakespeare, ni dans les Grecs, ni nulle part on ne trouve quelque chose d’équivalent. Je trouve que ce sont des chefs d’œuvres … mais des chefs d’œuvres qui me sont étrangers…
Victor Hugo également qui a démantelé l’alexandrin classique en introduisant la fameuse notion de grotesque et sublime, écrit dans la préface de CROMWELL :
Il est incontestable cependant qu’il y a surtout du génie dans cette prodigieuse Athalie si haute et si simplement sublime que le siècle royal n’a pas pu comprendre.
(Effectivement ATHALIE, au contraire d’ESTHER, n’a pas été représentée mais seulement lue au roi Louis XIV.)
C’est dire que Racine échappe à toutes les critiques et c’est pour cela que c’est presque un passage obligé dans l’enseignement.
Claudel en tout cas est un incroyable tremplin pour l’acteur, il le pousse dans ses retranchements. Il faut s’engager corps et âme. Il écrit lui-même quelque part que la seule émission d’un mot engage toute la personne physique.
Il dit aussi qu’ on parle souvent de la couleur, de la saveur des mots, lui parle de tension.
Comment en effet ne pas s’impliquer entièrement quand Mara exige la sainteté de sa soeur pour obtenir la résurrection de son enfant avec cette parole venue du fond d’elle-même :
Mara :
Et je crie, vers toi de la profondeur où je suis !
Violaine ! Violaine !
Rend-moi cet enfant que je t’ai donné ! Eh bien ! je cède,
je m’humilie mais rend-le moi ma sœur !
Violaine :
Celui-là seul qui l’a pris peut le rendre !
( … )
Mara :
Ah ! Fillasse ah ! coeur de brebis, si j’avais accès comme toi à ton Dieu,
il ne m’arracherait mes petits si facilement
« Fillasse », ce mot qu’on n’avait pas entendu au théâtre avant lui, c’est comme une claque.
Ou Lumir :
La Pologne, pour moi c’est cette raie rose dans la neige, là-bas, pendant que nous fuyons.
Chassés de notre pays par un autre plus fort
Cette raie dans la neige éternellement
Je crois que cette simple image nous renvoie mieux que beaucoup d’explications le sentiment de l’exil.
Cébès dans TÊTE D’OR à l’heure de sa mort :
Le froid matin violet
glisse sur les plaines éloignées, teignent chaque ornière de sa magie !
Et dans les fermes muettes, les coqs crient :
Cocorico !
C’est l’heure où le voyageur blotti dans sa voiture
Se réveille et, regardant au dehors, tousse et soupire
Et les âmes nouvellement nées le long des murs et des bois,
Poussant, comme les petits oiseaux tous nus de faibles cris,
Refuient, guidées par les météores, vers les régions de l’obscurité
Quoi de plus poignant que l’évocation de ce nouveau jour qui commence et que Cébès ne verra pas : « le froid matin violet ».
Comment ne pas être stupéfait devant l’audace de cette scène du cimetière dans PARTAGE DE MIDI ?
Qui avant lui avait osé donner la parole non pas au sentiment amoureux et à ses méandres, mais à l’acte d’amour et à sa violence volcanique ?
Mésa à Ysé :
Et je te sens, sous moi, passionnément qui abjure et en moi, le profond dérangement
De la création, comme la Terre
Lorsque l’écume aux lèvres elle produisait la chose aride et que dans un rétrécissement effroyable
Elle faisait sortir la substance et le repli des monts comme de la pâte !
Et voici, une sécession dans mon coeur, et tu es
Ysé et je me retourne monstrueusement
Vers toi, et tu es Ysé !
Et tout m’est égal, et tu m’aimes et je suis le plus fort !
On a rarement connu une telle hardiesse.
Que dire du SOULIER DE SATIN dont la première didascalie est : « La scène de ce drame est le monde » ? Tout acteur jeune, vieux, débutant ou confirmé peut y trouver sa place.
Tous les thèmes y sont abordés, la foi, la spiritualité, le blasphème, la morale, l’amour, la chair, la sensualité, le surnaturel, l’ambition, la vaillance, la bêtise, c’est un portrait de l’humanité.
Évidemment si on parle de la langue française il faudrait évoquer Corneille, Molière, Hugo, Musset, Jean Genet, etc., etc., d’autres encore. Mais en tant que professeur, de plus vieux (plus vieille), d’aînée selon l’expression d’Antoine Vitez, je me suis attachée à faire éprouver aux plus jeunes toutes ces émotions que j’avais ressenties en jouant ces textes et à ce que ces mystérieuses sonorités ne soient pas un handicap mais un soutien pour cette grande affaire qui est la représentation théâtrale.
Voilà ce que mes anciens élèves me disent avoir retenu de nos rencontres. Quelles que soient la mise en scène et la facture des textes, ils auront le souci de la partition, du verbe. Ils seront armés pour jeter un pont entre le spectateur et eux.
Pour finir il faut savoir qu’un acteur peut toujours réinventer le langage. Des rencontres extraordinaires se sont produites entre une écriture et le phrasé d’un acteur. Qui n’a pas entendu Alain Cuny parler Claudel ne peut s’imaginer l’osmose inouïe entre cette langue et cette émission en même temps retenue et profonde, cette voix aux harmoniques d’une richesse incroyable. Curieusement la courbe de sa phrase était presque monotone et pourtant un acteur de cette nature vous tient plus en suspend qu’un fin diseur qui possède ses règles de syntaxe à fond (grand souvenir de TÊTE D’OR avec Laurent Terzieff et lui !).
Curieusement aussi, Maria Casarès, l’admirable, avec ce timbre de voix déchiré, cette pointe d’accent, s’est approprié la prose de Victor Hugo dans MARIE TUDOR et lui a donné une originalité, une nouveauté surprenante. Et maintenant, il y a quelques jours, ici même, comme Redjep Mitrovitsa a forgé, inventé un phrasé inattendu, envoûtant pour cette prose de Molière qu’on se croit tenu de rendre naturelle !
Comme il est allé au coeur des mots au lieu de « surfer » sur le texte comme on aurait tendance à le faire.
Rien n’est jamais fini, rien n’est jamais arrêté, c’est pourquoi « le pédagogue » doit guetter sans cesse la trouvaille, la nouveauté, la petite surprise qui se cache au fond de chaque individu.