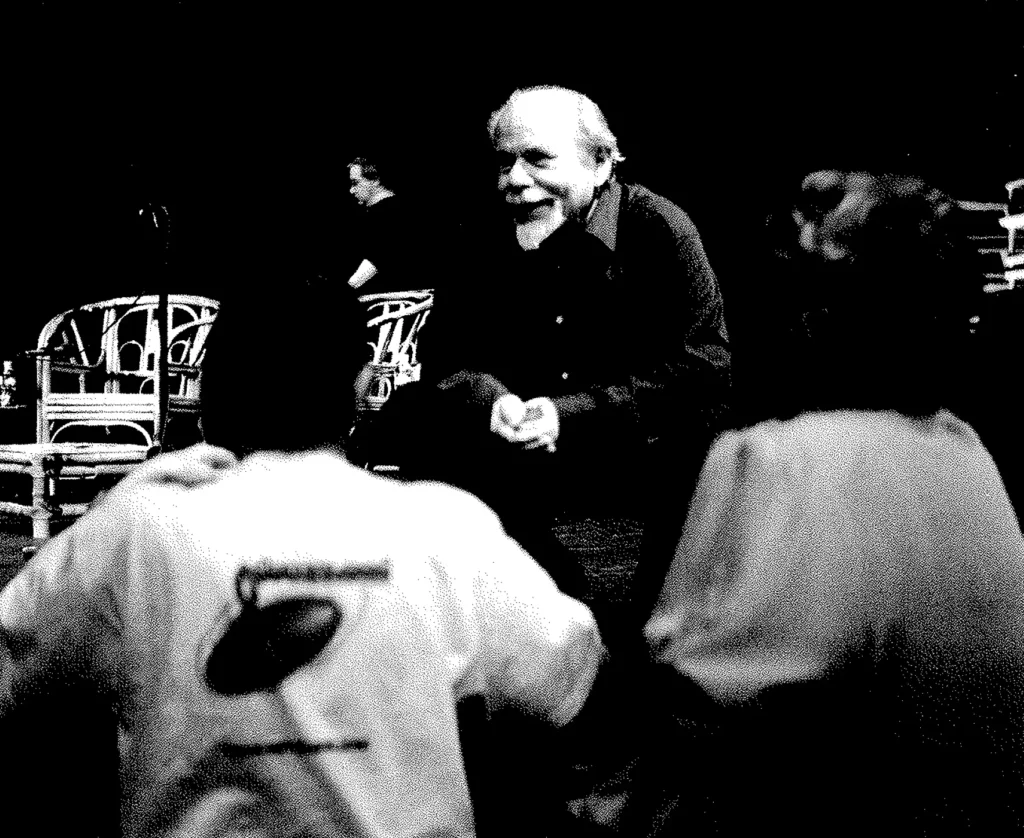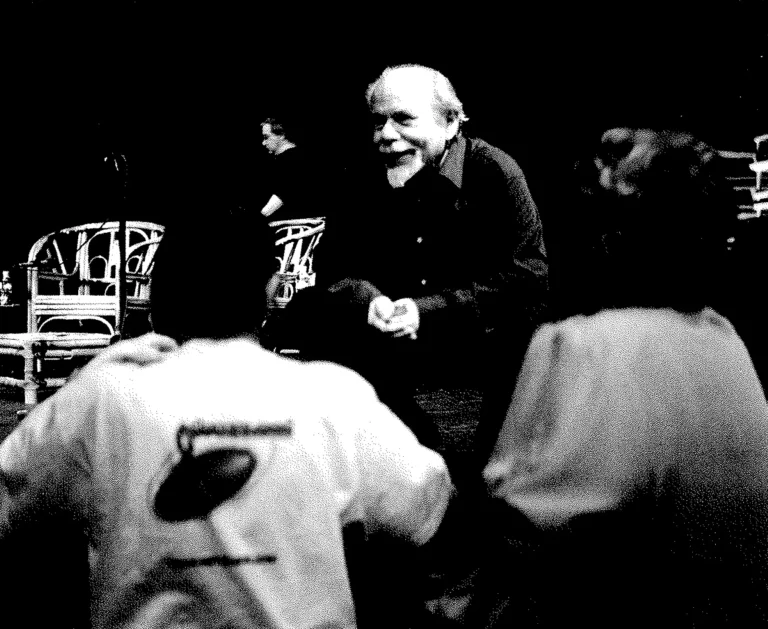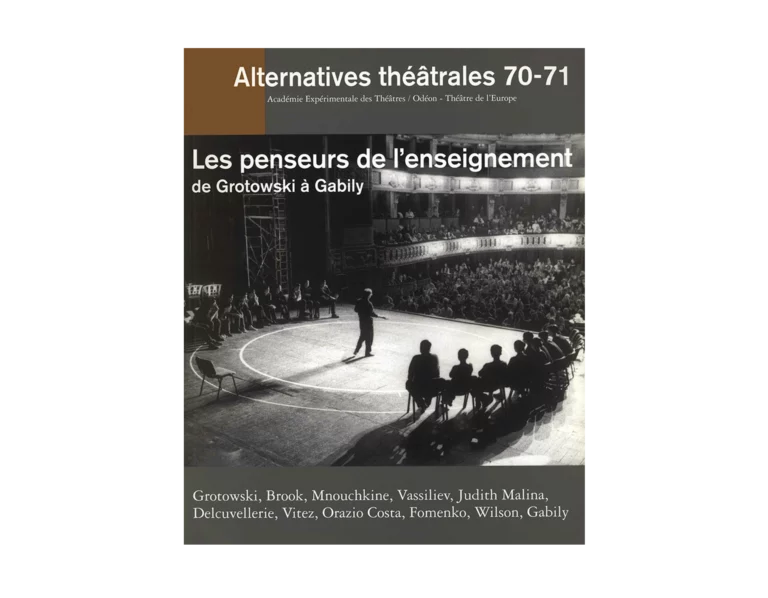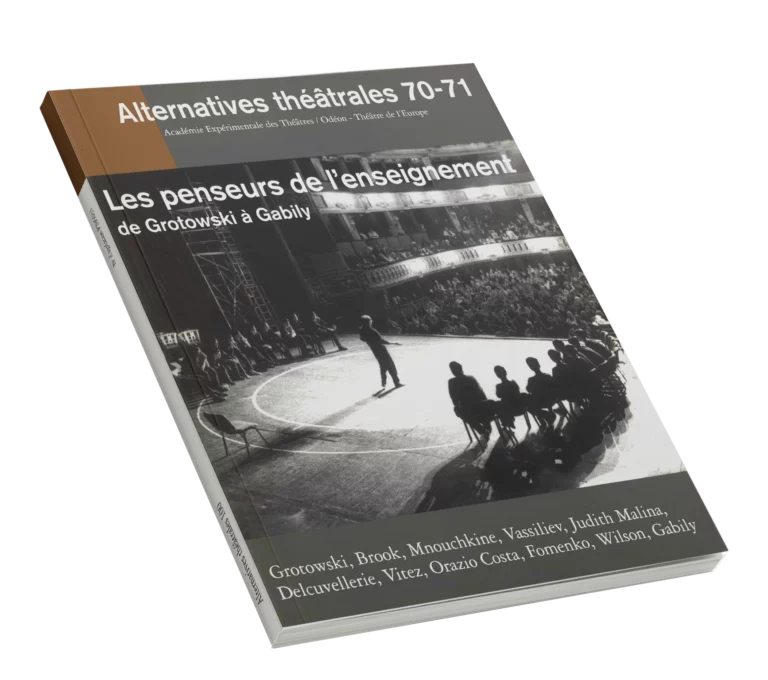Texte écrit à partir d’une intervention orale au symposium les laboratoires théâtraux, les théâtres-studios en Europe au XXe siècle. les techniques et les valeurs. Repérage. Du 24 au 27 avril 1997 au siège du centre de recherches sur l’oeuvre de Grotowski — Wroclaw. le symposium était organisé en collaboration avec les théâtrologues italiens Franco Ruffini de l’Université Rome III et Ferdinando Taviani de l’Université d’Acguilla. le Symposium était dédié à Fabrizio Crucian et Konstantyn Puzyna. Texte traduit du polonais par Magdalena Marek et revu par l’auteur.
CE QUE JE VAIS VOUS DIRE, ne sera peut-être pas particulièrement précis, car comme je n’ai pas préparé par écrit mon exposé, je vais improviser à partir des notes. Mais ce n’est pas seulement pour cette raison qu’il ne sera pas précis.
J’avoue avec regret, pour ne pas dire, avec peine, que je ne me sens pas à la hauteur, pour préciser terminologiquement, avec la rigueur scientifique qui conviendrait, des termes comme « laboratoire », « studio », « théâtre de studio » et il faudrait y ajouter aussi celui d’« institut ».
On a dit ici des choses qui apportent un éclairage nouveau et complexe, ce qui prouve que l’objet de nos réflexions en commun n’est pas si simple. Je me sers en partie de ce qu’ont déjà dit mes prédécesseurs, mais je dois reconnaître que je me sens plus proche du point de vue de ceux qui affirment suivre un chemin purement empirique, sans souci excessif pour ce qui est de la précision des définitions. D’ailleurs, vu les sujets des exposés, il est évident que c’est l’empirisme qui anime les organisateurs de notre symposium.
Pour ajouter encore quelques doutes concernant les définitions, on peut, par exemple, poser la question tout à fait pragmatique : pourquoi dans notre siècle, et plus particulièrement dans des moments et contextes précis, certains créateurs et chercheurs ont jugé nécessaire d’appeler leurs organismes : laboratoires, studios ou instituts ?
D’autre part que faire avec un Kantor ? Est-ce que ce serait complètement absurde, si on ajoutait au nom « Cricot 2 » le mot de « laboratoire » ou « studio », même si évidemment — ce que nous a rappellé ici Zbigniew Osinski — ce grand artiste, à la seule idée d’une telle opération, éclaterait d’un rire sarcastique ? Pourtant il serait dommage d’exclure Kantor de nos réflexions. Comme d’ailleurs d’autres — compagnons secrets auxquels les mots clés de notre symposium ne conviennent pas du tout.
Acceptons donc comme principe que l’objet de notre exploration est protéiforme, et qu’il cache de multiples paradoxes.
Franco Ruffini, me devançant, a posé le problème du professionnalisme et de l’amateurisme. Comme nous le savons, beaucoup de réformateurs renommés du théâtre du XXe siècle ont commencé en tant qu’amateurs. Ils n’étaient pas des professionnels ni des gens du métier. Les véritables « professionnels » représentaient, dans la plupart des cas, le théâtre de la routine.
Pour ne pas chercher plus loin il suffit de citer le cas du maître Stanislavski lui-même. Ce promoteur emblématique du haut professionnalisme et de la rigueur dans le métier est issu du mouvement amateur. À vrai dire, il était un honnête autodidacte. Pendant des années entières il a animé des travaux et a dirigé des ateliers de théâtre amateur au sein de ce que l’on désignait par le terme de « cercles dramatiques ». Et, avec le temps, c’est justement lui qui est devenu le père fondateur, pour ne pas dire le patriarche de la mouvance des laboratoires et des studios nés plus tard. Grotowski qui se considérait comme son descendant direct est devenu à son tour, grâce à notre Théâtre Laboratoire, une source d’ inspiration, un point de repère pour ce type de pratiques. D’où certainement l’idée de ce symposium qui se tient précisément dans ces murs.
Et Boleslaw Limanowski, professeur de géologie, co-fondateur du célèbre Théâtre Reduta, n’a-t-il pas fait l’objet des moqueries pour son dilettantisme de la part de tout le milieu théâtral, spécialité des « professionnels » de Varsovie ?
Cette liste on pourrait la poursuivre.
Prenons le cas de Grotowski. Au début de sa carrière il avait derrière lui une formation théâtrale de fond, d’acteur et de metteur en scène, dans le sens classique du terme. Mais en tant que créateur, et directeur d’acteurs, il pénétrait en usurpateur sur des terrains où, en réalité, il ne possédait aucune préparation professionnelle. Les spectacles de Grotowski se fondaient sur des incantations, sur des actions corporelles et vocales, sur la démarche psychophysique de l’acteur, qu’il n’a pas pu apprendre au Conservatoire. Là-bas il apprenait le chant classique au piano, le solfège, l’interprétation des chansons, l’escrime, différentes danses, la gymnastique etc. ce qui n’avait pas beaucoup à voir avec la triple chorée, qui réunissait mouvement rythmé, chant et parole poétique, triple chorée utilisée dans AKROPOLIS, L’HISTOIRE TRAGIQUE DU DOCTEUR FAUST, LE PRINCE CONSTANT, APOCALYPSIS CUM FIGURIS. Tout ce qu’il y avait d’essentiel dans son travail, il l’a appris tout seul, regardant, expérimentant, testant, bricolant avec des comédiens, dialoguant avec les partenaires de ses recherches (essentiel a été le travail sur SAKUNTALA, spectacle charnière de 1960. Ce fut le premier spectacle où l’on avait élaboré une partition précise des réponses vocales et corporelles des acteurs). Grotowski était donc (excuse-moi mon cher Jerzy !) en quelque sorte un autodidacte. Et en plus je crois que même pour le yoga qu’il estimait indispensable dans ses recherches, il s’initiait en grande partie seul.
Les relations des gens de la mouvance « laboratoirestudio », avec ce qu’on appelle en langage courant le professionnalisme, se présentent, pour de multiples raisons, comme étant atypiques. Disant cela, je voudrais insister sur le fait, connnu par ailleurs, que le lieu préféré de leurs activités était souvent les « institutions » où il ont pratiqué un travail fervent d’autodidactes. Ceci est vrai pour les acteurs, comme pour les metteurs en scène.
Pour les élèves, mais aussi pour les maîtres. Là on cultive la création, on pratique le métier — mais on enseigne aussi le métier. On l’enseigne en pratiquant avec les autres et en apprenant ainsi soi-même. On appelait cela avec des termes aujourd’hui un peu obsolètes : expérimentation, recherches, recherches créatives.
Dans le laboratoire ou le studio rien n’est définitif, tout est en devenir, tout est en processus et la didactique est en symbiose constante avec la création, évoluant avec elle, et étant parfois interchangeable avec elle dans une zone intermédiaire ambiguë. Là-bas pour l’entraînement quotidien de l’acteur, aussi bien que de l’homme tout entier, les frontières sont considérées comme étant mobiles. Il y a tout de même des termes qui n’ont pas vieilli : le travail de l’acteur sur soi-même. Le travail sur soi.
Le fait même de placer à côté de grands noms du théâtre mondial le mot dilettante — le fait de les associer au statut de l’autodidacte, sans rappeler que beaucoup d’entre eux sont à l’origine des amateurs — semble aujourd’hui en ces temps de culte du tout professionnel, une injure — ou une provocation. Mais le problème n’est pas de savoir si on a eu une formation régulière et un diplôme. Le problème, concerne l’acquisition de compétences réelles à travers une pratique — quel que soit le chemin qui y mène (laissant de côté la question du talent !). De temps en temps on y arrive grâce au vol talentueux à la manière d’un pickpocket, et par usurpation. Napoléon lors de son sacre s’est mis lui-même sa couronne sur la tête — comme Kantor, comme tant d’autres. Nos laboratoires, nos studios et leurs satellites sont souvent l’équivalent des couveuses des « montres sacrés » qui en même temps y chassent.
D’autre part, rappelons que d’habitude l’amateurisme a pour ambition d’imiter gentiment le théâtre professionnel tel qu’il est. (Ce dont — quelle horreur ! — s’occupait le jeune Stanislavski, son esprit d’explorateur s’étant révélé en lui un peu plus tard.) Par contre les autodidactes que nous évoquons ici ont la vision d’un autre théâtre, ils souhaitent faire un théâtre en rupture avec ce que l’on considère comme étant le théâtre professionnel, ils veulent le réparer, le reformer, et peut être aussi dans un élan créateur juvénile — l’anéantir, afin de tout recommencer. Ou bien avec obstination construire à côté, sans se soucier du voisinage — c’est ce qui arrive quand on est plus mûr ! Les autodidactes sont donc, même s’ils restent modestes, les messies de l’innovation, indépendamment de leurs origines, qu’ils soient peintres, hommes de lettres, ou professeurs de géologie, ou — comme Soulerjitzki, collaborateur de Stanislavski, — vagabonds d’origine indéterminée, ou comme Grotowski — brillants anciens élèves des conservatoires, s’efforçant d’oublier ce qu’ils avaient appris, afin de recommencer à partir du point zéro auquel ils rêvent car chargé de la fascination de l’inconnu.
À la mouvance laboratoire — studio (et ses équivalents) nous devons l’un des paradoxes du théâtre de notre siècle ; car, de manière différente par rapport aux siècles précédents (ou peut-être pareillement ?), le théâtre s’est constitué en campement de vagabonds d’origines très diverses, le bivouac des chercheurs de sens et de vocations, l’oasis de l’échange entre des nomades pérégrinant en quête d’un eldorado, d’une patrie commune où jaillissent les sources de toute la Création. Les uns commençaient ici — et finissaient ici ; les autres commençaient ailleurs et finissaient ici. D’autres commençaient ici, et partaient vers d’autres cieux. D’autres encore commençant et finissant ailleurs, pour ne séjourner ici que quelque temps.
Lech Raczak, ici présent, est, si je ne me trompe pas, un réfugié venu de la Faculté de Lettres Polonaises. Wlodek Staniewski, Teo Spychalski, le regretté Jacek Zmyslowski — aussi. Moi-même je suis parvenu à ce campement en étant presque un rejeton révolté des Lettres Polonaises. Maintenant je prends conscience non sans étonnement, que notre Théâtre-Laboratoire était le campement des « polonisants » sortis des rails.
Le Professeur Degler a rappelé que nous avons tous fait des études honnêtement, et que nous sommes, en quelque sorte, des vagabonds rigoureux, décents, dignes et socialement respectables, bref des vagabonds munis de diplômes d’université.
Fermons cette plaisante parenthèse.
Théâtre-campement. .. Si on associe cette métaphore (peut-être semi-métaphore ?) aux questions soulevées ici par nos amis italiens, à savoir la problématique de l’ eurocentrisme et la nécessité de le dépasser par l’anthropologie théâtrale de Barba et Savarese dans le cadre de l’ISTA — il sera évident qu’en ocurrence cette métaphore est un fait concret dans le domaine de l’anthropologie appliquée. Car nos laboratoires, nos studios (et les structures aparentées) sont souvent, littéralement, des lieux de rencontre des représentants de différents peuples, cultures, traditions, aussi bien dans le travail, dans l’action que dans l’échange lors des différentes d’expériences. Comme cela se passe encore aujourd’hui au Workcenter de Grotowski en Italie ou au Centre de Recherches Théâtrales de Brook à Paris. Rappelons qu’autrefois notre Théâtre-Laboratoire à Wroclaw fut, lui aussi, un tel campement — de même que Brzezinka aux environs d’Olesnica où Grotowski dressa une base pour réaliser ses projets transculturels dans le cadre du Théâtre des Sources.
Un tel échange de gens, de techniques, et de valeurs nomades toujours à la recherche d’une Source commune, semble être une caractéristique de la mouvance laboratoire-studio de notre époque. Célèbre dans l’histoire du théâtre, la collaboration de Craig avec Stanislavski nous rappelle plutôt des vedettes étrangères en tournée sur les scènes officiels.
On tourne dès lors autour des questions du métissage — et cela à plusieurs niveaux à la fois. On peut remarquer une tendance naturelle dans notre domaine, tendance qui consiste à unir des éléments hétérogènes et souvent contradictoires. Ici, presque par principe, on associe le théâtre à quelque chose d’autre, à quelque chose qui n’est pas le théâtre. Ici on célèbre, si je peux dire, la noce particulière du Théâtre avec le Non-Théâtre.
Le but d’un telle noce peut être théâtral : on cherche une inspiration stimulante dans d’autres disciplines, quelquefois plus séduisantes que l’art scénique, prédisposé, lui, à prendre des poses conventionnelles. Il arrive que le but soit extra-théâtral, et le théâtre se présente pour ainsi dire comme étant l’outil le mieux adapté pour canaliser et articuler d’autres désirs et d’autres élans. Il y a certainement aussi des cas où il est difficile de cerner la nature de l’impulsion originaire : Théâtre ou Non-Théâtre. Ce va-et-vient entre les deux peut être aussi, quelquefois, un jeu d’alibis commodes, une stratégie créatrice raffinée.
Nous avons des preuves. Par exemple la tendance communautaire qui a dominé les dernières décennies et dont Leszek Raczak a admirablement parlé à partir de ses expériences. Elle témoigne de la volonté de rendre réelle une utopie sociale ici et maintenant, grâce à la mise en place urgente, dans le contexte d’une civilisation mécanisée, ou oppressive, d’une petite communauté organique. Bien sûr que nous pensons au Living Theatre avec sa soif de PARADISE NOW ! …
La contestation politique notoire, brillamment représentée en Pologne par le même Théâtre du Huitième Jour dirigé par Raczak et aussi un exemple plus récent : l’écologie théâtrale de Gardzienice.
La contestation politique notoire, brillamment représentée en Pologne par le même Théâtre du Huitième Jour dirigé par Raczak et aussi un exemple plus récent : l’écologie théâtrale de Gardzienice. Passons à la question du théâtre et du rituel. Les principaux artisans de cette noce, dans notre siècle — Artaud, et avant lui, le théâtre Redouta par le recours au romantisme des AÏEUX de Mickiewicz. Et, plus tard — Grotowski et notre Théâtre Laboratoire, avec la soif très moderne du rituel, de la dimension chamanique et des traditions lointaines et perdues. Est-ce que dans le travail du metteur en scène débutant qu’était Grotowski, il s’agissait de théâtre, ou bien d’une fusion mimétique avec les rythmes cosmiques de la danse de Shiva dont à l’époque Grotowski parlait d’une manière étrange dans ses écrits ? Si d’une manière réductrice, il fallait définir la constante dans le parcours d’une quarantaine d’années de Grotowski, parcours rempli de détours et de revirements surprenants, on pourrait dire, qu’il s’agissait de l’union du théâtre et du yoga.
Dans le parcours erratique de Grotowski la période où il créait des spectacles a été décisive : nos recherches se cristallisaient alors autour du « théâtre pauvre ». Le principe fondateur de ce travail, était le suivant : se diriger vers une hypothétique « essence » du théâtre, explorer ses arcanes comme un art différent des autres, d’une manière pratique, hors de toute fascination pour les doctrines, trouver un passage vers une dimension qui dépasse le théâtre. Pour Grotowski — inconsciemment — le théâtre était toujours un instrument, il était le véhicule. Jadis c’était le théâtre, aujourd’hui c’est la subtile discipline du non — spectacle. Mais le chemin vers la danse de Shiva passait par la porte étroite du « théâtre pauvre », à travers la remise en cause du fondement même du métier par la rigueur technique et la précision de l’acteur. Le frère aimé du performer c’est l’acteur.
Stanislavski mariait-il le théâtre avec autre chose ? Il est difficile de le dire d’emblée, car pour lui il s’agissait avant tout de théâtre. Il le mariait certainement avec une dramaturgie particulièrement moderne pour son époque, celle de Tchekhov, Gorki, Maeterlinck. Avec la littérature donc. Ce vénérable trisaïeul de la mouvance laboratoire-studio, avait d’ailleurs lui-même beaucoup des traits typiques d’une star de la scène, homme d’une belle allure qui évoque un chevalier de ballade romantique, avec une chevelure exubérante (type que Grotowski appelait « witez ») . Mais les inquiétudes de l’explorateur le rongeaient. L’exaltation métaphysique ne lui était pas inconnue, et elle se manifestait dans la rhétorique grandiloquente de ses écrits, par ailleurs strictement professionnels. En cachette, il puisait probablement dans Freud, qui à l’époque était considéré en Russie comme le maître de l’éros mystique — et à partir de lui Stanislavski a glissé, dans sa méthodologie du métier d’acteur, le terme de « subconscient ». Il s’intéressait au yoga, et il était semble-t-il fasciné par la théosophie, conseillant à l’acteur de s’exercer au « rayonnement » (izloutchenia). Son « obchtchenie » c’est le terme clé du système, signifiant le contact de l’acteur avec son partenaire, réminiscence de la nostalgie russe de la « sobornosti », la communion des âmes dont le théâtre peut devenir la demeure sacrée.
Franco Ruffini parlait ici de Gurdjieff en relation avec le théâtre français. À juste titre ! Gurdjieff présentait publiquement des danses dont les éléments sont intéressants en tant qu’exercices d’acteurs. On sait que les gens du théâtre éprouvent une attirance particulière pour les sciences ésotériques, et dans le courant laboratoire-studio on retrouve plus fréquemment qu’à l’habitude diverses filiations ésotériques.
Cela s’explique, outre par le désir d’Absolu, fréquent chez les artistes, par une vision du monde propre aux différents ésotérismes qui est « émanatiste » (il s’agit de la hiérarchie des êtres où à partir de Dieu qui se trouve au centre émanent des rayons jusqu’à la matière) ou, pour dire plus simplement, énergétique. Ici tout n’est qu’une pulsation des énergies qui se présentent à des degrés de concentration différents et sont en train de se transformer, de circuler, de se sublimer. L’accès à ces mystérieuses énergies, ainsi que leur maîtrise dans un but créatif, fait rêver les comédiens et leurs maîtres. Les exercices spirituels traditionnels, y compris les asanas du yoga, deviennent le training de l’acteur. Comme si — traduit dans le langage des détails techniques — il s’agissait de l’ascension vers une dimension inconnue, où la barrière entre l’esprit et le corps s’annule, et où l’esprit devient corporel, et le corps spirituel. Cela rappelle l’oxymore d’Artaud : l’athlétisme affectif.
Il est évident — et les quelques fils conducteurs de notre débat le prouvent — qu’on ne peut pas parler des laboratoires et des studios (et leurs équivalents), sans pénétrer dans des zones considérées comme douteuses, suspectes, dangereuses. Zones interdites — mais aussi zones qui deviennent facilement la cible des railleries de l’esprit « éclairé ». C’est le risque naturel de toute initiative non orthodoxe.
Ainsi donc, pour survivre, il faut avoir recours aux diverses tactiques de dissimulation, aux astuces, aux ruses auroprotectrices à l’égard des princes, bailleurs de fonds, il faut résister aux lobbies idéologiques des organismes officiels et faire face à l’esprit conservateur de l’opinion publique. Et ceci tout particulièrement dans les régimes totalitaires, encore que cela puisse arriver ailleurs. Il faut chercher une faille dans le système, et dans cette faille s’asseoir : pratique d’ailleurs largement répandue dans la Pologne du « socialisme réel », où le totalitarisme heureusement était un totalitarisme troué.
Il s’agissait de créer un lieu d’activité qui profiterait des avantages d’un théâtre institutionnel en Pologne, mais libre de toute obligation vis-à-vis de l’extérieur, et des pressions idéologiques. Le Théâtre Laboratoire était une créature bizarre avec un statut juridique, disons « hermaphrodite » : il avait à la fois le statut peu contraignant propre aux activités des artistes amateurs, et en même temps il bénéficiat de tous les droits d’un théâtre professionnel. Pour tirer profit de cette situation nous avons utilisé successivement les formules suivantes : « théâtre expérimental », « théâtre laboratoire », et enfin « institut de recherches pour le jeu de l’acteur ». Si le terme « expérimental » renvoie à la notion d’expériment — donc il implique le droit de commettre des erreurs, « s’il est expérimental il expérimente ». Le terme « laboratoire » suppose que ces expériences sont soit fermées soit effectuées avec un public restreint, et que les spectacles ne sont pas porteurs d’une quelconque idéologie dangereuse, mais qu’ils se consacrent à la recherche des modèles de travail pour le jeu d’acteur. Le terme « institut des recherches » implique qu’on n’est même pas obligé de produire des spectacles. Par ce biais nous nous sommes déchargés de certaines tâches lourdes propres à un théâtre institutionnel comme le répertoire régulier soumis à la censure politique qui imposait de jouer des pièces russes et soviétiques et surtout l’obligation de se mettre au service du spectateur de masse etc. De plus, les répétitions, et toutes sortes de travaux intérieurs vite devenus l’occasion d’entraînements intensifs, véritables marathons de création, n’étaient pas soumis à la censure.
Comme on le voit, nous faisions plein de références à la science : laboratoire, institut, méthode, recherche etc. On pourrait dire que pour les pratiques de Grotowski et de son équipe, comme dans la science, le critère majeur c’était l’empirisme, l’efficacité de l’expérience, l’objectivité du résultat final ; que les travaux, comme dans un laboratoire de physique nucléaire — L’Institut Niels Bohr a été pendant un certain temps l’exemple préféré de Grotowski — exigeaient de longs et systématiques essais, avec une équipe bien choisie ; car Grotowski, héraut d’un travail d’acteur de haute précision, cherchait à atteindre, dans ce domaine, la précision quasi scientifique. Mais ce ne sont que des rapprochements, des métaphores, des analogies. L’objet de nos recherches, d’ailleurs on le disait publiquement, était différent, car par sa nature il échappait à la rigueur scientifique stricto sensu. (Dans la doctrine officielle de l’État et du Parti il y avait un coin réservé à la « spécificité de l’art ».) Mais l’utilisation du langage scientifique permettait d’une façon « scientifique », donc apparemment en conformité avec l’idéologie du régime qui se qualifiait de « scientifique », de justifier la raison d’être du modèle d’organisation du Théâtre Laboratoire, cette créature sans précédent et de parler d’une manière rationnelle, éclairée et sobre de « l’acte total » tout en protégeant son mystère, plus proche du Saint Jean de la Croix que de Niels Bohr.
Il est vrai que, périodiquement, on faisait appel à différentes sciences comme, par exemple, l’anatomie, la phoniatrie, la psychologie, la théâtrologie — mais on travaillait plus particulièrement sur l’anthropologie et son étude des mythes, des rituels etc. On entretenait aussi des contacts avec des gens intéressants, spécialistes de différents domaines scientifiques. En réalité, dans le processus de création on se servait d’un langage « intentionnel », des images éveillant l’imaginaire ou d’un argot technique, créé ad hoc. Chassé du sanctuaire, le langage savant servait surtout à l’usage extérieur.
Par ailleurs, nous n’étions pas les premiers ni les derniers à employer le langage scientifique — et même l’argot scientifique — avec une finalité, je dirais, « exotérique ». Nos remarquables prédécesseurs procédaient de la même manière, sans oublier même ceux qui ont eu la chance d’agir à une époque plus clémente que nous.
Les mots clés, dans nos déclarations officielles, étaient les adjectifs : « laïc » et « séculier ». Tout était laïc et séculier — je me rappelle avoir utilisé le terme de « mystère laïc ». Comment le « mystère » peut-il être laïc alors que ce terme relève de l’initiation spirituelle ? Nous avons délibérément opéré à la lisière du théâtre et, excusez le mot, des expériences religieuses. Les plus grands blasphèmes de Grotowski lui servaient à nouer un dialogue vivant, « fascinans et tremens », avec le Sacré qui s’était endormi dans les âmes des propriétaires de petites voitures épris par le goût de la consommation et soumis à la religion de la routine. Cela fut évident pour toute personne qui a vu AKROPOLIS, LE PRINCE CONSTANT OU APOCALYPSIS CUM FIGURIS.
Or, il y avait, dans tout cela des choses hautement suspectes : pour ceux qui nous subventionnaient (un tel mysticisme financé par l’argent de l’État socialiste !), pour l’Église, (pire que des blasphèmes, « ce sont des messes noires » disait-elle, car certainement, supposait-elle, ils bricolent une secte hérétique !) pour le cartésien des bords de la Vistule (sont-elles sérieuses ces expériences douteuses ?) et pour l’Européen Moderne (ce sont peut-être des catholiques polonais obscurantistes). Il fallait donc rassurer. Tandis qu’aux amis, par contre, on envoyait des signaux comme quoi on ne proclamait aucune doctrine religieuse, et que pour être proches de nous il ne fallait faire aucune déclaration de foi.
La « laïcité » était notre bouclier pour ainsi dire « giratoire » : il nous permettait de nous protéger de toutes les attaques venant de tous côtés.
D’ailleurs proclamer d’emblée qu’on pratiquait un « théâtre religieux » aurait été suicidaire, et peu sérieux. Surtout à l’époque. Aujourd’hui ces mots se prononcent facilement, en toute sécurité, sans vergogne, mais en pratique est-ce vraiment plus facile ? En Pologne, ce pays catholique où est l’art religieux vivant ?
Cacher des choses sous des mots-écrans présente toujours certains avantages … Le chemin de Grotowski, on le voit plus clairement après qu’il a quitté le métier de metteur en scène, échappe aux classifications. Il est le créateur si on peut dire — métaphysiquement prudent — qui noue avec l’Absolu, de manière artisanale et pragmatique, un rapport obstiné, mais toujours teinté d’ironie …
Je ne dis pas tout cela en tant qu’ancien combattant, vieux compagnon des batailles de Grotowski, comme « son oncle » Paul. J’aimerais faire prendre conscience à ceux qui ne le savent pas, que dans le trousseau de clés dont on a besoin pour ouvrir la porte : « laboratoire, studio » et leurs « équivalents », il ne doit pas manquer quelques petites clés marquées des étiquettes suivantes : « façade — intérieur », « tactique de protection — essence des choses », « éxoterique — ésotérique ».
Cela fait aussi partie des paradoxes liés à l’objet de notre exploration. Ce qui est particulièrement propre aux initiatives qui n’ont pas fini comme de beaux rêves éphémères.
Comment exister en tant qu’institution ayant une existence légale et des moyens financiers minimaux, tout en étant un organisme effectif de création ? Comment acquérir une subvention tout en étant au fond de soi un révolté ? Comment rester non-conformiste et rebelle en bénéficiant d’une subvention ? Comment mener le jeu avec les pouvoirs officiels et avec l’opinion publique routinière tout en gardant son indépendance intérieure face « aux charmes des gens puissants » et aux déterminismes imposés par le grand nombre ? Comment ruser — et s’il le faut — tricher avec les mécènes, en changeant, comme le camélon, les couleurs de protection sans que cela affecte votre identité profonde ? Comment émettre des signes qui tromperaient les dangereux ennemis, sans pour autant tromper les amis ? Comment gagner les amis) Comment savoir quand il faut cesser le jeu ? Quelles sont les limites à ne pas dépasser ?
Je suppose que les pères fondateurs devaient eux aussi répondre à des questions similaires. Et ce quel que soit le régime et à des degrés différents selon le climat historique. Mais chose curieuse — et peut-être significative ! — la plupart des expériences phares ont eu lieu, et ont été accomplies sous des systèmes autoritaires, dont faisait partie — ce que l’on oublie — la Russie tsariste, mère de notre mouvance des studios où régnait une très forte censure politique et religieuse. Ici je risquerais une thèse : les systèmes autoritaires en phase d’affaiblissement ont été pour les créateurs les terres les plus fertiles.
La majorité des initiateurs des laboratoires, studios (et leur équivalents) ont donné libre cours à leurs pulsions non orthodoxes dans le cadre de petites cellules de création, qui, par leur nature, se dérobaient plus facilement au contrôle et aux oppressions tout en satisfaisant les élans novateurs. Certains, ayant à leur disposition des lieux importants ont voulu échapper à la logique des grandes machines conformistes en créant à côté, des petits lieux où ils se sentaient plus à l’aise, lieux qui leur permettaient de faire ce qui les intéressait vraiment.
Le vieux Stanislavski s’est retiré du Théâtre d’Art de Moscou devenu conformiste, et s’est abrité de l’idéocratie stalinienne vorace derrière les murs du Studio d’Opéra-Dramatique. Il enseignait dans sa maison particulière où il poursuivait ses travaux sur la méthode des actions physiques : ainsi protégé il faisait ce qu’il avait à faire. En même temps, il transformait légèrement le langage de sa méthode et ses références scientifiques. Il introduisait une terminologie proche de la psychologie de Pavlov qui alors était devenu en URSS la doctrine officielle. Il se montrait prudent, même s’il n’avait rien à craindre de la part du « Petit Père des peuples ». Je suppose que l’opéra, qui était néanmoins une de ses passions, lui servait plutôt de couverture : étant par nature un art de cour, l’opéra paraissait mois suspect aux gouvernants qui, de surcroît, aimaient parfois s’écarter de leurs principes au nom de la gratuité du beau. Le vieux maître et le cercle restreint de ses collaborateurs n’avaient pas d’obligation impérative de produire des spectacles, c’est pourquoi ils étaient plus libres dans le choix des matériaux littéraires ; ils travaillaient hors de portée de la censure bien que pas tout à fait à l’abri des mouchards. Le studio comme asile ou refuge du maître retraité couronnait l’oeuvre de sa vie.
Prenons aussi le cas de Brecht qui — par ailleurs, comme on le sait — était un grand renard et trouvait son plaisir dans le louvoiement raffiné. Jusqu’à quel point son argot marxiste — didactique exprimait-il ses intentions fondamentales de créateur, et jusqu’à quel point cachait-il, derrière ce rideau de fumée, sa pratique non orthodoxe ? D’ailleurs l’un n’exclut pas nécessairement l’autre. Le langage du marxisme est idéal pour exprimer le mépris du monde. Et la tonalité de la parabole didactique qui était propre à Brecht, parabole ptoche de la fable populaire, peut se convertir, pour des rustres, avec un peu de naïveté maligne, en éloge des valeurs d’un monde où règne la force nue et non pas les principes.
Le célèbre « Verfremdungseffekt » (effet de distanciation) est sans doute le véritable procédé créatif de Brecht pour le travail de l’acteur afin de structurer de la vision scénique et de mettre en place le montage poétique des contradictions. Brecht restait tout de même en désaccord avec le réalisme socialiste stalinien et avec la poétique officielle des épigones de Stanislavski qui imposaient à l’époque le vérisme basé sur le vécu — perejivanie — et sur la méthode des actions physiques au service du vérisme. Brecht disait que pour lui la distanciation permettait d’obtenir de la froide distance dialectique assurant la connaissance de la nature de classe de la société, et que, par ailleurs, sa rigueur rationaliste démasquait la conscience bourgeoise aliénée etc. Du vivant de Brecht, le Berliner Ensemble n’était pas très bien vu en R.D.A. Je serais enclin à croire qu’en utilisant des expressions et des amalgames marxistes qui avaient la couleur du discours officiel, Brecht contentait Pick et Ulbricht — tout en pratiquant son théâtre réel. C’est une hypothèse à vérifier.
J’ai vu les grands spectacles de Brecht qui, en 1952 je crois, ont provoqué un énorme scandale lors de la tournée du Berliner Ensemble dans la Pologne stalinienne. Ils n’étaient pas du tout froids, ni rationalistes, ni analytiques — ils étaient chauds, poétiques — et j’aurais l’audace de dire — magiques. Était-ce contre la volonté de son créateur, antiaristotélicien avoué ? Prenant « à la lettre » les théories de Brecht, des metteurs en scène occidentaux, plus tard, ont produit des réalisations scéniques ennuyeuses et didactiques. Où commence la vérité dans les théories de Brecht, et où commence le rideau de fumée qui n’a été dressé qu’à l’intention du régime ?
Parlons du théâtre Redouta. Dans son initulé on retrouve le terme « institut » — moderne, modeste, objectif. Les fondateurs de Redouta utilisaient aussi les termes « laboratoire », « scientifique » etc. Mais, si ma mémoire ne me trompe pas, Limanowski, son co-créateur, se moque dans ses propos du scientisme.
Comme beaucoup d’autres, l’équipe de Redouta, sans se priver du répertoire léger, faisait un théâtre pour le grand public, et pour tout le Varsovie chic qu’elle méprisait en cachette. Osterwa — plein de charmes, filou sur le plateau, était un homme mondain et séducteur dans la vie. Par contre à l’intérieur de Redouta régnait l’austérité monastique et la rigueur qui faisaient d’elle une sorte de couvent de franciscains : ses membres se livraient à des pratiques théâtrales mêlées aux pratiques de dévotion, et à de grands devoirs messianiques sans fin qui se présentaient comme des travaux préparatoires au « Mystère ». Osterwa devenait alors prieur, directeur des consciences et maître spirituel. Et tout cela s’appelle laboratoire.
On pouvait y voir une bizarrerie, semble-t-il, mais en Pologne ce pays de grands poètes à allure prophétique et armés du bouclier sacré, un tel paradoxe était encore acceptable malgré les moqueries du milieu théâtral. Cependant derrière ce mysticisme national se cachaient d’autres ésotérismes extraordinaires à l’époque (grâce aux spécialistes ici présents, les recherches sur les secrets de Redouta avancent) — esotérismes ayant pour leader Rudolf Steiner qui envisageait lare-fondation des Mystères par la quête des « gestes cosmiques originels ». De plus je viens d’apprendre avec stupeur qu’Osterwa — ce catholique si pieux — appartenait à la franc-maçonnerie.
Alors, de l’extérieur, Redouta apparaissait comme un théâtre public normal, un peu plus innovateur et de meilleure qualité que les théâtres routiniers, tandis qu’à l’intérieur il était une assemblée paramonastique quadrillée et surveillée, une sorte de lieu clos, de territoire bien gardé ayant une existence transparente et formelle avec, derrière tout cela, une forêt vierge ésotérique où l’échange discret avec le Maître produit les impulsions indispensables à toute l’équipe de la Redouta.
l’organisation de la Redouta semble reposer sur une gradation, propre aux sociétés d’initiation, avec plusieurs niveaux d’accès au secret : extérieurs et intérieurs (il faut lire à ce sujet la préface de Z. Osinski aux LETTRES DR LIMANOWSKI, Osterwa, Varsovie, 1987). Faire le tri dans les démarches du directeur de la Redouta entre celles qui étaient purement de façade et celles qui étaient indispensables sur les chemins initiatiques essentiels, pourrait constituer l’objet d’une recherche pour un historien. Qu’on ait adopté ici une certaine tactique de protection ne fait pas de doute. Et la petite clé portant l’étiquette « exotérique — ésotérique » aura été certainement utile. l’examen de l’exemple de Redouta nous mène au coeur du sujet.
Pour finir, j’aimerais encore attirer votre attention sur un paradoxe parmi tant d’autres qu’on trouve lorsqu’on souhaite saisir l’objet protéiforme de nos recherches.
Laboratoires, studios, théâtres-studio, instituts — tous ont été à s’y méprendre, des organismes extrêmement modernes, dans l’esprit de notre civilisation scientifique et technique. Mais la modernité des enseignes et des structures d’organisation extérieures coexistent ici avec des structures intérieures derrière lesquelles se dissimulent des modèles différents portant l’empreinte des traditions lointaines — moyenâgeuses, antiques voire même perdues dans des temps primordiaux.
Le monastère de Redouta est devenu proverbial en Pologne. Une curiosité : il semble bien que le premier à associer le monastère à l’art théâtral, fut Meyerhold, lorsqu’en 1905 il a été appelé par Stanislavski, pour diriger le Studio de la rue Povarska. Ce Meyerhold qui plus tard deviendra le fanatique d’une modernité rigoureuse, biomécanicien et « tayloriste du théâtre ».
Des nostalgies monastiques hantent de nombreux studios, laboratoires, instituts — aussi bien que des théâtres ordinaires — ayant de vraies ambitions artistiques. Bien de coeurs de gens de théâtre, de différentes obédiences, battaient plus vite à la pensée de la discipline monastique, vécue comme une soumission et un dévouement à l’art, comme le chemin vers Dieu ou plus simplement vers l’Art comme Dieu.
On murmurait depuis les premiers temps que Grotowski et son équipe constituaient un monastère car il y régnait la discipline et aussi un fort penchant vers le mysticisme. Ce n’est pas exact et même certainement faux si l’on se réfère à la période proprement théâtrale. Avec Grotowski on avait adopté la position sobre qui consiste à ne pas mélanger les ordres. Celui de la vie et celui du travail dans l’art. Au nom de cette conviction nous avons choisi comme modèle de travail le modèle du compagnonnage des artisans avec maîtres, apprentis et élèves.
Pour la période post-théâtrale, l’analogie avec l’univers monastique ne me parait pas juste non plus. Il s’agit plutôt d’un modèle initiatique, avec des cercles d’accès diversifiés, avec des travaux menés pendant des années loin des regards extérieurs, avec une admission progressive des gens de l’extérieur comme témoins d’une expérience axiale. D’ailleurs il semble que Grotowski s’éloignait rarement du modèle du compagnonnage artisanal et même récemment il y revenait avec une nouvelle vigueur.
Barba est plus proche certainement du modèle oriental des dynasties de danseurs — acteurs qui cultivent d’une génération à l’autre leur art, en tant que savoir technique sacré et minutieusement gardé.
De telles références médiévales ou orientales entraînent une sacralisation du métier : la transmission directe des arcanes du maître à l’élève, la concentration, la rigueur, le silence, la manière discrète d’être, bref la ritualisation du travail. À cela s’ajoute aussi une hiérarchie assumée comme naturelle et la préservation d’un charisme favorable au maître.
Même chez Kantor, issu de l’avant-garde classique, farouchement moderne, ce modèle traditionnel était apparemment présent. Le Cricot 2 fonctionnait comme l’atelier d’un peintre de la Renaissance, avec un maître et des élèves, modèle constant, d’ailleurs sûrement plus ancien que la Renaissance et qui, dans le métier des beaux-arts, a survécu jusqu’à aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle il a l’air moins archaïque.
Dans la population de créateurs qui nous intéresse ici, tellement riche et diversifiée dans les décennies précédentes, on pourrait découvrir beaucoup d’autres correspondances, peut-être encore plus immémoriales. Pour les groupes de théâtre qui trouvent leur accomplissement dans des expériences communautaires, la vision qui conviendrait serait celle d’une tribu archaïque, d’une communauté primitive où la vie quotidienne et la vie rituelle s’interpénètrent. Le cas du Living Theatre est particulier — ici des révoltés modernes se réunissent dans un groupe qui prend la forme d’une troupe de comédiens ambulants. Derrière ce but, je ne sais pas jusqu’à quel point prémédité, je me demande si on ne peut pas reconnaître la référence au modèle d’un peuple nomade avec familles, enfants, patriarche transportant l’Arche de l’Alliance à travers le désert du Monde.
Plus une contestation est moderne, plus ses modèles semblent être anciens. Bien sûr, afin de les embellir, ils sont teintés d’une note de l’utopie propre à l’air du temps.
Dans le domaine qui nous intéresse, il serait utile d’étudier aussi les rêves non accomplis, les existences ratées, les belles idées précocement ensevelies, car il n’a pas été donné à tout le monde de survivre comme Artaud grâce au génie des visions poétiques fixées sur le papier.
Pour expliquer pleinement ce dont nous parlons, nous devons disposer du trousseau de clés complet. Et parmi ces clés, il nous faudrait aussi une clé pour distinguer les aspects éphémères du phénomène et son pouvoir de survivre, sa vitalité réelle.
Traduction de Magdalena Marek, revue par Monique Borie.