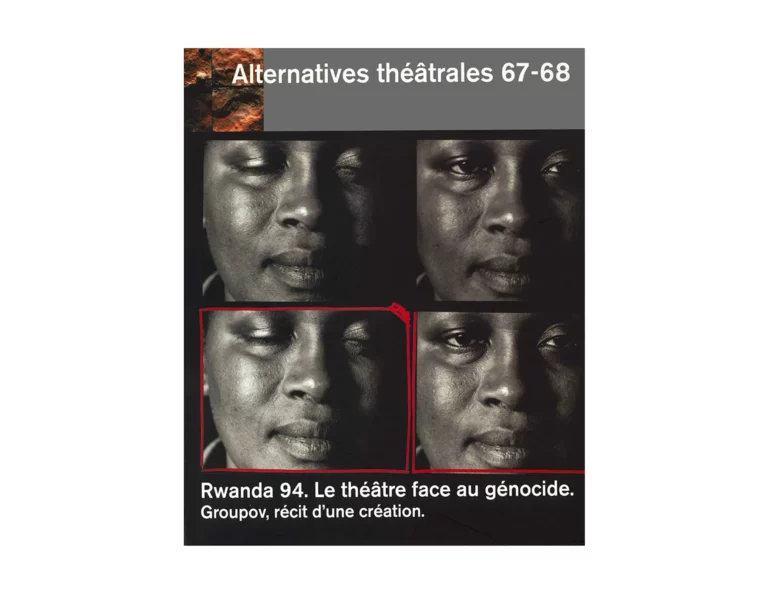« Les chants des hommes sont plus beaux qu’eux-mêmes »
Nazim Hikmet
LE MOT BRECHT ne se réduit ici ni à un homme, ni à son œuvre.
Quand je décris un tel désir, « Tendre vers Brecht », je veux dire : tendre vers ce que Brecht désirait lui-même. Je l’entends au sens large : le projet social, la création du « divertissement de l’ère scientifique », les valeurs philosophiques et morales inspirant de nouveaux rapports entre les hommes (« être amical »), etc.
Ce projet brechtien constitue un monde, on pourrait dire aussi : ce monde est en fait un projet. Toutes les parties en sont étroitement interdépendantes, avec leur autonomie. Toutes ont évolué considérablement au cours de sa vie. Mais, contrairement à ce qu’on lit de plus en plus, elles me semblent constituer un ensemble en formation d’une cohérence remarquable.
De ce projet-monde, Brecht (l’homme) se sentait à peine digne et chacun sait que la modestie ne l’étouffait pas vraiment – Brecht, l’écrivain et le faiseur de théâtre, en était l’artisan. Œuvres et réflexions en indiquent les pistes, ou le premier déchiffrement. Certaines de ces indications semblent plus claires que d’autres :
Bonheurs
« Le premier regard par la fenêtre au matin
Le vieux livre retrouvé
Des visages enthousiastes
De la neige, le retour des saisons
Le journal
Le chien
La dialectique
Prendre une douche, nager
De la musique ancienne
Des chaussures confortables
Comprendre
De la musique nouvelle
Écrire, planter
Voyager
Chanter
Être amical »
Tout ici est superlativement projet brechtien. Depuis l’humble pluriel du titre, contre les grandes notions métaphysiques (« le » bonheur), jusqu’à ce style à nul autre pareil qui crée une émotion poignante sans jamais se répandre, sans nommer la précarité
de l’existence (« ne sois pas si romantique »), sans dire la nostalgie passionnée d’un autre état du monde.
Je dis aujourd’hui que, dans ce sens, « tendre vers Brecht », c’est-à-dire vers ce que je crois pouvoir identifier de la tension brechtienne elle-même, constitue une sorte d’idéal, de rêve et de méthode pour notre travail actuel.
Un exemple. Sur le théâtre de Brecht, comme auteur et comme metteur en scène, deux réalités se conjuguent qu’il voudrait aussi qu’on distingue.
L’une pose des personnages, une situation, des actions et des paroles, tout cela en un moment donné de l’histoire telle qu’il voudrait la lire avec nous.
Mettons : Pélagie Vlassova dans sa cabane observe en récriminant les ouvriers imprimant un tract.1 Dans cette réalité, il y a la misère du prolétariat de l’époque, les relations entre travailleurs, la menace de la police, la ruse des communistes, les rapports de la Mère au fils, des éléments sur sa conception du monde soumise, etc. Dans l’autre réalité, consubstantielle à la précédente dans la réalisation scénique, il y a une esthétique merveilleuse de simplicité, de beauté et d’intelligence, à partir des matériaux apparemment les plus pauvres. Il y a une chanson politique, chantée par Macha, d’une légèreté et d’une pureté lumineuses dans son énergie, toute lourdeur, toute pesanteur en sont exclues alors que les paroles sont redoutables. Il y a une grâce du mouvement de chaque acteur, comme d’un homme réconcilié avec son corps, avec ses pulsions, avec la vie. Il y a un équilibre du plateau dans la petite masure où les groupements « artificiels » des militants se font avec aisance, et semblent aussi naturels que les gestes fonctionnels de Pélagie en train de coudre. Il y a des voix et des visages extrêmement typés, individualisés, mais aussi harmonisés que la clarinette, le piano et le violon dans un trio classique. Il y a ce ton posé, mais rapide, soutenu, sans complaisance, et la clarté de ce qui se dit n’ôte rien à la complexité de ce qui se joue. Etc.
- LA MÈRE, de Brecht — Eisler, d’après Gorki, scène 2. ↩︎