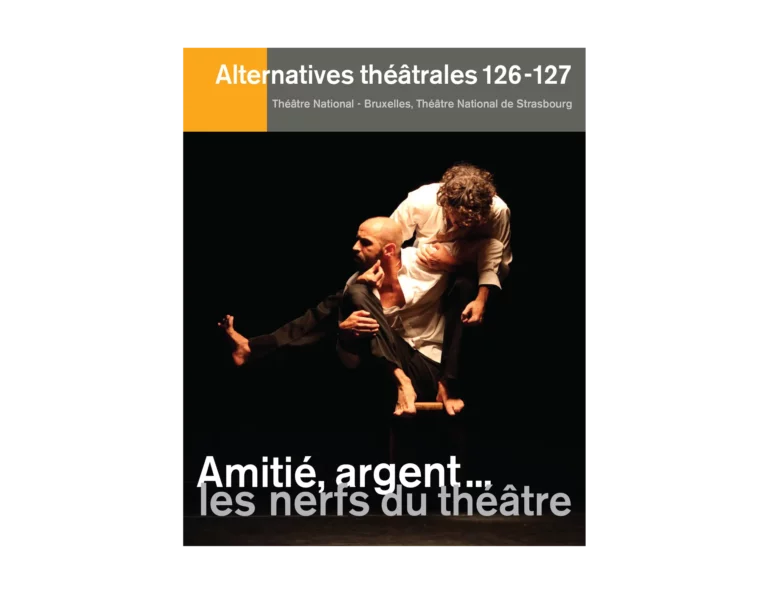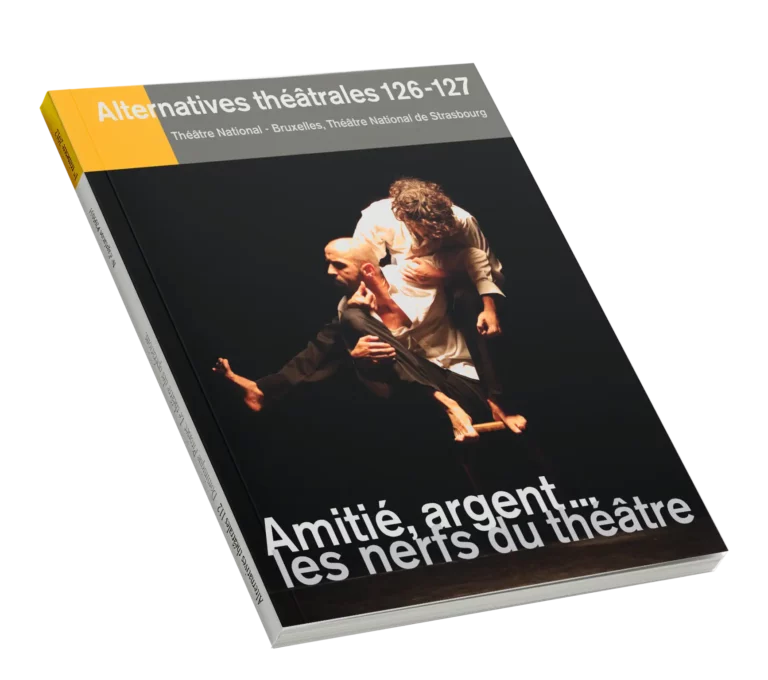« A living, Mr Kemper, is made by selling something that everybody needs at least once a year. And a million is made by producing something everybody needs every day. you artists, you painters, produce nothing that nobody needs, never. »1
QUAND ALTERNATIVES ThéâTRALES m’a contactée pour écrire un papier sur le thème « Théâtre, Argent, Europe », je me suis d’abord interrogée sur l’intérêt de la commande avant d’en assumer, après réflexion, sa légitimité. La chose était intéressante et légitime, je m’en étais progressivement persuadée, mais était-elle utile ? Je n’en étais toujours pas convaincue. Je ne lâchai pas l’affaire pour autant, taraudée par le sentiment qu’il y avait là plus qu’une occasion à dire ou à écrire, quelque chose à faire. Quand il s’agit des arts de la scène et a fortiori du théâtre, l’action de l’Union européenne n’est pas, il faut l’avouer, notoirement connue ; et quand elle l’est, il arrive parfois que ce soit pour de mauvaises raisons ; en règle générale, il faut l’admettre, on ne sait pas ce qu’il se fait et comment ; on ne va pas s’en étonner, encore moins s’en offusquer, mais on pourrait le regretter. Je le regrette et je suppose que – même si nous ne sommes pas nombreux –, je ne suis pas la seule. Un constat, une hypothèse et un regret, je venais de me construire le bien-fondé de l’exercice, ou pour le moins son utilité : dire pourquoi l’Union européenne soutient le Théâtre et comment. En 10 000 signes. En 10 000 signes ? En 10 000 signes, c’est la consigne. Intéressant, légitime et finalement utile, voilà que l’exercice devenait maintenant impossible. Comment définir, débattre, interroger, illustrer, échanger, et informer, en si peu d’espace ? Quarante ans de passion pour le théâtre et 20 ans d’«Europe2 » n’ont pas réussi à me laisser croire que je pouvais le faire et encore moins le faire seule. C’est ainsi que tout de suite après avoir dit oui au comité de rédaction, je me voyais lui proposer non pas un article mais plusieurs : une série, intitulée : « Théâtre, Argent et Politique », dont chaque épisode serait l’occasion d’une conversation particulière avec une personnalité du théâtre en Europe, sur un aspect précis du thème général tout en questionnant – ou en témoignant de – l’action de l’Union européenne dans le domaine. Parce que si la nécessité d’un art, quel qu’il soit, ne s’éprouve, comme j’en ai la conviction, qu’à travers l’expérience privée, à titre individuel ou collectif, il faut créer les conditions afin que cette expérience soit vécue, au moins une fois, par le plus grand nombre. Avec cette série, je pouvais faire en sorte que des auteurs, des metteurs en scène, des directeurs, des acteurs, bref, des gens du théâtre qui ont été impliqués dans un projet européen, nous racontent, chacun à leur endroit, comment, concrètement, ils ont pu créer les conditions de cette expérience et en quoi le soutien de l’Union européenne a pu y contribuer ou aurait pu y contribuer. Comment ils ont pu contredire, au moins une fois, horace Vandergelder.
«Avant de parler d’argent et de dépense publique, il importe de savoir si l’art théâtral a quelque chose à voir, dans son exercice même, avec le bien de ses spectateurs, considérés ou non dans leur qualité de citoyens et, plus généralement, au profit immédiat ou lointain, de la société où il se produit.»3
J’avais trouvé mon cadre, mon champ d’opération, je venais de trouver mon homme.
Robert Abirached. homme de lettres et de théâtre, homme d’affaires… politique(s), homme de parole et de cœur, l’homme de la situation et des institutions. Celui qui n’a pas dit – je l’en remercie – non à ma presque indécente proposition : répondre à des questions pousse-au-crime qui n’attendent pas forcément de réponse mais qui devaient forcer plus qu’une opinion, une prise de position ; répondre à des questions cent fois posées, sans rechigner à répéter ce qui a déjà été dit, quand ce qui se répète est ce qui doit être inlassablement rappelé : à savoir l’essentiel : Un théâtre public : pourquoi ? Pour qui ?
Corinne Rigaud : Soutenir une culture « inclusive » et notamment travailler au développement des publics, est une des missions d’Europe Créative4, le seul programme de financement de l’Union européenne qui vient exclusivement en soutien à des secteurs de la culture et de la création ; « inclusion », « démocratisation », peuvent parfois sonner, je veux dire irriter, comme « les gros mots » d’une langue de bois, celle du discours parfois démagogique de « l’élitaire pour tous ». Finalement, en quoi et pour qui le théâtre est nécessaire ? L’acquis lentement engrangé depuis soixante-dix années, dont vous parlez, trouve-t-il ses fruits dans la pratique et la participation culturelles aujourd’hui ?
- Horace Vandergelder à Ambrose dans HELLO, DOLLY ! comédie musicale américaine réalisée en 1969 par Gene Kelly. ↩︎
- Pour être plus juste, vingt ans à travailler à la Commission européenne pour l’Union européenne. ↩︎
- Robert Abirached. ↩︎
- La culture dans l’Union européenne : http://europa.eu/pol/cult/index_fr.htm Europe Créative : http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm ↩︎
- Le budget « Europe Créative » est inégalement réparti sur trois sous- programmes : MEDIA qui concerne le cinéma et l’audiovisuel, CULTURE qui concerne tous les autres secteurs culturels, et un volet transversal qui vient en appui logistique – disons – des deux premiers. ↩︎
- Le programme est ouvert non seulement aux 28 états-membres de l’Union européenne mais également aux pays associés qui ont signé une convention ; à ce jour : l’Islande, la Norvège, La Bosnie-herzégovine, L’ex-République yougo- slave de Macédoine, l’Albanie, la Serbie, le Monténégro, la Turquie, la Géorgie, et la Moldavie. ↩︎