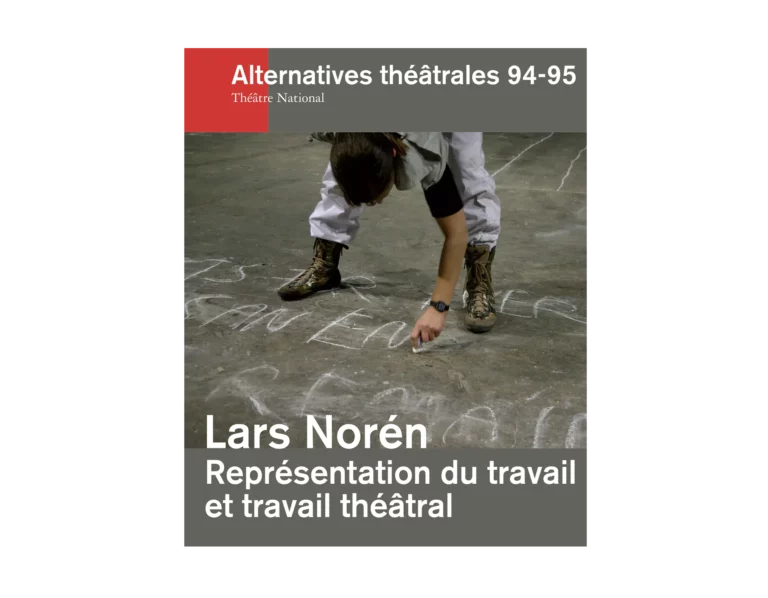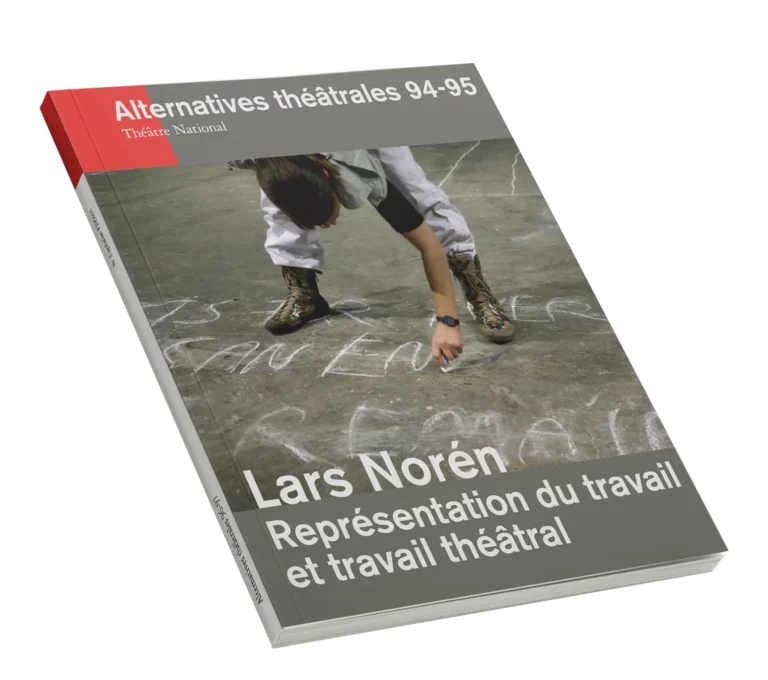Ce numéro conçu en liaison étroite et en connivence
avec le Théâtre National pourrait se rassembler autour de la conception que Jean-Louis Colinet se donne de son travail : un théâtre porteur de convictions.
Voulant interroger la manière dont certains metteurs en scène aujourd’hui représentent sur scène le travail, c’est tout naturellement que nous avons trouvé un terrain d’entente avec la première scène de Belgique qui a mis à l’affiche de son début de saison 2006 – 2007 des spectacles centrés sur ce thème et cette dimension.
Dans le long entretien qu’il nous a accordé, Jean-Louis Colinet explique comment il lui semble indispensable de donner à son théâtre une identité forte, un propos susceptible de faire naître auprès du public ce désir de théâtre indispensable à une vraie rencontre.
Cela se traduit concrètement par l’invention d’un nouveau rapport à la ville qui doit déboucher sur un élargissement social du public.
L’âme de ce théâtre de conviction c’est aussi l’aventure menée sur une longue période avec cinq artistes associés à qui nous donnons la parole dans
la seconde partie de cette livraison.
Représenter le travail
Pour Joël Pommerat, faire du théâtre, c’est en même temps chercher ce qu’il est, une exploration de la condition humaine. Il aime concevoir son travail comme un artisanat, voulant suivre et maîtriser toutes les étapes qui aboutissent à la création d’un spectacle. Théâtre de la voix et de l’image, Les Marchands sont une réflexion poétique sur le travail.
Nous avions, il y a quelques années (Alternatives théâtrales 75, 4e trimestre 2002) consacré un dossier à l’œuvre dramatique de Jean-Marie Piemme. L’auteur prolixe qu’il est, a poursuivi un travail d’écriture dont une des caractéristiques est la mise en tension, en conflit des personnages. Passé maître dans l’art du dialogisme, il propose après Toréadors une nouvelle joute entre deux personnages dans Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis.
Yannic Mancel montre comment il est l’héritier de ceux qui, avant lui, ont été les précurseurs d’une approche dialectique des échanges : Diderot et Brecht notamment.
En Italie, le renouvellement du théâtre vient de la périphérie.
Emma Dante quitte Rome pour Palerme où elle déploie son activité dans un espace qui fut un centre social. Ascanio Celestini conçoit son travail à partir des traces verbales ou gestuelles issues du monde ouvrier et paysan et Fausto Paravidino illustre magistralement comment le théâtre peut être un espace de responsabilité humaine contre la fatalité tragique.
C’est au scalpel que Falk Richter analyse les structures de la société postindustrielle et les rapports de pouvoir qu’elles entretiennent entre elles. Le projet de recherche de Richter s’attache à imaginer comment une analyse globale du système peut se représenter sur la scène.
Cinq metteurs en scène au travail
Développant chacun une démarche et une esthétique propres, les cinq artistes associés ont en commun d’accorder une importance primordiale à l’expérimentation et à la recherche.
Pour eux la création d’un spectacle doit impérativement venir d’une nécessité, qu’elle soit intérieure ou politique. C’est cette nécessité qui fonde le geste artistique. On pourrait dire que leurs spectacles naissent de « l’instinct et la nécessité»…
Isabelle Pousseur, dont on sait le temps qu’elle consacre aux ateliers, demande y compris dans la phase de préparation qui précède les répétitions, une grande participation des acteurs.
Pour Ingrid von Wantoch Rekowski cette nécessité du théâtre se double d’une recherche tout à fait singulière qui reporte sans cesse les limites de la représentation dans ce désir de se « heurter à l’impossibilité ».
Michèle Noiret a pensé un temps appeler sa compagnie un atelier permanent de recherche chorégraphique.
Le travail théâtral pour Philippe Sireuil est aussi affaire de compagnonnage avec un auteur. C’est lui qui avait demandé à Jean-Marie Piemme de lui écrire un dialogue à la manière de Dialogues d’exilés (Toréadors). Dialogue d’un chien… sera la 12e collaboration de l’auteur et du metteur en scène.
Jacques Delcuvellerie explique ici avec acuité comment on peut tenter d’expliquer cette nécessité des projets qu’il met en chantier. Ils naissent à la fois d’une vague d’émotion irrépressible et d’un sentiment de révolte qui doivent trouver une réponse dans la construction du spectacle.