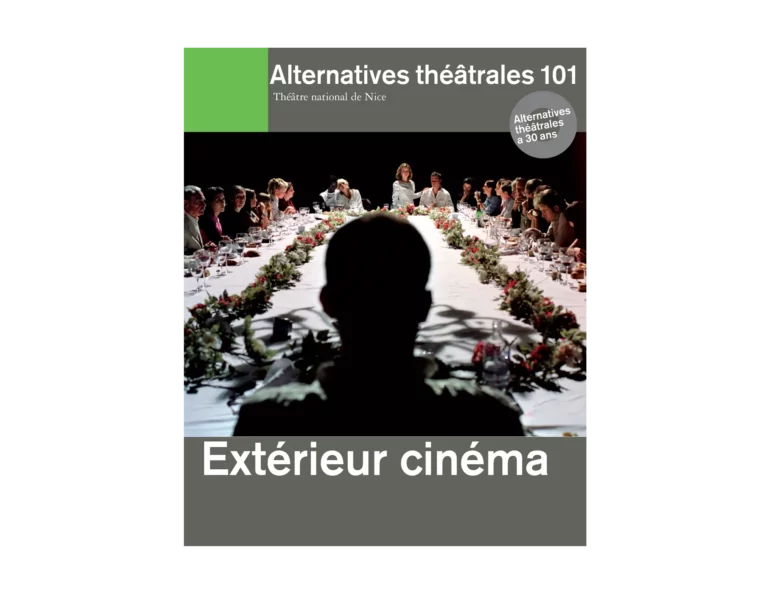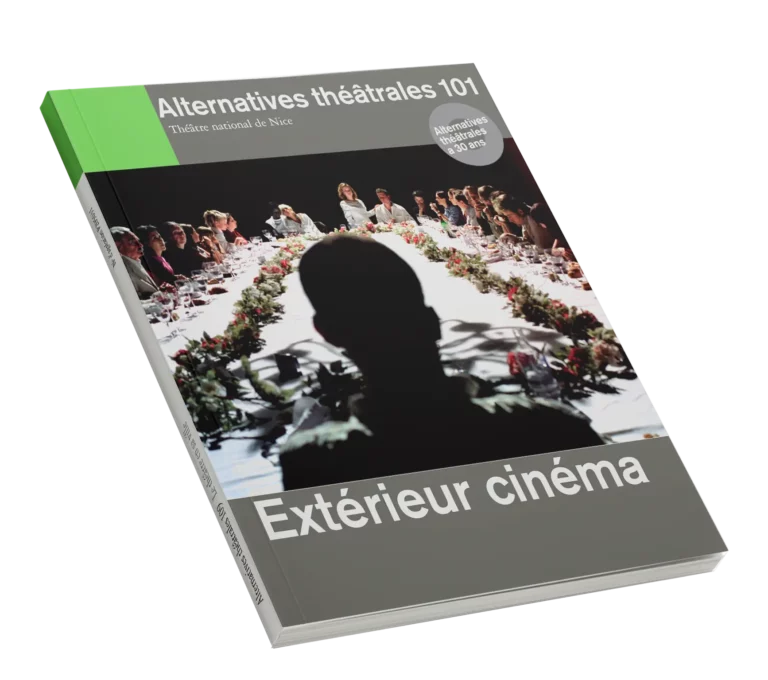« Le film, quand ce n’est pas un documentaire, est un rêve. C’est pourquoi Tarkovski est le plus grand de tous. Il se déplace dans l’espace des rêves avec évidence, il n’explique rien, d’ailleurs, que pourrait-il expliquer ?… J’ai frappé toute ma vie à la porte de ces lieux où il se déplace avec tant d’évidence. Quelques rares fois seulement je suis arrivé à m’y glisser… Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. »
Ingmar Bergman, cité par Le Figaro, hommage lors de sa mort le 31/07/2007
L’oeuvre d’Ingmar Bergman attire naturellement l’intérêt des metteurs en scène de théâtre, parce qu’il a longtemps mené la double vie de directeur/metteur en scène de théâtre l’hiver et de cinéaste l’été. Ses œuvres, centrées sur la richesse des dialogues, gardent trace de cette esthétique théâtrale. Ses dernières, comme les fameuses Scènes de la Vie conjugale — feuilleton télévisé qu’il a lui-même adapté pour le théâtre — ont connu de nombreuses mises en scène. En Belgique, Michel Kacenelenbogen en a donné une solide version naturaliste, au théâtre Le Public, en mai 2007.
La surprise vient d’un ovni théâtral, présenté en septembre 2008, au Théâtre Océan Nord, à Bruxelles. Un monologue destiné à une actrice, Affaire d’âme, écrit pour le cinéma, comme un « gros plan rapproché » d’une heure trente, n’a jamais pu être porté à l’écran, faute de producteur. Bergman s’en est désintéressé mais en a cédé les droits pour des adaptations radiophoniques. Une jeune actrice et metteuse en scène d’origine française, vivant à Bruxelles, Myriam Saduis, en propose, pour la première fois, une adaptation théâtrale. Un inédit donc, dédoublant habilement le rôle principal. L’accueil critique est unanimement positif, grâce à cette approche sensible de la folie par des moyens plus symboliques que réalistes, avec une excellente interprétation de Florence Hebbelynck et Anne-Sophie de Bueger.
Christian Jade : Ce texte est écrit pour un « gros plan rapproché»… au cinéma. Qu’en éliminez-vous pour votre mise en scène de théâtre ?

Myriam Saduis : Dans le corps du texte il y avait des éléments datés, anecdotiques. J’ai gardé l’essentiel, le rapport aux parents, au mari, à la société, au théâtre, à la folie. J’ai éliminé une servante à qui était adressé ce monologue. Par contre, j’ai dédoublé le personnage principal, Victoria, en deux actrices, qui en outre se multiplient : comme si le personnage principal était habité par plusieurs voix, qui dialoguent en elles et lui échappent. Comme si elle se livrait à une analyse « sauvage ».
C.J. : Théâtralement, que donne ce « double je/double jeu » ? Elles sont répétitives, semblables, complémentaires ?
M .S. : Les deux actrices sont comme des jumelles, qui jouent sur divers registres, en écho, en bagarre, en collusion, sur des axes différents, qui se rejoignent parfois pour des moments de grâce, de paix, de réconciliation, où elles peuvent parler d’une même voix.
Pour la répartition du texte, je voulais à tout prix éviter la concurrence, la rivalité, qui naît souvent entre acteurs/actrices si le (la) metteur (-euse) en scène ne prend pas ses responsabilités. Dès le début, j’ai donné à chacune sa « partition », son « territoire », à partir duquel elles pouvaient se connecter et atteindre le même but. J’ai insisté sur la multiplicité de leurs rôles, leur versatilité aussi qu’on retrouve dans Shakespeare comme dans Bergman. La duplicité d’Hamlet, dans la « souricière » qu’il tend à son beau-père, via des comédiens, on la retrouve chez Victoria, qui piège son mari infidèle.
C. J. : Quelle est la logique temporelle qui lie les onze séquences ?
M. S. : On n’est pas dans la chronologie mais dans la temporalité de l’inconscient, qui est associative. Victoria joue une pièce devant un parterre d’ambassadeurs, puis plonge dans les méandres de l’enfance, s’évade dans un rêve, se retrouve dans un hôpital psychiatrique, l’occasion d’une autre parole, tout aussi fantasmatique que le reste.
C. J. : Vous-même travaillez dans un hôpital psychiatrique. La tentation n’était-elle pas forte de verser dans le réalisme ? Vous parvenez à maintenir l’action au sein d’une conscience dédoublée par deux actrices…
M. S. : J’ai deux sources d’inspiration pour les scènes d’hôpital, mon observation personnelle des patients qui rejoint celle de Bergman qui décrit son passage en hôpital psychiatrique dans son autobiographie, Lanterna Magica. Sa dépression le met dans une zone de retrait où plus rien n’a d’importance. Il passe son temps à regarder les programmes de télé ou à écouter la radio sans vraiment voir ou entendre. Mes patients, comme Bergman, renoncent à se battre pour exister. Le monde tourne autour d’eux mais ils n’ont plus de prise sur le monde. Dans ma séquence théâtrale, j’ai essayé de montrer que le monde cogne à la porte mais que le personnage ne répond plus. Victoria essaie de trouver un fil intérieur. Elle est dans une sorte de « no man’s land » psychique tout en ayant encore des connexions avec le monde d’avant sa déprime. En se remémorant des scènes de son passé, elle vit dans un espace-temps qui évoque plutôt l’inconscient qu’une réalité physique. Cette remémoration est l’objet même de son présent, comme une métaphore de l’existence qui recommence sans fin. Mais si elle sollicite le passé, c’est pour essayer de le revivre et de le comprendre. En réalité, tout au long de la pièce, on peut se demander d’où elle parle, de quel lieu ou de quelle couche de sa conscience. Mais attention, on n’est pas du tout dans une pièce intimiste ou dans une confession mélancolique. Pour moi, on est dans le mode « épique », cette « tranche de vie » intérieure est comme une bataille, une épopée, une « Odyssée » intérieure. Chaque séquence est l’occasion d’une bataille nouvelle, d’une tentative de victoire. Par rapport à Bergman, il s’agissait d’éviter de faire un copier/coller de son univers visuel de cinéaste pour rendre sa puissance au théâtre.