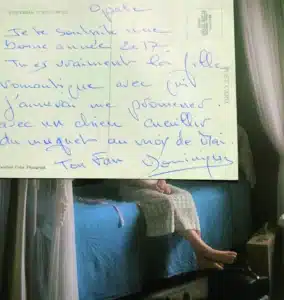Les six suites pour violoncelle de Bach sont sans doute un des sommets de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach comme de la musique occidentale. Dans leur dénuement, leur minimalisme, leur simplicité et en même temps leurs complexité architecturale, et la profonde humanité qu’elles dégagent, elles ne devaient pas manquer d’intéresser un jour Anne Teresa De Keersmaeker, familière de l’oeuvre du compositeur (c’est la quatrième fois qu’elle s’y confronte).
Sa rencontre avec le violoncelliste Jean-Guihen Queyras est elle-même un sommet dans le parcours de la chorégraphe.
Si la musique est le matériau habituel qui donne naissance à la danse, chez elle, il ne s’agit jamais de « l’illustrer » mais de tenter de faire s’interpénétrer les deux univers, tentant par un travail opiniâtre et audacieux, de faire se mouvoir le corps du danseur, comme s’il était lui même un « instrument de musique » Dans Mitten wir im leben sind jamais sans doute la rencontre de la grammaire musicale et de la grammaire corporelle n’a été à ce point réussie.
“One note, one step” aime à répéter Anne Teresa dans son travail de répétition avec les danseurs. On le voit, on le sent, on l’entend et on est étourdi devant la palette des mouvements, des sentiments et des émotions que cette dynamique crée.
Le spectacle décline une à une les six sonates qu’Anne-Teresa vient présenter à chaque fois dans le silence sur le devant de la scène. Par un geste à la fois clair, lent et retenu, elle énumère les six moments du spectacle, geste qui se termine par un index pointé en direction du violoncelliste qui occupera une place chaque fois différente dans l’espace de la représentation. Celui-ci jouera l’intégralité de l’oeuvre, sans partitions, magistralement. Sa présence innerve littéralement les danseurs, et il fait tellement « corps » avec eux qu’il en devient danseur/acteur lui-même (par ses gestes d’archet, son visage expressif, l’attention permanente qu’il leur porte)
Les quatre premières sonates sont interprétées par le violoncelliste et par un danseur différent — la troisième par une danseuse — qui par sa personnalité donne à voir et à entendre la musique à partir de son univers physique et sensible¹. La chorégraphe les accompagnera par moments, au début et à la fin de chaque partie, dans une chorégraphie de mouvements quasi identiques.
Pour la cinquième sonate, Jean Guihen Queyras est seul en scène. Une image magnifique de l’artiste, petite silhouette, perdue dans l’immensité de la scène (ici La Monnaie à Bruxelles), jouant dos à la loge royale éclairée² de ses dorures, rappelant la situation de « dépendance » de Bach au prince de Koethen, dont il était le maître de chapelle lorsqu’il composa ces sonates, mais plus généralement la position de l’artiste souvent obligé pour vivre de vendre sa capacité de travail au pouvoir, qu’il soit politique ou économique.
Dépendance oui, mais avec dignité, car dans un deuxième moment de cette séquence, le violoncelliste fera face à la loge.
C’est à ce moment aussi qu’apparaît de manière prégnante pour le spectateur le contraste entre la vaste cage de scène vide de la Monnaie entièrement peinte en noir et où ne sont pas cachés les éléments techniques nécessaires à son fonctionnement et le chatoiement des couleurs de la décoration « baroque » de la salle. C’est aussi un signe que l’on ressent tout au long du spectacle. La confrontation et la fusion réussie de la musique ancienne qui se conjugue de manière parfaite avec la modernité de la danse et des danseurs.
Le spectacle est aussi le fruit de la lecture de penseurs (Newton pour les lois de la gravitation, Leibnitz pour ses commentaires de la philosophie naturelle chinoise) dont la chorégraphe s’inspire pour son travail. Le miracle, c’est que loin d’être une danse « cérébrale », la pensée qui la sous tend se traduit sur scène par le plaisir de la danse et les émotions qu’elle suscite. J’ai lu quelques jours après avoir vu cette éblouissante représentation cette phrase de Nabokov que l’on pourrait transposer à l’art d’Anne Teresa de Keersmaeker : « … maintenant je sais que lorsqu’on écrit, la réflexion est bien un élément négatif et l’inspiration un élément positif, mais que seule leur conjonction fait naître l’éclat blanc, le frémissement électrique d’une création parfaite… »³.
On retrouve grâce au travail d’An D’Huis, l’esthétique sobre, caractéristique des spectacles d’Anne Teresa. Les couleurs des costumes à dominante noire, ajoutent à la grâce des danseurs. Ceux-ci sont vêtus de tenues simples : culottes courtes noires et tee shirts noirs ou bleus pour les hommes ; les deux femmes, pantalon pour l’une et robe pour l’autre, ont toutes deux le dessus partiellement dénudé affirmant une discrète sensualité. Des baskets noirs ou colorés aux pieds pour tous les danseurs.
La sixième sonate est un hymne à la vie. Les cinq danseurs sont présents (six avec le violoncelliste comme les six sonates). La scène est largement éclairée et la salle l’est un peu. Comme un feu d’artifice, les danseurs bondissent, courent, tournent dans une ronde joyeuse et frénétique. Parmi eux, Anne Teresa, dans une joie enfantine est surprenante dans son corps de femme enfant. Sur quelle note, une double croche ? Parvient-elle à nous surprendre d’une grimace à peine perceptible ? Au milieu de cette séquence, les acteurs tombent et s’étendent sur le sol, inertes ; la mort, seule, donne au corps une immobilité parfaite. Cette séquence émouvante éclaire la seconde partie du vers médiéval donnant son titre au spectacle, et qui se trouve sur la pierre tombale de Pina Bausch : « Mitten wir im leben sind / Mit dem Tod umfangen » (Au coeur de la vie nous sommes enveloppés par la mort).
C’est en mode majeur que se termine la sixième sonate. Au théâtre, les morts ressuscitent. Le Mitten wir im leben sind Bach6Cellosuiten d’Anne Teresa de Keersmaeker et Jean-Guihen Queyras est une bouleversante leçon de vie.
1. Boštjan Antončič, Marie Goudot, Julien Monty, Michaël Pomero. 2. Les lumières de Luc Schaltin enveloppent remarquablement les artistes, la scène et la salle. 3. Vladimir Nabokov, Lettres à Véra, Fayard. Après sa création à la Ruhrtriennale le 26 août 2017, Mitten wir im leben sind Bach6Cellosuiten sera donné tout au long de la saison 2017/2018 en Belgique à Bruges, Anvers, Gand, Liège, Louvain (Leuven), Hasselt ; en Allemagne à Berlin, Heidelberg, Francfort et Ludwigsburg ; en France à Lille et Montpellier ; au Luxembourg ; aux Pays-Bas à Amsterdam.