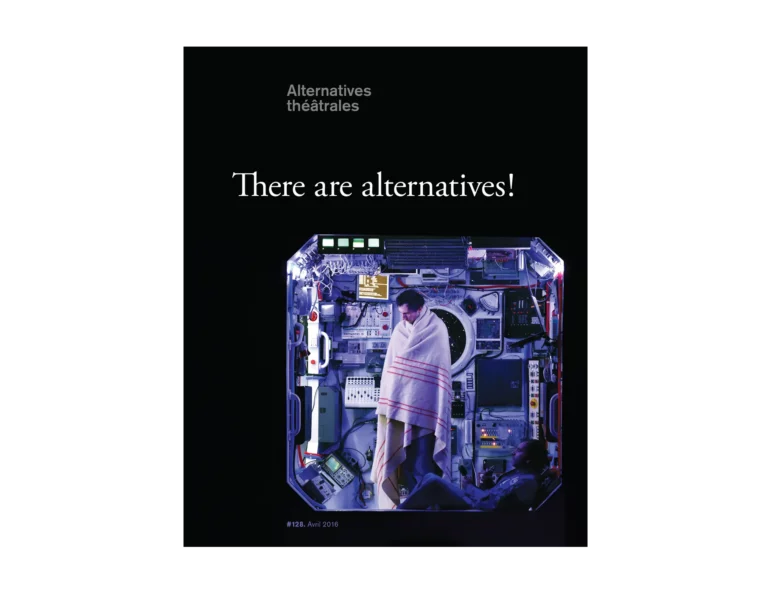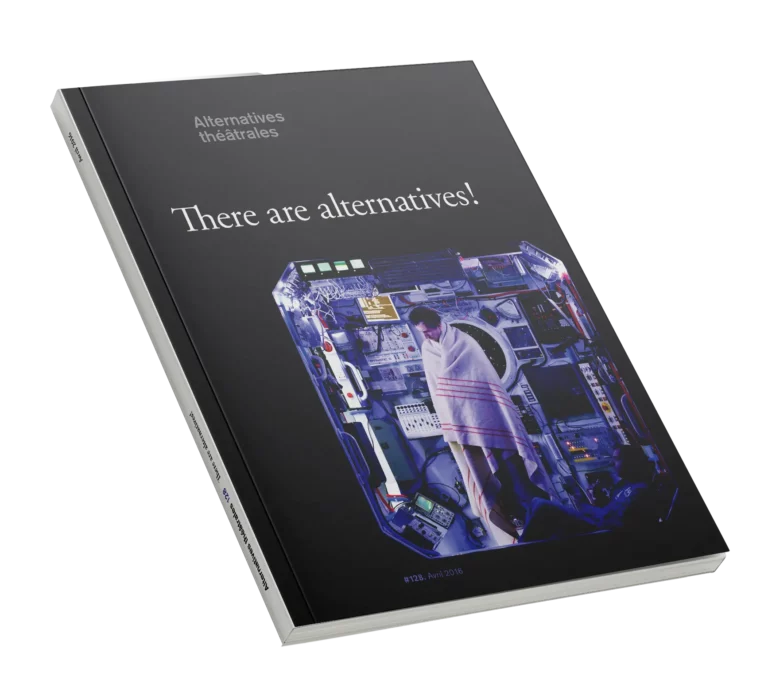« Que pouvons-nous encore penser du théâtre et de ses pouvoirs, dès lors que l’on accepte que l’essentiel de l’activité spectatrice se déploie indépendamment de la représentation, au gré des associa- tions de chacun ? »1
Jacques Rancière
Les signes d’une émancipation partagée
Pourquoi susciter un désir de théâtre chez des personnes qui n’en ont pas formulé le manque ? Pourquoi solliciter des publics qui n’y seraient pas venu spontanément et qui, parfois même, ne vivent plus leur absence des salles de spectacle comme un facteur discriminant ?
C’est que nous croyons encore que le théâtre et les arts de la présence sont les garants d’une expérience unique du public, libre balancement entre l’individuel et le collectif, écoute où le solitaire se nourrit du diffus.
Un travail régulier mené depuis plusieurs années au sein de l’association Cultures du Cœur2 avec des publics dits « isolés » des lieux culturels, publics que nous préférons plus simplement considérer comme des spectateurs peu habitués aux salles de spectacle, nous a conduit à définir un certain nombre de principes d’accompagnement.
Avec la multiplication des parcours effectués avec les publics les plus divers s’est construite une éthique du médiateur culturel. Elle est à même de définir la relation que ce dernier compte entretenir avec les personnes qu’il mobilise et qu’il accompagne.
Le médiateur culturel n’est pas un simple intermédiaire entre les œuvres et le public et sa fonction n’est pas non plus d’expliquer les œuvres au public. L’accompagnement de spectateurs n’est pas là pour régler notre rapport à l’art mais mettre en jeu les propositions artistiques et susciter un point de vue désinhibé sur les œuvres.
Cette liberté d’interprétation est le prélude à une appropriation individuelle de chaque spectacle et l’émergence d’un esprit critique qui s’affine dans la multiplicité même des sorties.
Dans les cadres des restitutions des spectacles dont nous allons parler ici nous préconisons une même écoute à tout type d’émotion. L’acceptation des ressentis de chacun nous permet de privilégier la relation avec les publics à la transmission de connaissance sur les œuvres.
L’horizon du médiateur est d’abord de créer les conditions d’un échange autour des effets du jeu d’un acteur, d’un choix de scénographie, de lumière, de son… Ce médiateur, en état de veille, est aussi en quête d’enrichir sa propre vision des œuvres au contact du discours des publics dans le cadre d’une émancipation partagée.
C’est un accompagnement et une participation au long cours, des sorties conçues comme des projets en soi et qui vont au-delà de la simple confrontation au spectacle. Dans ce cadre, la liberté, le discernement, puis l’agilité réceptive du spectateur se gagnent avec la confiance qui lui est accordée.
Nous l’avons identifiée, cette émancipation du spectateur novice qui progressivement argumente son point de vue, ces potentialités et ces lectures singulières d’un spectacle venant bousculer nos repères critiques pour, tour à tour, se focaliser sur des éléments matériels que nous ne voyons plus, remettre en cause la pertinence d’un dispositif scénique, le phrasé d’un acteur, faire rayonner les ressources insoupçonnées d’une thématique.

L’émancipation du spectateur s’aiguise aussi lorsqu’il décide de critiquer le passage d’un spectacle ou le détail d’une intention dépassant le « j’aime » ou « j’aime pas ». Elle s’affine encore lorsque nous sommes confrontés à plusieurs reprises à des appréciations spontanées comme : « Je n’ai rien compris mais j’ai adoré ».
Ici, le spectateur est assez libre pour ne plus uniquement associer son plaisir à la compréhension ou confiner l’absence de compréhension à de l’ennui.
Nous avons aussi été attentifs à sa capacité à nous révéler des éléments objectifs d’une séquence que nous n’aurions pas vue car notre attention était rivée sur sa dimension symbolique. C’est cette femme qui à la fin d’un Phèdre de Sarah Kane me dit : « Pourquoi parlent-ils tous si fort, c’est donc le seul moyen pour montrer que l’on souffre ? »
Ou encore cet adolescent qui à la fin de Polyeucte de Corneille me dit : « Pourquoi met-il près de quinze minutes à mourir alors que Clint Eastwood dans L’Inspecteur Harry en a déjà tué une dizaine en moins de temps ? »
- « Les scènes de l’émancipation », entretien d’Armelle Talbot et Olivier Neveux avec Jacques Rancière du 28 mars 2012, in Théâtre Public, n°208, avril – juin 2013. ↩︎
- Association Nationale qui s’est donné comme mission de lutter contre toute forme d’exclu- sion culturelle. Ce dispositif est relayé par 39 structures territoriales et une structure québécoise. Chaque année près de 400000 invitations sont mises à disposition des publics. Cultures du Cœur fédère près de 6000 structures sociales, culturelles et spor- tives. L’association forme les travailleurs sociaux à la médiation culturelle et les acteurs culturels à l’accueil des publics issus du champ social. Elle est à l’origine de multiples projets d’action culturelle et d’accom- pagnement des publics. Site
www.culturesducoeur.org ↩︎ - Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Gallimard, 1960, p. 125. ↩︎