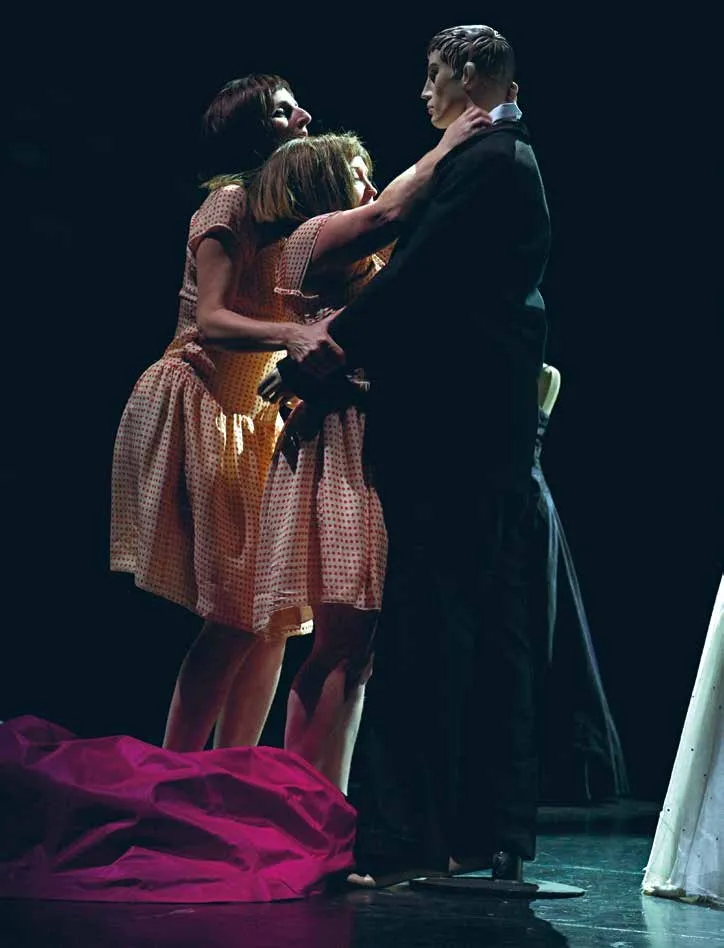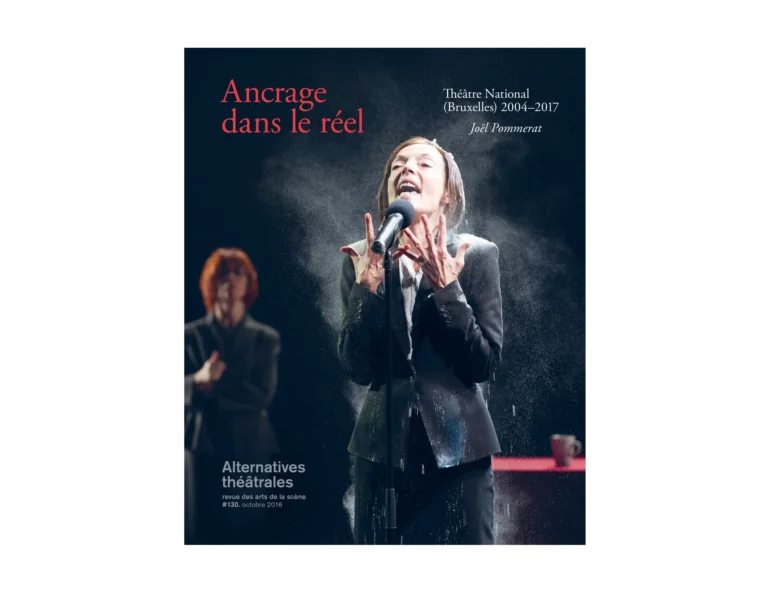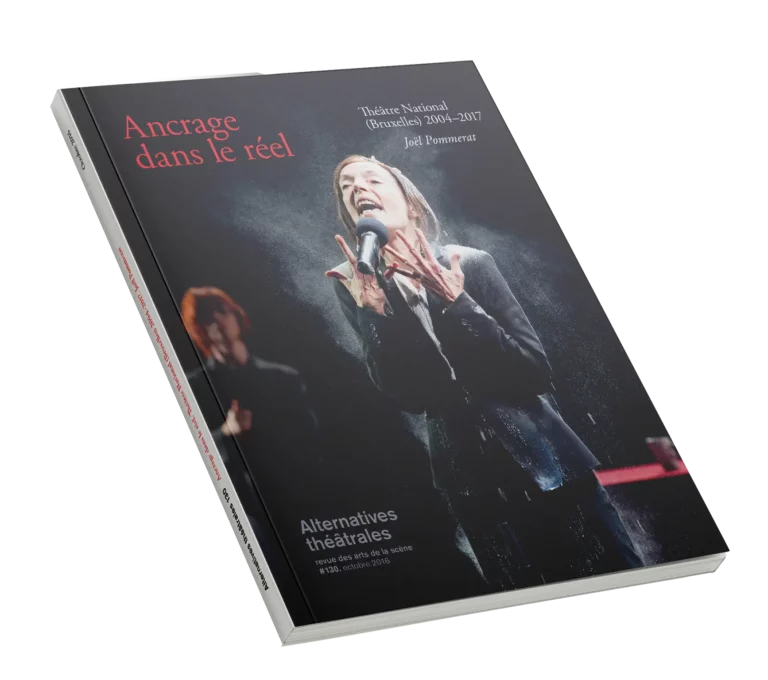Yannic Mancel Vous êtes à la fois plasticien, scénographe, créateur de lumières. Quelles ont été vos écoles et lieux d’apprentissage ?
Éric Soyer J’ai toujours joué de mes mains. J’aimais transformer les espaces et les objets, bricoler, modeler la matière. Une certaine aptitude à la « manualité », dirons-nous. Je me souviens qu’un jour mon père m’avait même offert un petit kit d’électricité avec des ampoules, des variateurs, des interrupteurs… L’école m’a ensuite appris à aimer les histoires, les romans, la littérature – une autre façon de voyager et de rêver. Le lycée m’a offert une option A3 arts plastiques.
Ma grande chance fut de pouvoir, au début des années 90, intégrer l’école Boulle dans une section qui s’intitulait « expression visuelle, espaces de communication », un cursus très technique où l’on apprend à concevoir et à réaliser des architectures éphémères. Diplôme en poche, je suis engagé dans des bureaux d’étude où l’on réalisait des espaces commerciaux. Et c’est en rénovant les bureaux du Théâtre de la Main d’Or, à la demande de Jean-Christian Grinevald, que j’ai rencontré une compagnie qui allait changer le cours de ma vie, la compagnie ACT animée par Andrew Wilson, qui adaptait des classiques en langue anglaise pour le jeune public. Pendant sept ans, ces gens m’ont appris le théâtre, le métier de régisseur, comment brancher un projecteur… Ils sont mon école. C’est là que j’ai pris conscience de la lumière, à l’anglo-saxonne, c’est-à-dire plongé dans le bain, en immersion. Chaque spectacle se jouait deux fois par jour, à raison de 150 représentations dans l’année. J’y ai appris à vivre avec les acteurs, à dialoguer avec eux.
Yannic Mancel Et c’est donc à la Main d’Or, premier tremplin parisien de Joël Pommerat, que la rencontre a eu lieu ?
Éric Soyer Joël y avait loué une salle pour y présenter ses tout premiers spectacles, avant d’y être officiellement accueilli avec Les Evénements, puis Pôles, spectacles sur lesquels on m’a demandé de remplacer un régisseur défaillant. Vincent Le Nouëne, qui était à l’époque le concepteur lumière de Joël, lui a suggéré de m’engager comme scénographe et Treize Étroites Têtes nous a réunis pour la première fois. Dès ce premier spectacle, la manière dont nous allions travailler était posée : des scènes d’intérieur et d’extérieur, un sol à 40 cm, un tapis roulant de cour à jardin qui permettait de marcher ou de courir en demeurant sur place, des frises mobiles en dur, très matiérées, qui permettaient de moduler le cadre, et déjà le tout dans une boîte noire dont la profondeur était délimitée par un cyclorama, autant d’éléments qui nous incitaient à travailler sur les différents plans successifs du jeu et de l’image. Une grande partie de notre grammaire commune était déjà là. Quand Vincent Le Nouëne, pour diverses raisons personnelles, a décidé de quitter l’aventure, j’ai donc repris les commandes de la lumière en l’articulant organiquement, dès la phase de conception, avec la scénographie. La technologie nous a permis un peu plus tard de réunir les deux activités. Et pourtant les outils de ma formation initiale sont à la base très traditionnels et très rudimentaires : le dessin à l’équerre et le jeu d’orgues à poussoirs… J’ai pu vivre là cette étape indispensable qu’est le temps de l’apprentissage, de l’apprivoisement manuel et artisanal de la technique.
Yannic Mancel Comment s’est donc opérée l’évolution ?
Éric Soyer Autour de l’an 2000, nous avons progressivement basculé vers la programmation numérique, mais j’ai toujours tenu à conserver un pupitreur, pour garder la maîtrise et pouvoir continuer mes allers-et-retours entre la table et le plateau. Je n’enregistre la programmation que dans un second temps, après avoir trouvé ce que je cherche avec les manettes. J’ai besoin de ce va-et-vient. Ayant pratiqué la régie de plateau, m’étant un très long temps tenu en retrait dans la coulisse, il me paraissait impossible de rester en surplomb frontal et de programmer seulement de loin. J’ai besoin d’aller voir aussi l’effet que ça produit dans la proximité de l’acteur. C’est dans cet aller-et-retour entre table de régie et plateau, par exemple, que s’est inventé le tableau du travail à la chaîne dans Les Marchands. C’est comme cela que se développe une créativité de plateau fondée sur l’artisanat et l’accident – de parcours, de répétition… –, celui qui vous fait presque par hasard (re)trouver une invention scénique oubliée ou inédite. Le mode d’écriture et de production que nous avons adopté fait que chacun de nos spectacles est un laboratoire. Nous avons ainsi, pas à pas, établi une grammaire sur laquelle nous pouvons nous appuyer, mais une grammaire ouverte, qui nous donne toujours la liberté de nous fixer de nouveaux défis : la vague de Pinocchio, l’éclipse de Grâce à mes yeux, l’amplification des bruits de pas dans Les Marchands, le noir absolu dans Ma Chambre froide, les apparitions-disparitions dans La Réunification des deux Corées… Ce travail d’exploration et d’expérimentation inclut aussi François Leymarie au son, assisté de son neveu Grégoire à la diffusion et au mixage, Isabelle Deffin aux costumes, Thomas Ramon aux accessoires et à la construction d’objets, Emmanuel Abatte qui coordonne la direction technique, et enfin Renaud Rubiano pour toutes les formes de création vidéo.

Yannic Mancel De grands artistes comme Giorgio Strehler ou Patrice Chéreau étaient déjà parvenus, par le passé, à cette globalisation du processus, mais c’était au cœur d’institutions très richement dotées. Vous, vous êtes parvenus à cela en compagnie et dans l’indépendance. N’est-ce pas là aussi la nouveauté ?