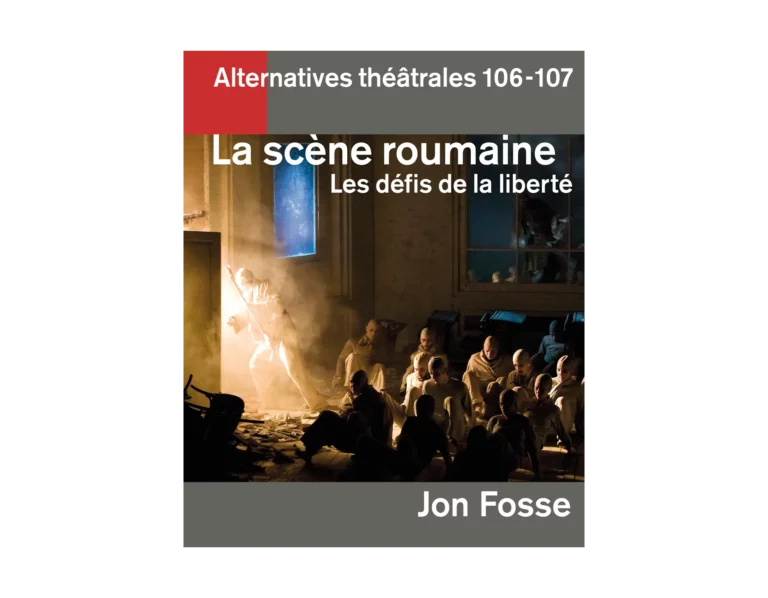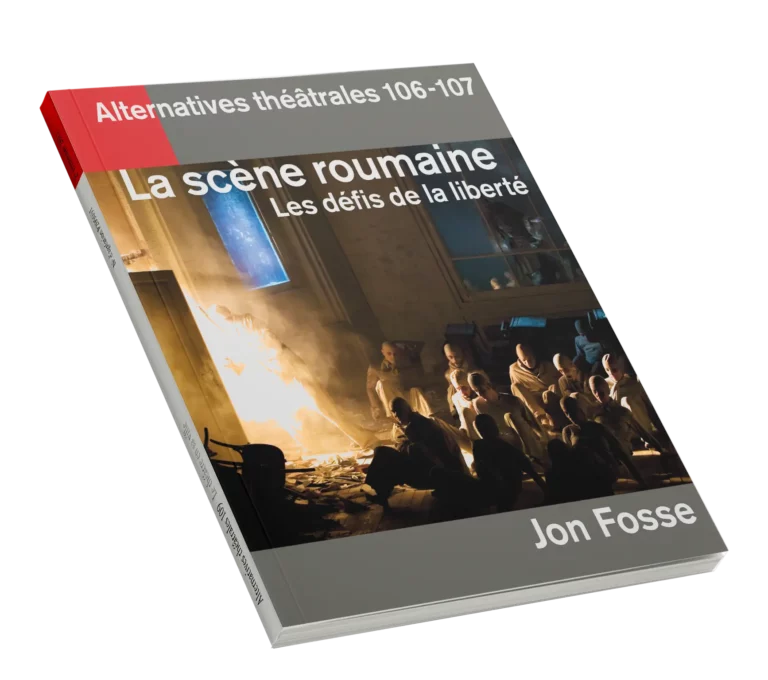ALINA MAZILU : Pourquoi as-tu émigré en Allemagne en 1977 ?
Helmut Stürmer : C’était une décision politique : j’étais sur le point d’être arrêté par la Securitate et j’ai fui pour ne pas tomber dans les griffes de cette organisation. Mais il y avait aussi une autre raison ; en Roumanie, j’étais déjà sur un piédestal, j’avais reçu des prix nationaux, et je voulais davantage : je voulais de la concurrence. Je voulais me mesurer à ceux que je révérais alors. C’était l’époque de la grande révolution esthétique du théâtre allemand. Le groupe qui gravitait autour du théâtre de Brême, de Zadek, toute une pléiade de jeunes artistes, m’a jadis énormément influencé.
A. M.: Et tu es parti de zéro en Allemagne ?
H. S.: De presque zéro. J’avais certes déjà travaillé aux Kammerspielen de Munich et au Théâtre de Cologne avant d’émigrer, mais mes amis d’autrefois, qui sortaient des cercles de gauche, m’ont reçu, moi l’émigrant d’un pays du socialisme réel, comme un traître à leurs idéaux, et m’ont laissé tomber. J’ai commencé dans de tout petits théâtres, avec pratiquement zéro budget… C’est certes une belle provocation de commencer à zéro, mais je ne le souhaite à personne. Aujourd’hui encore, je suis assis entre deux chaises : lorsque je suis en Allemagne, je me sens roumain, et lorsque je suis en Roumanie, je me sens allemand. C’est l’éternel dilemme de tous les émigrants ou des gens des frontières. Je suis aussi à la frontière entre la scénographie et les arts du spectacle. J’essaie en permanence de vaincre cette frontière.
A. M.: Ainsi que celle entre le théâtre, l’opéra et le cinéma…
H. S.: Oui, mais la différence concernant le travail de scénographie n’est pas aussi immense ici que l’on peut l’imaginer. J’ai repris à l’opéra une partie de mes expériences du théâtre, comme la relation libre à l’espace.
A. M.: Y a‑t-il aussi des choses que tu as ramenées de l’opéra au théâtre ?
H. S.: Absolument ! Par exemple les possibilités techniques ou le goût des grands tableaux, que l’on peut expérimenter à l’opéra et que l’on peut parfaitement rendre au théâtre. Il faut alors vraiment bien peser le pour et le contre, car parfois le minimalisme spatial est beaucoup plus utile au théâtre. Mais cela n’exclut pas les grands tableaux. Par tableau, je ne veux pas dire illustration. Je ne supporte pas l’illustration (le doublage d’un texte par des images)! Il faut toujours trouver un programme de contrastes. Il faut trouver pour un texte ou pour une musique un espace dans lequel ces deux éléments concordent de façon positive.
A. M.: Donc provoquer sciemment des contrastes…
H. S.: Tout à fait ! Chercher l’inattendu. Un texte de théâtre, aussi bien qu’une musique lyrique, résonne très différemment en fonction de la scénographie.
A. M.: Construire une unité composée de contrastes…
H. S.: De contradictions. C’est le point de friction entre ce que l’on attend et ce que l’on reçoit. On attend toujours la variante facile, l’illustration d’un texte ou d’une musique. Il faut créer précisément le contraire, ce qui ne veut pas dire qu’il faut ignorer la musique ou le texte. Il faut parfaitement savoir ce que l’on poursuit ainsi, et aussi très bien connaître et aimer les acteurs, la musique, le texte… Le texte, pas toujours, parfois c’est merveilleux quand on ne supporte par une pièce…
A. M.: Tu es un homme très talentueux – comment réagis-tu à l’échec ?
H. S.: Dieu merci, je n’ai pas connu de four complet, mais sur la centaine de décors que j’ai élaborés, j’en ai raté cinq ou six. Le matin, dans ma baignoire, je ne me rappelle pas des succès, mais des insuccès, ils me poursuivent. Il y en a eu peu, mais ils sont cuisants. Mais il est vital d’échouer pour un artiste. La peur et la dépression font partie de son travail. Sans ces choses qui remettent tout en question, on ne va pas très loin, je crois.
A. M.: Quel est le décor le plus déjanté que tu aies jamais réalisé ?
H. S.: Je n’ai jamais fait de décors déjantés ! Mais le décor de FAUST me tient beaucoup à cœur, bien entendu. Nous avons longtemps étudié le problème, et je suis parvenu à préserver dans le décor une installation artistique évoquant une galerie d’art. C’est un projet que je cautionne aujourd’hui encore à cent pour cent. Ma relation avec Purcrete fonctionne ainsi : je fais énormément de propositions, et il s’enthousiasme pour un détail ou pour une partie d’une proposition, qui donne ensuite lieu au bon décor.
Pour certains décors, je ne sais plus qui a pris la décision d’aller justement dans ce sens là. Dans ces cas-là, on assiste toujours à une excellente collaboration, quand tout se fond l’un dans l’autre, quand l’idée est une idée commune.
A. M.: Comment décrirais-tu en une phrase la relation idéale entre le scénographe et le metteur en scène ?
H. S.: Ils sont comme un couple qui se dispute mais ne parvient pas à se séparer.
A. M.: L’idée t’a‑t-elle déjà effleuré de faire tes propres mises en scène ?
H. S.: Non, même si, effectivement, le scénographe fait secrètement de la mise en scène. Cela ne veut pas dire qu’il dicte sa loi au metteur en scène, mais il est en mesure de guider des concepts. Quant à la capacité d’adopter ces concepts dans le travail quotidien avec les acteurs ou les chanteurs… Il faut être né pour ça. C’est pour ça que les metteurs en scène sont des metteurs en scène, parce qu’ils ont ce pouvoir. Un metteur en scène est toujours un dictateur, peu importe son attitude, sympathique ou monstrueuse, envers les acteurs. La démocratie n’a rien à faire au théâtre ou à l’opéra, il doit y avoir un responsable.
En outre, je connais tellement de scénographes qui font des mises en scène passables, je n’en ai encore jamais vu qui me convainque à cent pour cent.
A. M.: Que souhaites-tu pour l’avenir ?
H. S.: J’espère ne pas perdre le contact avec la jeune génération. Il n’y a rien de pire qu’un artiste vieillissant qui se montre arrogant envers les jeunes.