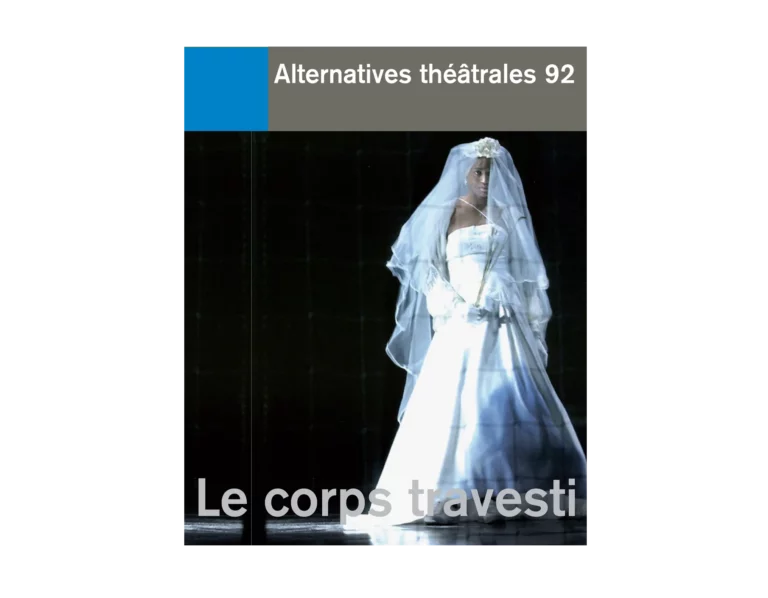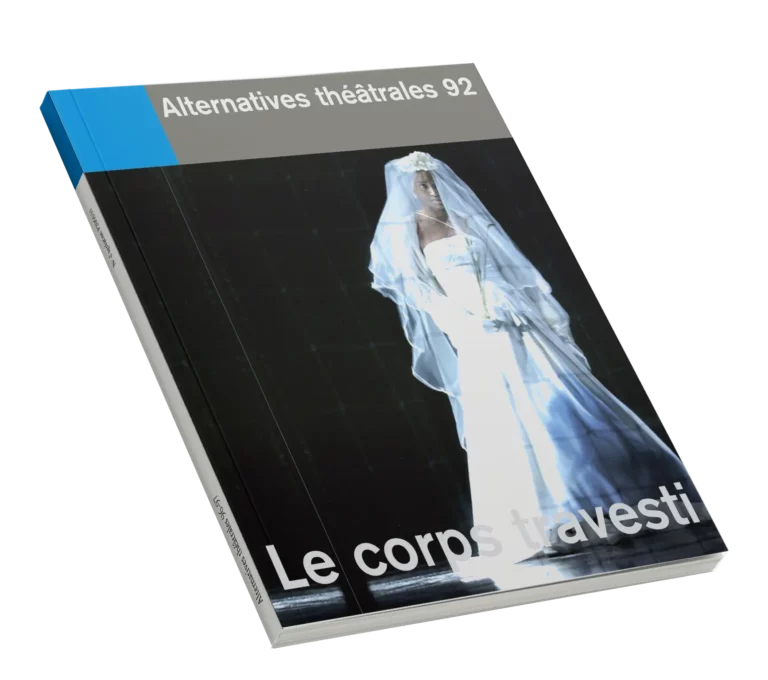PIOTR GRUSZCZYNSKI : D’où vient, chez Shakespeare, cet intérêt pour les gens exclus ? Cela provient-il de son homosexualité, de son sens de la justice, ou l’époque le voulait-elle ainsi ?
Krzysztof Warlikowski : Je pense que cela vient surtout de la différenciation sexuelle, de la sensation d’être exclu, d’une vie à la frontière du sexe. On le voit parfaitement dans le cas de Viola dans LA NUIT DES ROIS, lorsqu’elle décide de se vêtir en homme au moment de partir en voyage. Pourquoi ?
P. G.: On en a déjà parlé, cela pouvait être une décision liée aux convenances, aux mœurs. On sait que la vie est plus facile pour un homme, qu’il est plus autonome, plus indépendant.
K. W.: Je sais, je sais, mais je me demande d’où provient chez Shakespeare une telle histoire. Pourquoi lui arrive-t-il aussi souvent de changer les sexes ? Bien sûr, il y a cette convention au nom de laquelle, dans le théâtre, tout était joué par des garçons.
P. G.: C’était la norme autrefois.
K. W.: Tu parles des exclus, mais c’était alors des gens qui souffraient dans la solitude et le silence. Ce n’était pas des minorités qui luttaient pour leurs droits. C’était des homosexuels, des femmes, des noirs, des Juifs, des gens condamnés à perdre. Ici, au théâtre, grâce à des moyens structuraux très complexes, parfois ironiques comme par exemple le théâtre dans le théâtre, Shakespeare peut en parler complètement différemment. Il peut prendre leur parti, mais de manière non explicite.
P. G.: Peut-être est-ce un subterfuge, une tentative pour parler par exemple de l’homosexualité, mais derrière un masque ?
K. W.: Je ne sais pas jusqu’à quel point Shakespeare jouait avec lui-même, à quel point ce jeu l’excitait. La description d’une vie homosexuelle devient soit une variante de littérature pornographique, soit quelque chose de retenu, sans respiration. Cela se passe autrement quand cela s’accompagne d’un sentiment de nonacceptation.
P. G.: Dans le film SHAKESPEARE IN LOVE, on a contourné la question de l’homosexualité de Shakespeare.
K. W.: Peut-être avec raison car le film devait se vendre aux États-Unis, et les États-Unis sont hystériques dès que l’on touche à Shakespeare. Il est plus sacré là-bas qu’en Angleterre. Un film qui aurait parlé de son homosexualité aurait été condamné au fiasco dans la distribution de masse.
P. G. : Non, pas obligatoirement, cela aurait peut- être pu intéresser en tant que découverte… Lorsque tu abordes le travail sur un texte, tu t’entoures de diverses interprétations ?
K. W. : Je lis différentes choses, mais le plus souvent je me désespère devant l’aspect théorique de la plupart des arguments, devant toutes ces analyses aux phrases et structures habiles où il y a si peu de tonalité humaine. C’est pourquoi Jan Kott est toujours ma référence essentielle. Il suffit qu’il décrive comment, s’étant trouvé tout à coup dans une discothèque scandinave remplie seulement de têtes blondes aux cheveux courts, il en a perdu la faculté de distinguer un homme d’une femme. Un tel trouble lui a donné immédiatement une nouvelle clé pour comprendre Shakespeare.
P. G. : Dans le théâtre élisabéthain, tous les rôles étaient joués par des garçons ou des hommes. Penses-tu que cette convention a provoqué un dérèglement plus profond des sexes et de la sexualité ?
K. W. : Cela dépendait très certainement des individus. Mais n’importe qui n’entre pas au théâtre. Il y a toujours dans ce type d’hommes plus de faiblesse, plus de besoin. Ce ne sont pas de grands gaillards sains et normaux qui viennent et, tout simplement, se retrouvent ici, mettent des costumes et entrent en scène. Je ne sais pas si un jeune garçon qui se décidait à mettre une robe comprenait ce qu’il faisait. Voulait-il s’adonner à l’art ou était-il offert au théâtre par ses parents et n’avait-il pas d’autres solutions ?
P. G. : C’était alors une convention évidente, elle ne provoquait aucune inquiétude. Il est intéressant cependant de savoir si elle n’a pas provoqué de dérèglement. Est-ce que Shakespeare, en écrivant ces textes comme LA NUIT DES ROIS, tenait compte du fait qu’il multipliait, au théâtre, le mélange des sexes avec les travestissements ?
K. W. : Justement ! Théoriquement, nous pouvons penser ce que nous voulons, mais examinons logiquement et le plus lucidement possible cette situation : comment cela se passait-il ? Des jeunes garçons, qu’est-ce que cela veut dire ? Avaient-il quinze ans ? Un garçon de quinze ans que l’on habille en femme et à qui l’on explique comment il doit se comporter suit une sorte de cours, comme dans le théâtre Katakali. Peut-être était-ce ritualisé ? Ou peut-être était-ce très simple ? Le public était vulgaire et criait : « Hé ! Tadek, montre ton cul, sois une seniorina ». Y avait-il de telles provocations ? Ces garçons étaient-ils homosexuels comme cela arrive souvent dans les ballets où ils tombent dans les mains de pédérastes ? En réalité, on ne sait pas comment cela se passait. Mais d’un autre côté, quand tu vois un jeune garçon qui joue une femme, tu ne restes pas indifférent. Un jour, j’ai regardé l’opéra de Purcell, DIDON ET ENEE, chanté par un chœur de jeunes garçons allemands impubères. Ces garçons chantaient, ils devaient s’embrasser, ils travaillaient cela avec le metteur en scène. Ces situations devaient leur faire prendre conscience de quelque chose. Je fus alors vraiment bouleversé. D’un autre côté, c’était vraiment une rareté car, avec un garçon comme ça, on travaille pendant des années et puis tout à coup il mue, et il n’y a plus rien, c’est finit ! Un vrai chant du cygne.
P. G.: Qu’y avait-il de si bouleversant chez ces garçons ?
K. W.: Ces jeunes de douze, treize ans entraient dans le rôle d’amantes et d’amants. Chez moi, dans MACBETH, les sorcières, des enfants de la guerre, étaient jouées par des fillettes de cet âge. Lorsqu’on leur a donné des cigarettes, des cigarettes de scène, qu’on les a maquillées, qu’on leur a mis des perruques et des tenues ambivalentes, un peu cocottes, je me suis senti mal à l’aise et j’ai commencé à me demander si ce que je faisais était moral.
P. G.: Autrement dit, paradoxalement, la convention qui devait veiller aux principes moraux provoquait leur décomposition, la décadence ?
K. W.: De notre point de vue, certainement ! Parce que jadis, on donnait un de ces gamins, le vingtième enfant d’une famille, et personne ne se demandait si celui qui l’achetait le prenait pour le violer ou pour le théâtre.
P. G.: Alors comment est-ce dans LA NUIT DES ROIS ?
K. W.: Je pense que les acteurs plus âgés étaient amoureux de ces gamins.
P. G.: Et que se passe-t-il dans le texte lorsque Viola revêt le costume masculin ?
K. W.: Viola, c’est-à-dire le garçon qui joue la fille, met un costume de garçon.
P. G.: Lorsqu’un garçon, qui joue une fille, se transforme de fille en garçon, quelle direction cela donne t‑il aux relations et aux désirs ? D’un côté Olivia, de l’autre côté le Prince, entre les deux, Viola comme messager. Comment cela fonctionne-t-il alors ?