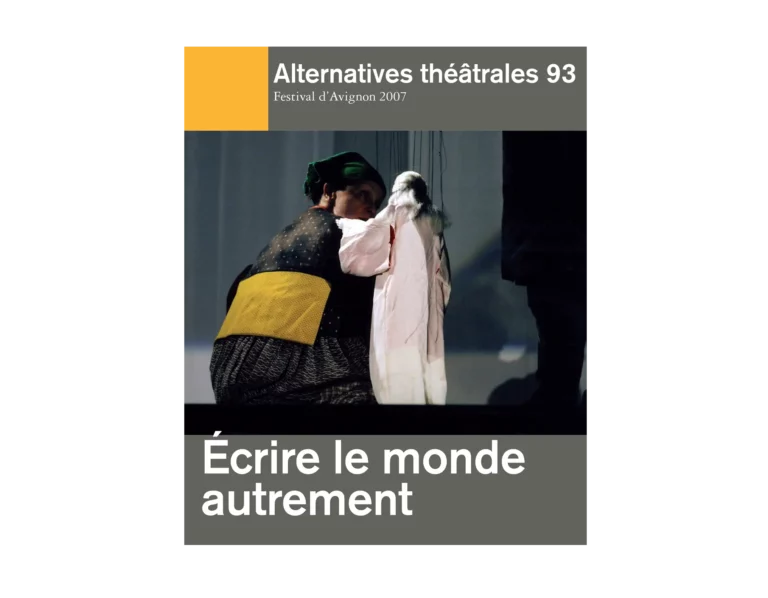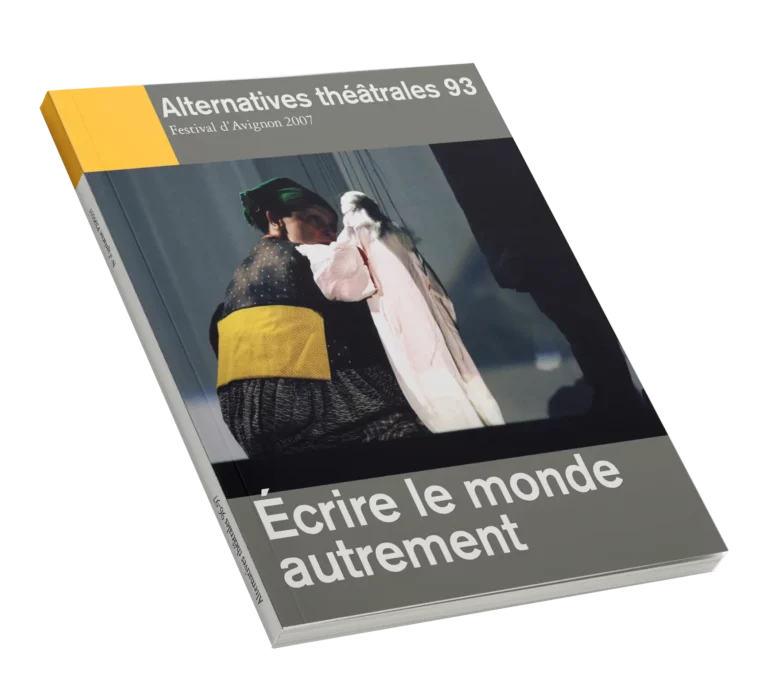BÉATRICE Picon-Vallin : Quand on regarde le parcours du Théâtre du Soleil du point de vue du choix et du travail sur le texte, on est frappé à la fois par la diversité et la cohérence du parcours – pièces contemporaines, grands textes classiques, adaptation, auteur associé, créations collectives, avec des cycles, des retours en arrière impliquant un enrichissement et un développement de l’approche du texte de théâtre. Dans cette quête d’un théâtre au présent absolu, dont les créateurs scéniques pourraient être aussi les auteurs, la recherche d’un nouvel auteur collectif paraît être une ligne de force. « Nous voulons inventer nos spectacles », disais-tu au temps de L’ÂGE D’OR. Comment vois-tu aujourd’hui l’évolution de ta relation aux textes de théâtre que monte le Théâtre du Soleil ?
Ariane Mnouchkine : Je ne l’analyse pas, je me rends compte que je n’ai pas le temps de la considérer, j’avance toujours sans avoir le temps de faire des bilans. Mes choix sont instinctifs, immédiats… Je crois que je suis certainement la moins intellectuelle de tous tes sujets d’études… Je n’ai pas de plan, je sens ce dont j’ai besoin à tel ou tel moment. Je sens par exemple que je n’ai pas envie, que je n’ai plus envie de monter Shakespeare, peut-être parce que j’ai envie d’un auteur « moins impérialiste ». Je continue de penser que c’est le plus distant qui nous éclaire sur notre monde, mais si je considère qu’avec les pièces de Tchekhov, on entre
dans une sorte de « concours de metteurs en scène », je ne pense pas cela de celles de Shakespeare. En même temps, il faut que le rapport aux classiques soit le plus contemporain possible. TARTUFFE, c’était vraiment, totalement contemporain. Mais à part certains de ses personnages, en ce moment, Shakespeare est-il vraiment contemporain ? Pour l’instant, même si je n’ai pas envie de monter une pièce entière de lui, il n’empêche : il nous aide toujours. Quand on travaille Shakespeare, on doit faire de l’exercice, avec les comédiens, ne serait-ce que trois ou quatre jours, pour se remettre un peu en jambes – quand on patauge. Aux moments difficiles des ÉPHÉMÈRES, on se prenait quelques classiques, on se calmait et on allait à l’école ! C’est vrai, dès que tu as un classique, tu as les « bancs de l’école », c’est-à-dire qu’il existe une sorte de discipline, de corset, qui fait que tout d’un coup la liberté peut revenir. Car lorsqu’on est complètement sans filet, suspendu dans l’air, avec un fil aussi fragile que celui d’une toile d’araignée, il y a des moments où l’on n’a plus aucune liberté du tout. Le travail sur des extraits de pièces classiques nous a permis de la retrouver.
B. P.-V. : Dans ce recours aux classiques au cours du processus de création collective des ÉPHÉMÈRES, il n’y avait pas seulement Shakespaeare, mais aussi Tchekhov ?
A. M. : Oui. Mais pour moi, Tchekhov est en soi son propre théâtre. Je ne crois pas à une soi-disant relecture de Tchekhov, alors qu’on peut avoir plusieurs visions de Shakespeare. Les différentes lectures de Tchekhov sont pour moi fatiguantes. En général, quand on dit que c’est intéressant, c’est parce que ce n’est pas intéressant et pas émouvant. « C’est intéressant ! » veut souvent dire : « Tiens, voilà quelqu’un qui s’est dérobé devant l’obstacle ! » Je pense que les choses qui nous touchent nous viennent de ceux qui sont droits, qui affrontent l’obstacle, droits ! Sans contourner, sans louvoyer ! Sans nous envoûter ! Il y a les chefs‑d’œuvre, puis il y a des gens qui veulent épater, mais est-ce que le théâtre de LA MOUETTE, tu le mets devant, derrière, est-ce que tu te tournes comme ci ou comme ça, est-ce que le ciel, le lac, est derrière ou devant toi ? Il faut surtout essayer que les spectateurs voient leur ciel, leur lac…
B. P.-V. : Il me semble tout de même qu’aujourd’hui, tu es plus proche de Tchekhov que tu ne l’as été pendant très longtemps ?
A. M. : Quand je vois LES ÉPHÉMÈRES, je me dis qu’il y a des moments qui sont, entre guillemets, tchekhoviens ! Mais comment en est-on arrivé là ? Je ne sais pas très bien au fond…
B. P.-V. : Il ne te viendrait pas à l’esprit, aujourd’hui, de monter une pièce de Tchekhov ?
A. M. : Non ! Mais ça peut changer dans six mois ! Mais pour l’instant, non !
B. P.-V. : Est-ce qu’en faisant LES ÉPHÉMÈRES, tu n’as jamais pensé que vous étiez plus prêts qu’autrefois pour monter du Tchekhov ?
A. M. : Non. Mais on n’est jamais prêt, quand on commence un spectacle comme LES ÉPHÉMÈRES, ou… LE ROI LEAR. On n’est pas prêt !
B. P.-V. : On est seulement prêt à la recherche ? A. M. : Oui. Il y a une nécessité, pour laquelle on n’est pas prêt ! Moi, je ne suis pas prête, jamais.
B. P.-V. : Donc tu fais une différence entre la nécessité intime de monter une œuvre et le fait d’être prêt à la monter ?
A. M. : Exactement ! Je me rends compte d’ailleurs que mon intérêt, mon engagement dans les élections de 2007 est lié à cela. Je dirais que Ségolène Royal m’intéresse surtout parce qu’elle ne prétend pas être prête. Elle l’a dit dix fois : « Je n’ai pas réponse à tout ! » Elle est prête à la recherche, je dirais, de ce qu’est vraiment la démocratie. Qu’est-ce que c’est que d’écouter les citoyens ? Qu’est-ce que c’est que d’essayer de tirer le meilleur d’eux-mêmes ? Et elle m’intéresse à cause de ça ! Ceux qui se croient prêts sont plutôt du côté de l’artisanat. Il y a des gens qui savent faire, parce qu’au fond ils véhiculent, ils transmettent un savoir – un notaire, un cordonnier, transmettent un savoir, et sont donc prêts, ils savent… et c’est magnifique ! Mais justement, ce n’est pas de l’art…
B. P.-V. : Si on en revient au parcours du Soleil, il me semble que tu as cherché à faire en sorte que les acteurs et toi-même vous puissiez devenir auteur, auteur de théâtre – pas seulement du spectacle, mais du texte même de ce spectacle… Est-ce que tu considères que vous y êtes arrivés ?
A. M. : Avec LES ÉPHÉMÈRES, je pense que oui. Je dirais : « Pas forcément avant ! » Avec LES ÉPHÉMÈRES, les acteurs sont arrivés à cela, il nous est arrivé une certaine forme d’écriture théâtrale, et quand je parle d’écriture, je ne parle pas de l’écriture des mots, évidemment ! Avec L’ÂGE D’OR, on était trop petits, trop jeunes ! On s’accro- chait aux masques comme à une bouée, qui à la fois nous sauvait, et nous entravait. Une certaine écriture théâtrale s’est donc avérée être possible avec LES ÉPHÉMÈRES, après beaucoup d’obstacles surmontés. La réponse n’est pas : « Nous sommes un auteur de théâtre comme Shakespeare, ou Hélène Cixous. » Non, c’est un ouvrage ! Et ce n’est pas moins intéressant, parce que si on ne se fonde pas sur le texte, on se fonde sur le théâtre…
B. P.-V. : C’est un reproche qui a souvent été fait au Soleil, par exemple pour ET SOUDAIN DES NUITS D’ÉVEIL, où la critique trouvait le texte faible. Mais le texte d’Hélène Cixous n’était écrit que pour vous, pour être accompagné du jeu, de la musique, etc., et pour ne pas se suffire à lui-même, donc pas pour être jugé en soi.
A. M. : Oui, et de plus, le texte n’était pas entiè- rement d’Hélène, mais « en harmonie » avec le Soleil ; elle avait essayé, puis il s’était passé ce qui s’est passé pas mal de fois, il était resté quelques scènes.
B. P.-V. : On n’entend pas ce type de critique à l’égard du « texte » pour LES ÉPHÉMÈRES. Comment peux- tu définir la différence entre la création collective telle que tu l’envisageais au moment de 1789, de L’ÂGE D’OR, et celle que vous pratiquez maintenant ?
A. M. : Au moment de 1789, on était dans un monde complètement allégorique, c’était presque de l’ordre du tableau vivant. Maintenant, je ne peux plus revoir le film du spectacle, tellement je trouve que c’est mal joué ! Mais en même temps, cela faisait partie de la grâce de ce spectacle, ce jeu aux pommettes très rouges, aux nez rouges, ce jeu de bateleur ! Avec L’ÂGE D’OR, nous n’avons pas été assez loin, même avec les masques qui permet- taient tout en principe. C’était le début d’un chemin ; au fond nous sommes très obstinés, sans le savoir ; je suis très obstinée…
B. P.-V. : À conduire tes acteurs et à creuser un même sillon ?
A. M. : Je ne m’en rends pas compte moi-même : j’ai l’impression qu’à chaque spectacle, on est toujours sur un chemin nouveau, et finalement je comprends que ce chemin nouveau est en fait la continuation du même chemin.
B. P.-V. : Après L’ÂGE D’OR, tu disais déjà (je te cite ) : « Nous avons des auteurs ! Nous sommes tous des auteurs ! Un comédien qui improvise est un auteur ! ». Comment a évolué l’improvisation, entre 1789, L’ÂGE D’OR jusqu’aux ÉPHÉMÈRES ?
A. M. : Ce qui a changé, c’est surtout l’arrivée de la caméra vidéo : tout d’un coup, on pouvait garder l’improvisation et la revoir… Et ça, c’est énorme ! C’est un des cas où un instrument transforme un art !