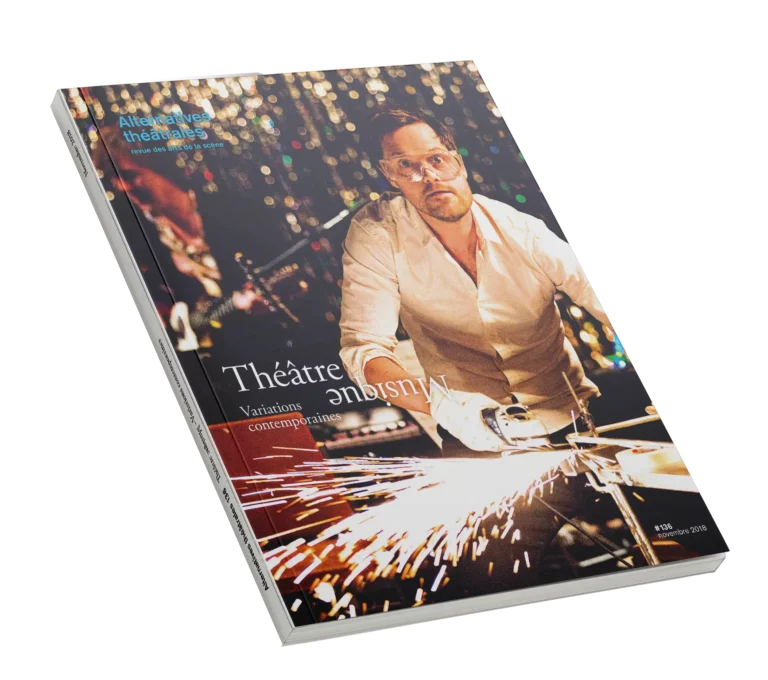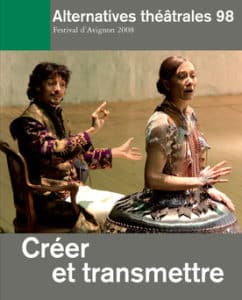Ce n’est qu’en travaillant sur mon concert scénique le plus récent, I went to the house but did not enter, pour le quatuor vocal britannique The Hilliard Ensemble, que j’ai soudain été amené à me poser la question du traitement de la voix. Une question qui m’était inhabituelle parce que mes pièces de théâtre musical et radio-phoniques partageaient une même formule, sans doute inconsciente : le travail avec des voix singulières. Comme les formes standardisées et académiques du parler et du chanter m’étaient toujours suspectes, ce travail est devenu pour moi comme la condition de toute communication esthétique.
Ainsi, j’ai microphoné, coupé, échantillonné, mis en boucle, transposé et déformé les voix ; je les ai détachées de leurs corps et de leurs origines, avant de les y réassocier ; j’ai travaillé avec des voix rauques, inexpérimentées, imparfaites, douces, différenciées, soufflées ; avec des voix, jeunes et vieilles, de fumeurs et de non-fumeurs ; avec des voix qui ne hurlent jamais, crient rarement, chantent peu, parlent le plus souvent ; jamais avec des voix lisses, mais avec des voix qui sont d’abord et avant toute chose singulières.
Par exemple, des voix africaines du Sénégal (Boubakar et Sira Djebate), des voix de passants (dans les rues de Berlin et Boston), les voix de mes propres enfants ; des voix iraniennes, grecques, brésiliennes, américaines, flamandes, canadiennes, japonaises et suédoises (de Sussan Deyhim, Areti Georgiadou, Arto Lindsay, John King, Johan Leysen, Marie Goyette, Yumiko Tanaka, Charlotte Engelkes et Sven-Åke Johansson).
La multitude des voix cassées et recomposées avec une virtuosité toujours plus agile et déconcertante de David Moss et Catherine Jauniaux, mais aussi la multitude de voix de quelques acteurs (David Bennent, André Wilms, Ernst Stötzner, Josef Bierbichler), les voix caractéristiques de certains chanteurs et chanteuses (Georg Nigl, Jocelyn B. Smith, Walter Raffeiner, Dagmar Krause), les voix off de vivants et de morts, d’auteurs et de compositeurs (Heiner Müller, Alexander Kluge, William S. Burroughs, Claude Lévi-Strauss, Hanns Eisler, Brian Wilson), les voix d’instrumentistes (de l’Ensemble Modern, de la London Sinfonietta), des voix documentaires de cantors juifs (dans Surrogate Cities), de policiers et de manifestants allemands (dans Berlin QDamm 12.4.81), les voix de cigales et de grenouilles, de chiens et d’oiseaux, ainsi que les voix dans les bruits de choses, bien sûr – les pianos, les pierres, les tubes, les plaques métalliques et l’eau (dans Stifters Dinge) – et dans Max Black, les voix de tous les objets jetés de la scène et qui deviennent soudain autonomes.
Jusqu’alors, j’avais donc principalement travaillé avec des voix uniques, particulières, qui ne sont ni remplaçables ni échangeables entre elles. Presque jamais avec des voix qui ont reçu une formation académique, lesquelles réussissent rarement à m’émouvoir. Leur idéal esthétique, au contraire, consiste à retirer à la voix sa spécificité, à faire disparaître une certaine part de ce qui en elle est personnel – en faveur de registres d’expression classiques dont la norme est définie par la beauté du son, l’articulation et le placement de la voix au profit d’une mise à disposition de sa virtuosité. Pourtant, même la voix de formation classique ne peut, ni ne veut, ni ne doit nier son origine, son corps, rendu perceptible par la force de sa trace vivante.
En dehors du fait qu’elles sont irremplaçables, il était possible pour moi de rendre audible, avec ces voix singulières, le grand spectre des sons humains : une expression soudaine qui ne peut être répétée, un saut hasardeux, une voix cassée, un accent unique ; le murmure, l’hésitation, le rire et le soupir, les raclements de gorge et le gémissement aux frontières du bruit ; la voix de fausset ou la fragilité d’une voix qui se brise comme un cri puissant et brut, ou encore l’ornementation élégante. On peut même y trouver des multiphoniques, involontaires ou intentionnels. Sauf qu’il est impossible de transférer tout cela à d’autres voix et à d’autres corps, même si la tentation est grande.
D’innombrables compositeurs de musique contemporaine et de théâtre musical de ces cinquante dernières années1 ont essayé de déterminer expérimentalement comment sonder, exploiter, faire progresser, noter, rendre exécutable et ainsi transmettre la richesse vocale de l’ensemble des sons que nous avons l’habitude et la capacité de produire et d’entendre, et dont la voix du chanteur de formation ne représente qu’une petite partie. Mais comparé à la richesse de ce qui a été produit pendant la deuxième moitié du XXe siècle en termes de développement du matériau sonore instrumental et électronique, le traitement expérimental de la voix me semble pour le moins problématique.
Les registres vocaux expérimentaux, entre-temps devenus si caractéristiques de la musique vocale contemporaine et du théâtre musical (les tessitures extrêmes, les sauts audacieux, les déformations, le jeu avec les sons, avec des mélismes qui deviennent autonomes, l’exploration radicale des hauteurs et des rythmes, des voyelles et des consonnes), sont inséparables de leur corporalité. Et surtout on ne saurait les séparer de leurs registres expressifs et de leur signification, qui vibrent continûment dans la voix. Le résultat se traduit donc souvent par des grimaces acoustiques gênantes, niaises, risibles, hystériques, qui ne témoignent pas, par leurs acrobaties distordues, d’une conscience de ce qu’elles expriment vraiment pour un public impartial comme des connotations qu’elles provoquent. On ne suppose pas que ce soit l’effet recherché.