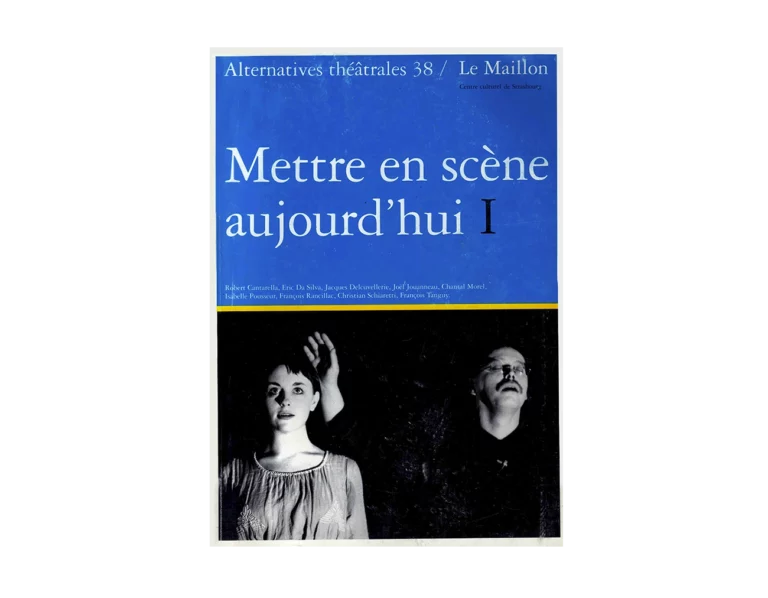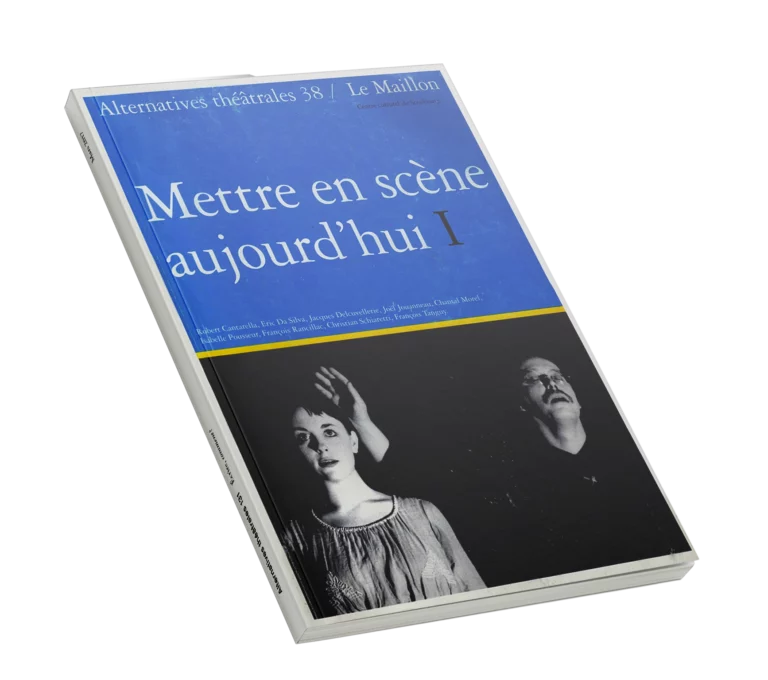On n’est pas Groupov par carte d’appartenance, on peut l’avoir été et puis ne plus l’être, on peut en être proche sans l’être continûment, on peut aussi en être sans en avoir toujours fait partie. J’évoquerai donc ici moins la réalité empirique de ceux qui, de près ou de loin, ont fait ou font encore le Groupov qu’un certain état d’esprit qui donne une identité aux travaux du groupe.
Groupov est un paysage imaginaire et complexe qui abrite des natures bien différentes. Dans un lieu ignoré du monde, des hommes et des femmes se sont un jour retrouvés : comédiens, metteurs en scène, philosophes, musiciens, sur la base d’une affinité avec le théâtre, elle-même liée à des voisinages d’interrogation sur le réel. Ont-ils voulu se faire remarquer comme tous ceux qui démarrent ? Pas exactement. Ont-ils, comme d’autres, voulu innover en faisant table rase ? Pas du tout. Leurs talents individuels auraient facilement trouvé preneur dans le théâtre reçu. Quant à la tradition, ils la revendiquent.
Sensibles au déplacement du théâtre dans l’ordre ou le désordre social, ils ont cependant refusé de faire comme si cette tradition théâtrale était restée pareille à elle-même, vivace. Ils ont refusé de la fétichiser. Au lieu de dire : le théâtre existe depuis longtemps, continuons !, ils sont revenus à des questions plus primitives : où est le théâtre ? comment en faire avec ce qui en reste ? quelle nécessité éprouvons-nous de le faire ?
Refusant de faire comme si la chose allait de soi, refusant de s’alimenter au répertoire qui existe (qu’ils connaissent bien, car ce n’est pas l’ignorance qui fonde, comme souvent chez d’autres, leur radicalité !), ils posent en préambule le rapport énigmatique que l’on entretient personnellement avec l’acte théâtral, et le rapport non moins énigmatique que le théâtre peut aujourd’hui entretenir avec la réalité, comme les seuls points de départ acceptables pour accomplir ce qui, pour eux, n’est ni une fonction ni une vocation.
Tout de suite, il sera clair que la représentation en série ou la tournée ne sont pas leurs fers de bataille. Pas de régularité dans les présentations, un spectacle qui vient quand il vient, pas de recherche efficace du produit fini : la chose qui se fait importe plus que la chose faite, le processus dans ses bonheurs, son errance ou sa productivité problématique est jugé plus désirable que la soumission aux demandes peignées de l’institution.
Résultats : des aventures toutes en aspérités et en surprises, des moments de théâtre aigus qui revendiquent leur imperfection au regard d’une certaine mythologie de l’Œuvre. Ces hommes et ces femmes vont donc cheminer, répondant aux énigmes du théâtre et du monde par d’autres énigmes, par des performances laissant parfois le spectateur dans l’étrange certitude d’avoir croisé un sphinx.
Groupov n’est pas symboliste pour autant. Dans son interrogation, la matière domine, et si le mot est accepté, c’est encore comme une matière. La manifestation du corps sur le plateau cherche l’excès, elle génère un temps de représentation spécifique et des espaces de jeu non conventionnels. Elle interroge la condition du spectateur, l’acte de voir, elle n’est pas un point de repli ou un refuge pour ne plus rien regarder autour de soi.
Le corps du Groupov n’a pas d’œillères. Même dénudé, c’est un corps historique, le corps des gens qui vivent dans un monde politique précis. Le corps de gens qui viennent après d’autres — Marx, Bataille, Artaud — et qui ne se présentent pas à nous dans la bêtise d’un surgissement sans racine.
Ils ne forment pas un collectif : ils ne se sont pas réunis faute de personnalité mais justement parce qu’ils en avaient chacun à revendre. Ils ne forment pas une troupe : le mot a des senteurs de théâtre dans la cité qui les fait sourire, nostalgiquement. Ils ne forment pas non plus une secte qui campe avec dédain sur ses positions, même si çà et là les séductions et les turbulences de la maîtrise sont présentes.
On devrait plutôt les comparer à une race nouvelle de chercheurs qui travaillent le monde avec leur tête, et leur tête avec leur corps ! Des praticiens qui théorisent en jouant, des théoriciens qui paient de leur personne en s’exposant sur le plateau, des dialecticiens qui savent que la preuve du pudding, c’est que ça se mange ! La soumission à l’acte de théâtre et à la volonté de faire, quelles que soient les conditions matérielles où ils sont, ne les empêche pas de discuter beaucoup. Ils s’interpellent, se cautionnent, se menacent, s’invectivent, ils (s’)écrivent sur l’état social de leur temps, ils profilent leur subjectivité dans le monde, ils fixent leurs processus de travail, les exercices auxquels ils se livrent, les bases qu’ils se donnent — bref, ils redoublent la pratique du plateau d’un théâtre de la pensée fait d’interlocutions parfois sereines, parfois violentes.
Pas étonnant donc que l’esprit Groupov se nourrisse en permanence de la question de la Vérité — non pas d’une Vérité à transmettre, mais d’une Vérité comme lieu d’inscription du travail (voir par exemple, la Lettre à celle qui écrit LULU/LoVE/LIFE. Cinq conditions pour travailler dans la Vérité de Jacques Delcuvellerie, qui par ailleurs réalise actuellement deux spectacles fondés sur un projet commun : L’Annonce faite à Marie de Claudel d’une part, et d’autre part un spectacle au texte original où se croisent, dans une violence du verbe, le sexe, l’esprit de Sade, l’interrogation sur le terrorisme et la dérive de notre temps dans la marchandise et le morcellement).
Donc rien de circonstanciel dans ce Groupov (par ailleurs peu favorisé dans la distribution annuelle des subventions), mais plutôt le pressentiment qu’un trajet doit s’accomplir dans l’intense, qu’il est long et difficile, que le but atteint désigne seulement le départ d’un nouveau périple, que travailler, c’est marcher à la fois en arrière et en avant, croiser ce qui jusque-là s’écartait, mais aussi séparer ce que l’on croyait fermement uni.
En conséquence, depuis un certain nombre d’années, ils marchent ! Entraînant avec eux des spectateurs hardis à qui on propose la mise en spectacle d’une urgence, un acte nécessaire. Nous sommes loin des pratiques enchantées d’une culture de bon goût. Pas de chic. Pas de grâces. Mais une séduction de la rigueur, oui ! Chacun qui assiste sent bien qu’on ne l’a pas convié à une réjouissance esthétique.
Il n’y a pas d’esthétique Groupov. Il y a certes des formes récurrentes qui signent le travail : le motif du repas, l’utilisation de textes fragmentaires, pas forcément catalogués comme littéraires, la citation sous toutes ses formes, le recours au récit, l’utilisation de la musique, un certain goût pour le matériel électronique, un plaisir à une certaine anticipation, etc. mais rien qui affiche une prétention à faire système. On prend ce qu’on trouve, on travaille avec ce qu’on a.
Ce n’est pas faute de savoir l’intérêt de la scénographie et des images. Mais celles qui existent, ils les sentent usées, un peu mensongères dans leur plénitude. Eux croient que, dans un temps de profusion décorative, il n’est pas mauvais de décevoir. Donc, ils sont plutôt minimalistes, par souci de méfiance. Aux formes qu’ils acceptent, ils demandent d’abord qu’elles aient prouvé le bien-fondé de leur utilisation. En attendant, le presque rien leur assure une paix royale du côté de l’excitation médiatique, et il ne viendrait à personne l’idée d’aller voir le Groupov pour passer une bonne soirée entre amis. C’est toujours ça d’arraché à l’assommante habitude du loisir !
En règle générale, l’establishment théâtral, quand il se déplace, se méfie. Il colle vite une étiquette d’expérimental sur ce qui bouge. Le mot d’expérimental n’est pas tout à fait faux : au Groupov, dans une certaine mouvance des années post-soixante-huit, on s’est livré et on se livre encore à des expériences. Mais celles-ci n’ont rien de formaliste, elles ne traduisent pas l’essoufflement de la pensée devant le réel comme il en va souvent de l’expérimental, elles procèdent d’une toute autre motivation : le Groupov a mis l’éthique au poste de commandement.