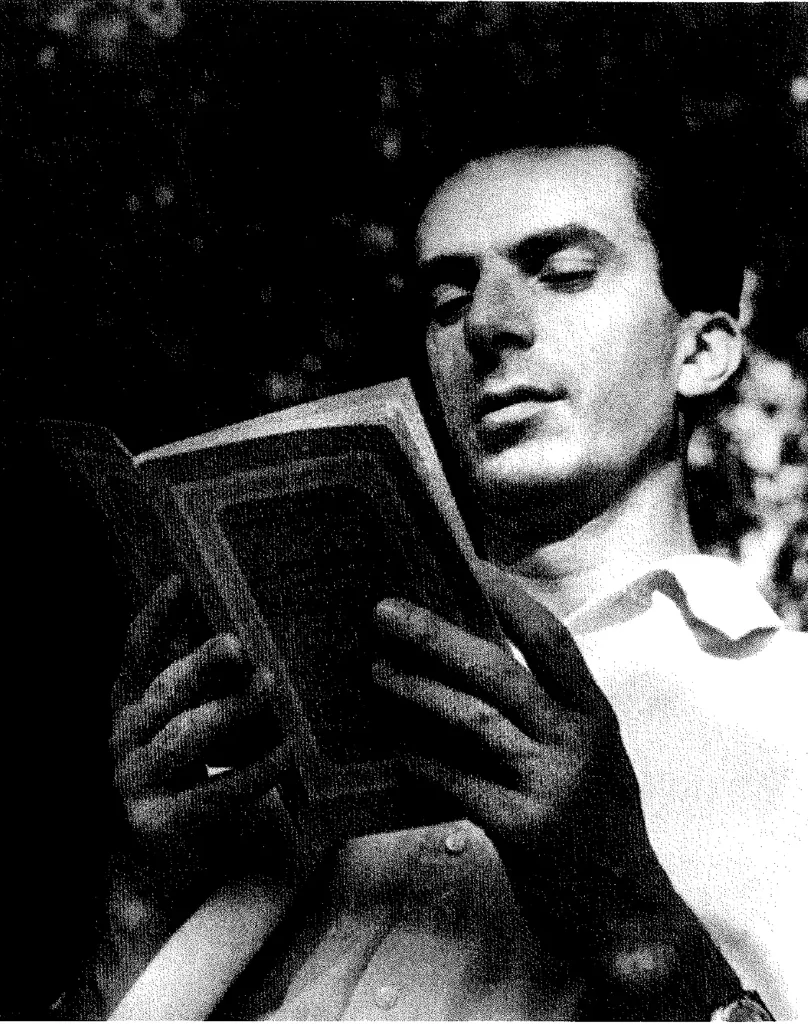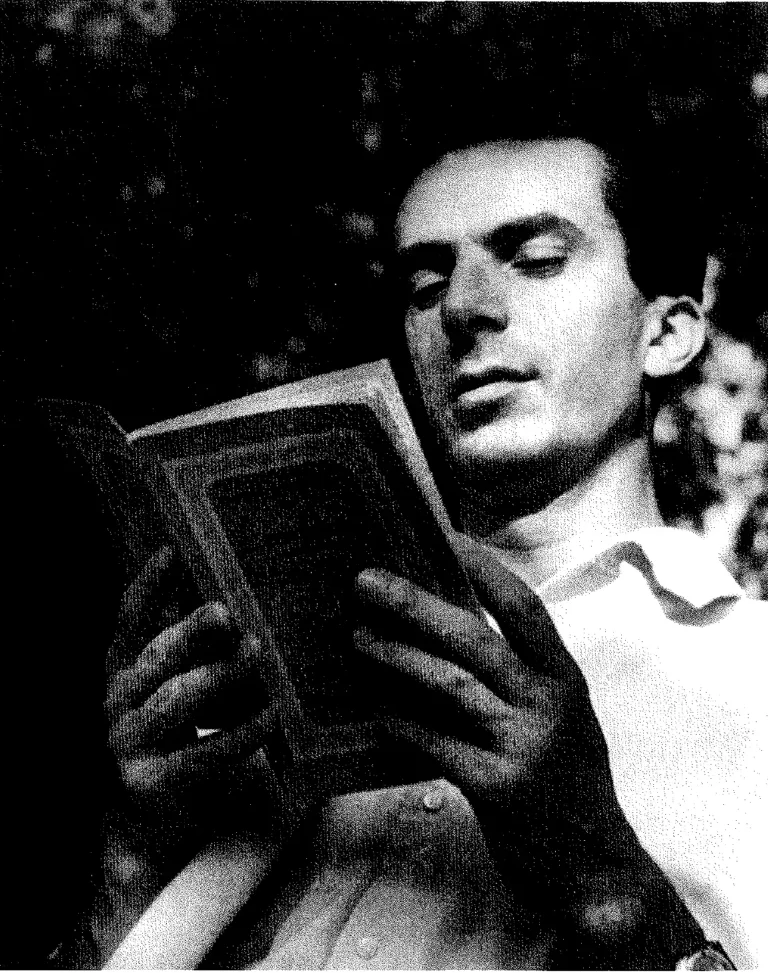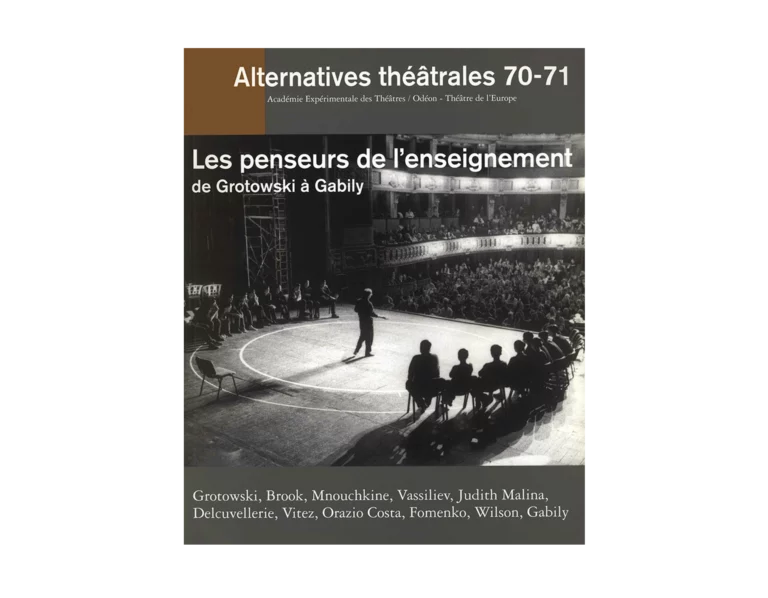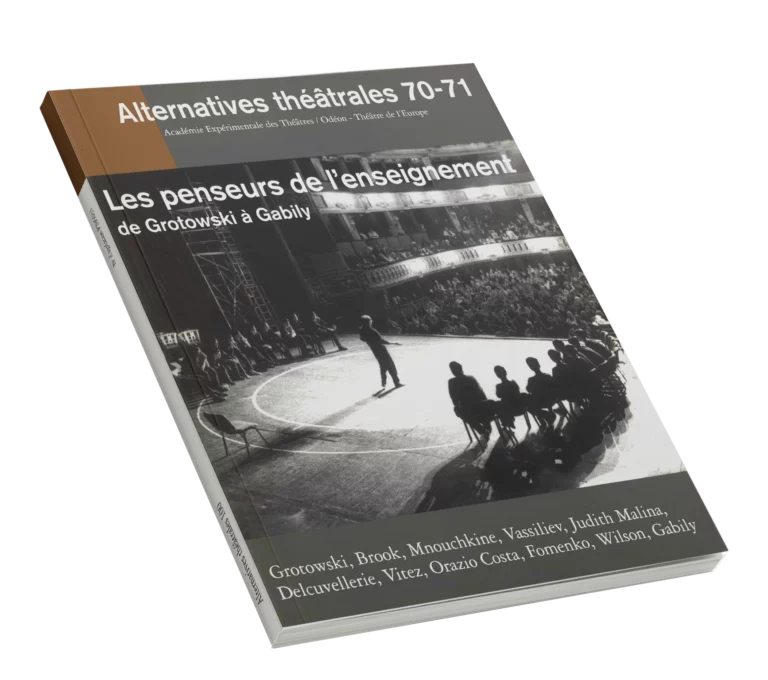J’ESSAIERAI D’ÊTRE BREF, tout en restant clair, car sinon notre discours tournera dans le vide. Dans ma méthode de travail (qui commence à être reconnue même à l’étranger dans le champ spécifique du théâtre) convergent très simplement (peut-être même trop) une poétique (c’est-à-dire une idée sur la possibilité de créer une oeuvre d’art) et une esthétique (une idée, correspondant à la première, qui détermine comment on peut analyser, juger et revivre une oeuvre d’art). Pour commencer, je voudrais insister sur l’importance essentielle dans le développement de l’individu, de l’instinct d’imitation. C’est de cette manière que le petit qui imite l’adulte acquiert les caractères définitifs de son espèce, les habitudes et les qualités. L’homme participe à cet instinct d’imitation ; son attention ne se limite pas aux individus de son espèce, mais s’adresse à tout ce qui constitue une individualité, animée ou inanimée, en exerçant son instinct d’imitation sur tout objet qui attire son attention. Alors que l’imitation propre à l’animal s’exerce par une répétition « élément par élément » dans un acte ou dans une succession d’actes, le petit homme (et après lui l’adulte) essaie d’imiter des objets (des animaux, des choses, des phénomènes) et se retrouve sans éléments aptes à être imités à l’identique. Néanmoins, presque sans s’en apercevoir, en suivant un autre instinct, que j’appelle « mimétique », il franchit très spontanément cette limite d’impossibilité et continue l’imitation même si les éléments identiques font défaut (puisque l’identité est désormais exclue). Il attribue à certains des éléments le rôle des autres et les aspects les plus divers des objets en question. Par de nouvelles actions uniques ou sériées, complètement abstraites, il réalise un nouveau type d’imitation analogique, qui mérite ainsi une autre appellation : on passe d’une « imitation » à une mimétisation « ou jeu mimétique ».
On passe donc de la simple répétition à une fonction qui est en même temps interprétative et créative. Elle est interprétative, car ne pouvant pas reproduire, elle doit traduire. Créative, puisque le choix des parties expressives du corps (gli arti) n’a aucun caractère mécanique : la nature de chaque individu s’en charge, par des mouvements spontanés d’origine psychique. C’est ainsi, je pense (et il y a plusieurs théories philosophiques et psychologiques de l’esthétique qui me confortent en étant proches de ces idées), que naît l’expression, le désir de déclarer ce qui est ressenti et éprouvé en s’identifiant à l’objet de son attention, en le reflétant et en lui donnant la personnalité que nous attribuerions à une forme humaine ainsi transformée, qui pourra se « manifester » selon les actes qui lui conviennent.
En dépassant ainsi l’imitation de ses semblables (parents, frères, etc.), toujours prêts à utiliser l’imitation devant les instructeurs officiels ou occasionnels, nous entrons de plein pied dans le monde privé de l’interprète-créateur1, qui est celui de la « mimazione », jeu mimétique (j’évite le mot « mimésis », plus élégant, afin d’éviter des confusions avec les différentes conceptions philosophiques).
Dans ce monde du jeu mimétique (ayant certainement contribué à l’origine à la création du langage) se poursuit encore aujourd’hui la naissance de toute activité artistique primaire.
L’arbre, mimé (imité) et vécu à nouveau. De même, le nuage, la fleur, l’animal, la lune, l’eau, la roche, la pluie, la mer, le vent (bien qu’invisible), deviennent des expériences intérieures concrètes. Non seulement cela peut se manifester dans des actes et des formes, similaires à des danses, mettant en évidence les rythmes propres à chaque objet, mais cela peut également produire des modifications de l’appareil respiratoire et phonatoire (qui adopte complètement et spontanément, en parallèle, les formes que les membres du corps prennent à l’extérieur) devenant capable de produire des sons dont l’analogie est proche ou qui, plutôt, peuvent faire référence aux formes assumées à l’extérieur. L’ensemble de l’appareil respiratoire et phonatoire se présente comme un second appareil mimétique, qui ne pourra être séparé que pour des raisons techniques du parallélisme déjà évoqué, pour s’intégrer indépendamment dans l’appareil externe. Il s’agit pourtant d’un autre discours, qui concerne les techniques du langage parlé.
C’est à partir de ces expériences qui se perfectionnent en passant de l’individu synthétique à l’individu analytique, de l’individu singulier au collectif, du grand au petit, du visible au mental, du substantif à l’attribut, au verbe et au complément qui modifie l’action, que naît l’expression, chaque fois que nous ressentons le désir ou la nécessité, à partir d’une plénitude intérieure, et d’une envie de la rendre à l’extérieur et de la communiquer.
Chaque individu naît avec des tendances qui font que son expressivité mimétique se coule dans une technique, car le langage mimétique d’origine est trop privé et personnel.
Je crois que tout art naît du, ou plutôt, dans le « jeu mimétique ». La danse tout d’abord. Puis, est arrivée la musique, d’abord le chant (action parallèle de la danse), ensuite les instruments, reproduisant le parcours abstrait de la danse extérieure, puis intérieure. Puis le dessin, initialement un simple tracé du geste et du mouvement dansé, puis, par l’enregistrement, la mémorisation volontaire d’un acte mimétique. Enfin, la sculpture, empreinte de gestes. Arriveront après ces arts primitifs ceux qui sont réfléchis et composés : la poésie, la peinture, l’architecture. Chacun d’entre eux rencontre d’autres réalités : du langage, ajouté au rythme et au chant, de la couleur ajoutée au dessin et à la plastique ; le repaire se transforme en toit, la grotte en tanière et le nid des animaux suggère à l’homme un gîte, qui très vite se libère de son habitation physiologique pour inventer quelque chose de plus approprié, de plus utile, de plus impressionnant et beau, passant par tous les degrés du monde organique, du fonctionnel, de l’expressif, puis de l’esthétique. Car l’architecture, après la danse, est l’art par excellence, qui est le propre de toute condition humaine.
L’action mimétique est donc l’interprétation de la réalité et la création d’une représentation de celle-ci, le plus souvent à travers des formes à l’origine abstraites et non figuratives. De là l’importance et l’utilité des recherches non-figuratives actuelles, à condition de voir dans ces recherches non pas une originalité, mais simplement une nouvelle manière de revenir aux conditions mêmes de l’art au moment de sa première manifestation.
Il y a des arts qui possèdent une réalité par la possibilité de les « enregistrer ». Le dessin, la sculpture et même la poésie après l’invention de l’écriture, et, évidemment, l’architecture. La danse et la musique sont non enregistrables à des degrés divers. Pour la musique, la mémoire a été nécessaire jusqu’à l’invention d’une écriture appropriée, tandis que pour la danse l’écriture est pratiquement impossible, de sorte que la première forme d’art, et la plus spontanée, a été, avec le cinéma, la dernière à pouvoir être enregistrée. La possibilité de l’enregistrement comme fait fondamental est un chapitre très important des techniques.
Qu’est-ce donc que l’enregistrement d’un fait artistique ? Qu’est-ce qu’une oeuvi:e d’art, un produit artistique, un objet manufacturé ? C’est la mémoire enregistrée, fixée, conservée d’une condition miméticocréative éprouvée, subie, vécue et re-vécue2 par un homme dans un état exceptionnel, qui s’accompagne souvent ou qui trouve son origine dans une exaltation particulière de l’être, l’inspiration.
Ainsi, un sonnet, un poème, un dessin, une peinture, une statue, une architecture de niveau esthétique (qui n’est pas purement utilitaire), un film, une danse, une musique, un drame, sont l’enregistrement d’une danse intérieure qui a trouvé moyen de s’exprimer à travers le langage propre à chaque art, mais que l’on peut, de toute façon, faire remonter aux activités mimético-créatives. Il s’agit de la captation d’idées et de sentiments qui appartiennent à des degrés divers à l’air d’une époque, mais qui sont éprouvés et fixés pour la première fois par ceux que nous appelons des artistes ou des génies.
Il en ressort ainsi suffisamment clairement qu’en toute rigueur l’interprétation de chaque oeuvre d’art a besoin d’être resituée à la température créative dans laquelle elle fut conçue et exprimée.
Se pose alors le problème de l’interprète et de son éducation.
Il faudrait observer d’abord comment l’oeuvre d’art se présente à l’observation externe et quels sont les éléments offerts à l’examen nécessaire qui permettra à l’interprète d’y avoir accès et de la revivre.
Une oeuvre d’art (chaque oeuvre d’art), soit dans son registre autosuffisant (dessin, peinture, sculpture, cinéma, et parfois la poésie écrite), soit dans un registre inachevé (la musique, la poésie en partie, le drame), ou enfin dans sa créativité fondamentalement inapte à l’enregistrement (la danse), naît en s’appuyant sur un arrière-plan spatio-temporel, crée son propre continuum de langage expressif et se développe par périodes, se succédant grâce à des charnières adaptées pour converger vers un ou plusieurs moments essentiels et s’interrompre lorsque la durée prévue dans l’arrière-plan l’exige. L’oeuvre d’art normalement demande au spectateur de suspendre ses (pré-) occupations temporelles et appelle à l’apparition d’une condition plastique capable de vibrer à l’unisson avec le rythme et les sens qu’elle porte.
Même le simple spectateur est un interprète, un interprète qui participe ainsi en quelque sorte à la création de l’auteur. Leurs attitudes dans le triangle auteur — interprète — spectateur sont communes, mais à des degrés divers. Nous sommes tous des spectateurs possibles et, par là, des interprètes et des créateurs en puissance. Certains n’atteignent qu’une créativité plutôt modeste, mais ont une capacité d’interprètes. Un nombre encore plus restreint de gens ont, plus ou moins, des capacités créatives d’auteurs. Certains interprètes surpassent en réalité quelques créateurs médiocres et on peut comprendre qu’ils les supplantent. Un grand nombre de grands créateurs qui entrent dans un monde expressif totalement nouveau perdent leur qualité d’interprète, et ainsi de spectateur et d’observateur.
Éduquer artistiquement l’homme, c’est le considérer essentiellement comme un observateur (ou spectateur) de la réalité extérieure et, secondairement, aussi de la réalité intérieure, qui lui sera révélée souvent à partir de la réalité extérieure, tandis que l’extérieur se présente à son intuition dé jà teintée plus ou moins consciemment du monde intérieur.
Il s’agit de lui faire ce-parcourir et retrouver consciemment le chemin déjà fait inconsciemment en rencontrant la nature, lui faire découvrir et goûter la séduction du comportement mimétique, le rendre informé de tous les pas successifs exécutés en passant d’un type d’objet à l’autre (objet immobile, objet mobile, phénomène météorologique, etc.), du singulier à la série (arbre / forêt, vague / mer, brebis / troupeau, oiseau / vol d’oiseaux, mont / montagnes), de l’objet comme totalité à l’objet comme composition (arbre et puis racines, tronc, branches, frondaison, fruits, et de plus, fleurs ou fruits, feuilles, rameaux, tronc, racines, avec toutes les variantes possibles), de l’ensemble homogène à l’ensemble hétérogène (un élément de panorama : une maison, une rivière, puis beaucoup d’éléments rangés en ordre spatial, par leur importance ou par progression émotionnelle). Remarquons ensuite comme chaque impression, intuition, possibilité de définir l’objet et le phénomène dérivent de la forme assumée en les imitant. C’est pourquoi, exemple le plus simple, le saule s’appelle « pleureur », le chêne « robuste » (le nom latin du chêne est effectivement robur), la mante est « religieuse » et ainsi de suite.
Remarquons ensuite que clans les passages d’un moment à l’autre d’une « activité mimétique » prolongée apparaissent des points de suture, des articulations ou des jointures, par lesquelles on passe d’une forme à l’autre, d’un état de tension à un autre. Puisque, en variant l’objet, la condition physique de la tension varie également : nous pouvons nous sentir clans un état minéral de magnésium ou de plomb, dans un état liquide d’eau ou de mercure, dans un état gazeux d’air ou de vent ou bien de plasma, etc.
Remarquons aussi que les mêmes intervalles musicaux donnent lieu à des images et à des transformations physiques qui nous rendent doux ou amers, renforcés ou affaiblis, etc.
Il faut à celui qui interprète aller chercher ce stade plastique idéal qui lui permet de recevoir au mieux l’impression formatrice des choses. Il la trouvera clans l’image vécue du nuage, de l’air, du gaz, de l’eau, et à partir de là saura tracer son plan d’action à l’aide de milliers de transformations d’aspects variés.
Il est clair que pour l’acteur il sera important de se rendre compte au plus vite de la plasticité de son appareil phonatoire et respiratoire pour pouvoir, à l’invitation de la réalité extérieure, modifier subtilement les intonations vocales.
À ce point, l’élève interprète est à même de comprendre, en passant à l’étude appliquée et analytique de son art (vers lequel l’auront dirigé les aspects caractéristiques de son travail mimétique), comment l’opération effectuée directement sur la réalité par l’auteur (poète, peintre, musicien), grâce au jeu mimétique, sera traduite en oeuvre d’art. L’analyse de celle-ci rendra plus aisée la découverte, parfois très difficile, des mouvements mimétiques d’origine ayant engendré l’ensemble, ainsi que ses différents moments.
L’interprète possède maintenant l’instrument (son physique éduqué en vue de l’art mimétique) pour faire face à l’oeuvre d’art et à tous ses aspects, comme devant une réalité déjà qualifiée.
Si ainsi, en observant la réalité, il aura pu y choisir des éléments divers selon ses préférences et tendances, il acceptera le travail déjà fait de la même manière (ou de manière assez proche) par l’auteur et épousera pour ainsi dire cette interprétation qu’il assume comme significative avec toutes ses activités plastiques et pourra par conséquent recréer (dans une approximation heureuse, puisque le langage est commun et réduit à ce que nous avons de plus commun, notre physique) la condition créative des parties et de l’ensemble, éprouver l’émotion et, à travers des essais successifs, réussir à la communiquer (encore une fois par une approximation heureuse) à l’observateur.