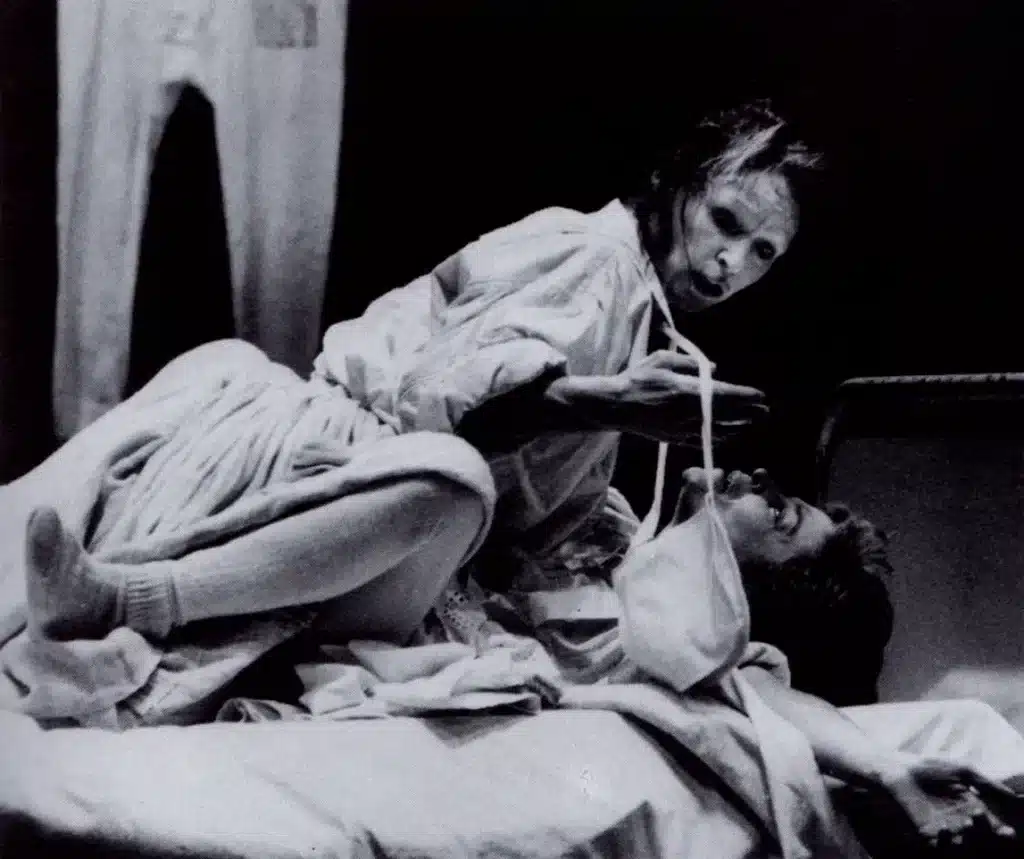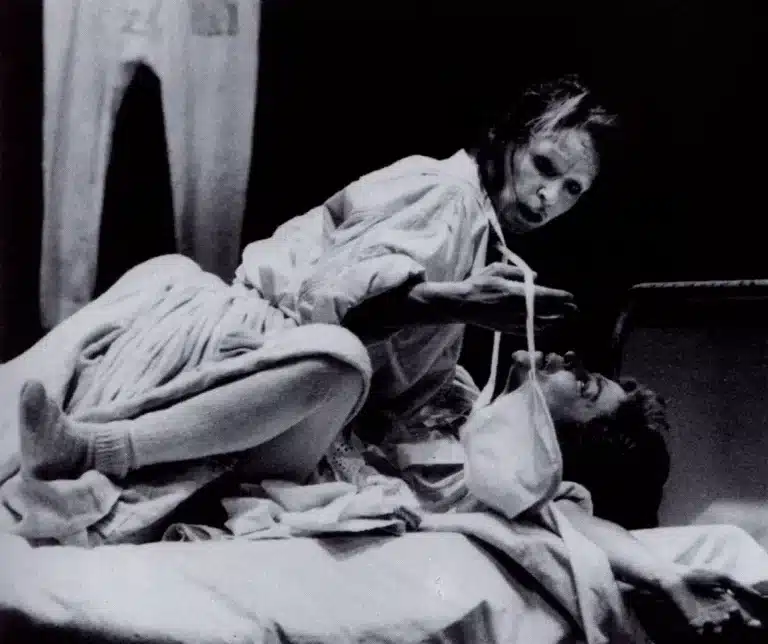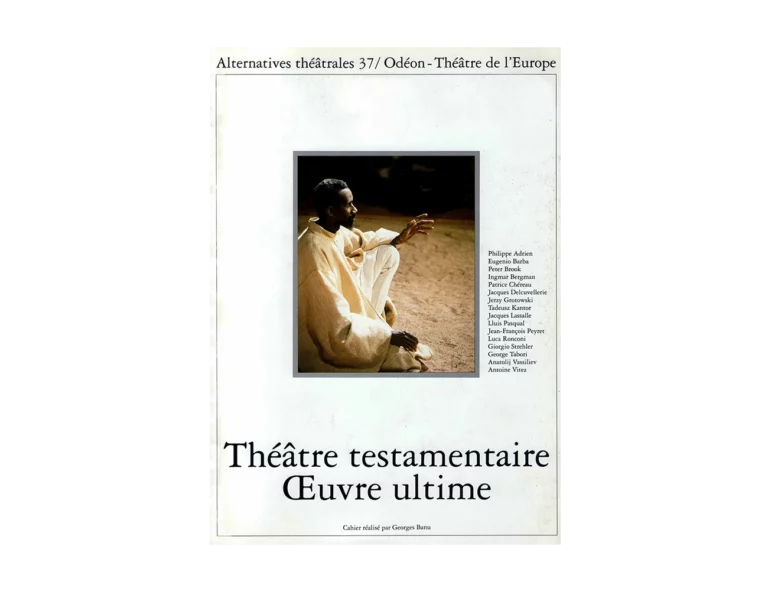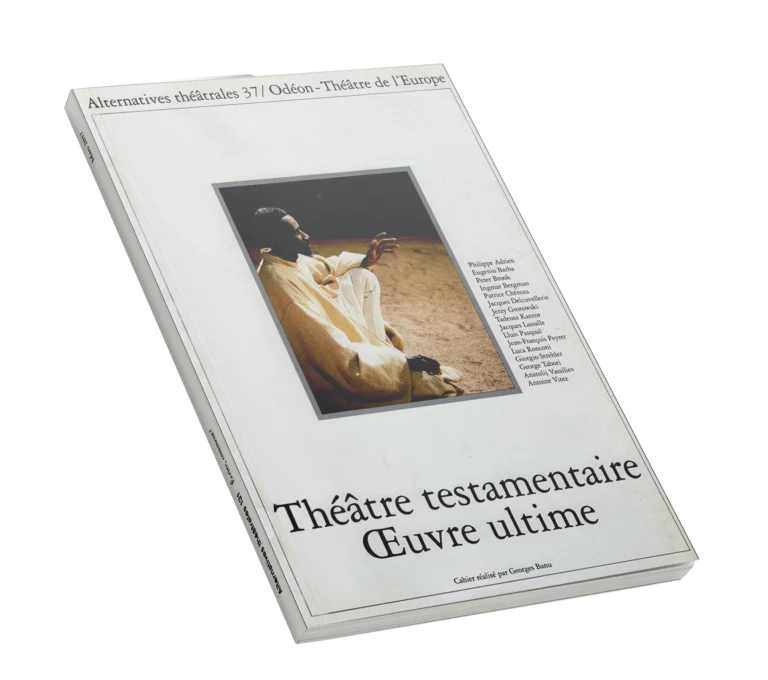OLIVIER ORTOLANI : Patrice Chéreau a dit un jour que le théâtre est un art nostalgique, car il est plus tourné vers le passé que vers le présent ou l’avenir et que le cinéma est un art beaucoup plus apte à représenter le monde d’aujourd’hui. Qu’y a‑t-il de contemporain et qu’y a‑t-il de dépassé dans le théâtre ?
George Tabori : Je ne parlerais pas de nostalgie comme Chéreau, parce que cela a un goût légèrement sentimental ou mélancolique. Mais il est vrai que le théâtre rend présent, re-présente le passé. Il s’agit toujours du passé. Mais le public le perçoit au présent. Il est toujours question de l’Ici et Maintenant et c’est ça la différence par rapport au cinéma. Au cinéma, on sait que ça a été tourné il y a six mois ; le cinéma dit : II était une fois. Le théâtre par contre dit : Il est une fois. Quelque soit le style ou la dramaturgie, le spectateur le perçoit pour la première fois et en même temps pour la dernière fois. La gloire et l’horreur du théâtre, c’est que ça se passe toujours au présent. C’est toujours transitoire, c’est toujours la première et la dernière représentation. C’est pourquoi, je trouve le théâtre plus beau et plus intéressant que le cinéma.
Qu’est-ce qui est contemporain ? Qu’est-ce qui est politique au théâtre ? Je crois que ça varie et que c’est lié à l’histoire. Quand je pense à ma période new-yorkaise — j’y ai passé vingt ans —, quand je pense aux années soixante, aux Noirs, aux étudiants, au Vietnam — l’exigence du jour était alors parfois tellement forte qu’on était forcé de s’affronter directement à l’actualité en faisant du théâtre d’agitprop ou du théâtre de rue comme je l’ai fait. Mais d’une façon générale, le théâtre ne doit pas être confondu avec le journalisme. Ça, les médias savent le faire beaucoup mieux que lui. Le théâtre a besoin d’une certaine distance, il faut qu’il digère les choses. Pour moi Shakespeare est le dramaturge le plus contemporain. Le grand changement politique de l’année passée ou ce qui se passe entre les hommes et les femmes — Shakespeare en parle à sa manière et de ce fait il est toujours d’actualité. Je suis d’accord avec Peter Stein quand il dit qu’il pe faut pas courir après l’esprit du temps.
Je viens de monter pour la quatrième fois FEMMES. GUERRE. COMÉDIE de Thomas Brasch, ce que je n’ai encore jamais fait avec un autre texte, car j’aime cette pièce. Elle reste une énigme pour moi mais je m’en approche à chaque fois davantage. Comme il y est question de la guerre, avec les événements en Irak, la pièce a acquis tout à coup une actualité politique étrange pour moi et aussi pour le public. En 1983, j’ai écrit une pièce qui s’appelle JUBILÉ où il est question de profanation de tombes. À l’époque, on n’en entendait parler que de temps en temps. Mais soudain l’année passée nous parvenaient des nouvelles de profanations de tombes en France, en Angleterre et au Minnesota et par là la pièce était redevenue actuelle.
0.0.: Vos textes décrivent toujours des moments douloureux, névralgiques de l’histoire de l’humanité ou de l’individu et s’intéressent particulièrement aux victimes, aux handicapés, aux minorités ethniques. C’est un théâtre contre l’oubli, qui travaille un passé inconfortable, dérangeant sans arrêt notre présent. Le théâtre fonctionne-t-il pour vous comme mémoire de l’humanité ?
G.T. : Le refoulé, qu’il soit personnel ou politique, par le fait qu’il est refoulé, réapparaît toujours. C’est le spectre du père d’Hamlet. Lorsque j’écris ces textes sur les Juifs ou les Allemands ou n’importe qui, je ne suis pas un plan. Je ne me dis pas que maintenant le moment est venu pour ceci ou pour cela mais le sujet s’annonce tout seul, il frappe à la porte en disant : « Laisse-moi entrer ! » Et alors il est difficile de résister. On ne devrait écrire que ce qui demande de l’être.
Ce ne sont pas seulement les bourreaux qui refoulent ce qui est arrivé mais les victimes non plus n’aiment pas en parler. Quand on parle avec des gens qui étaient vraiment à Auschwitz ou dans d’autres camps de concentration, on sent tout de suite qu’ils n’aiment pas être confrontés à leurs souvenirs, avec ce qu’ils y ont vécu. Mais en le refoulant, cela ne disparaît pas, cela ne fait que revenir régulièrement. Chez moi aussi. Je me rappelle qu’après la guerre quand j’ai appris que mon père avait été assassiné à Auschwitz, ma réaction a été d’écrire un roman. Je vivais alors en Angleterre et quand le roman fut fini, je ne l’ai montré à personne et il ne fut pas édité. J’avais compris qu’on ne pouvait pas procéder ainsi. J’étais d’avis que seul celui qui l’avait vécu pouvait écrire sur ce sujet. C’était en 1945 ou 1946. Mais en 1967 à New York, j’ai écrit LES CANNIBALES parce que le sujet est revenu frapper chez moi. Je n’en ai pas fait une pièce documentaire mais ma perspective est celle des fils qui essaient de s’imaginer ce qui est arrivé à leurs pères. Quand je vivais aux Etats-Unis, le sujet ne m’a donc longtemps pas intéressé. Quand je suis revenu en Allemagne, au début ce sujet ne me préoccupait pas non plus mais soudain il a réapparu. Les sujets s’annoncent tout seuls.
0.0. : Croyez-vous qu’il y a des œuvres et des auteurs qu’on ne peut pas aborder sans une certaine expérience de la vie ou du théâtre ? Est-ce qu’il vous est déjà arrivé d’affronter des sujets pour lesquels vous n’étiez pas assez mûr ?
G.T.: Oui. Il y a presque vingt ans je dirigeais un laboratoire de théâtre à Brême. Un groupe d’acteurs s’était formé et j’avais envie de faire une pièce ou plutôt un collage sur le bonheur. Je me disais : « Tout le monde est tellement malheureux, peut-être ne serait-ce pas inutile d’examiner ce qu’est en fait le bonheur ». Nous avons ensuite commencé à travailler sur ce thème pendant un ou deux mois mais en réalité, je n’étais pas prêt et le groupe non plus, et c’est seulement cet été que j’ai écrit la pièce qui s’appelle BABYLON-BLUES que nous montrerons prochainement à Vienne. Ce sont vingt micro-drames. Comment peut-on être heureux sans faire d’efforts ? C’est écrit un peu à la manière de Cami dont j’aime beaucoup le type d’humour. Le bonheur naît quand le malheur cesse d’exister et pas autrement. Il fait froid et on entre dans une pièce chauffée. On a soif et on boit. On attend un coup de téléphone de la dame de son cœur et enfin le téléphone sonne.
0.0. : Le bonheur dans le malheur est quelque chose qui vous a toujours préoccupé. Bien que vous ayez une prédilection pour les textes apocalyptiques, les situations de « fin de partie », les moments où la fin du monde ou de l’individu s’annoncent, on ne peut pas ne pas voir que malgré tout cela, existent toujours des instants où toute catastrophe semble réversible, où perce un éclair d’utopie. Dans votre pièce LE COURAGE DE MA MÈRE, fondée sur un fait réel autobiographique, il n’y a pratiquement pas d’issue pour votre mère condamnée à mort mais au dernier moment la situation se renverse et elle est sauvée. Dans LES CANNIBALES, il y a même deux personnages qui survivent au monde concentrationnaire.
G.T. : Je crois que les motivations profondes d’un auteur sont toujours cachées. Peut-être des années après on peut comprendre pourquoi on a fait telle ou telle chose. Mais les sources inconscientes qui sont les plus importantes sont d’abord bien dissimulées. En ce moment, je suis en train de lire l’essai de Sartre sur Flaubert, L’IDIOT DE LA FAMILLE. Ça a duré très longtemps avant que quelqu’un comme Sartre trouve le psychogramme de Flaubert. Quand j’étais jeune, Flaubert a été un modèle pour moi. Le mot juste, le perfectionnisme. Mais je ne savais pas d’où il tenait ça. Parfois ces vérités d’où viennent les choses apparaissent à la surface mais il faut être conscient que ce n’est pas la vérité objective mais uniquement une interprétation. Je viens de lire que vingt-huit mille livres ont été écrits sur HAMLET. Evidemment chacun y lit autre chose et il faut respecter cela. Surtout au théâtre la différence est importante. J’essaie toujours de trouver l’identité de chaque œuvre, je la cherche consciemment, non parce que je voudrais me différencier de Stein ou de Zadek — ça de toute façon je le fais — mais parce qu’on a besoin de cette identité pour ensuite pouvoir présenter des variations de représentation en représentation. C’est la raison pour laquelle le théâtre est pour moi la chose la plus proche de la vie. C’est la seule chose qu’on ne puisse pas reproduire. Cela fait naître un certain pathos mais aussi un principe d’espoir. Quand j’ai fait HAMLET, il y avait sept ou huit cadavres à la fin. Chaque représentation est donc la dernière mais en même temps quand le rideau tombe, les cadavres se lèvent et sont prêts à mourir à nouveau. Dans la vie, ça n’est pas possible. C’est en cela que réside l’espoir.
Je ne sais pas si je suis optimiste. Quand j’étais enfant, ma grand’mère me racontait toujours des contes à partir des pièces de Shakespeare. Peu importe combien de cadavres il y avait à la fin, elle disait toujours : « Tout est bien qui finit bien ». Quarante ans plus tard quand j’étais à New York, j’ai fait une psychothérapie comme tout le monde. La première chose que j’ai faite, était un test Rorschach. Ma thérapeute était une Française, un peu vieux jeu, très gentille, elle était un peu sourde et après avoir fait le test, elle m’a dit : « Peu importe à quel point tout est horrible maintenant, à la fin tout sera O.K. Ce sera comme dans un conte ». Au début cela me dérangeait, je pensais à l’inévitable happy end. Mais en réalité, il s’agit d’autre chose, parce qu’au fond, les contes sont aussi des histoires d’horreur qui s’arrangent à la fin. Le loup ne dévore pas le petit chaperon rouge.
0.0.: Pour vous le théâtre a une grande puissance thérapeutique. Quelles sont vos expériences en ce domaine ? Comment le théâtre libère-t-il acteurs et spectateurs.