ALTERNATIVES THÉÂTRALES : D’où est né le désir d’éditer des pièces de théâtre ?
Jean-Pierre Engelbach : Avant d’être éditeur, je suis comédien. Avant de faire des livres, je fais du théâtre. Sorti en 1968 de l’école du T.N.S., j’ai exercé mon métier d’acteur, entre décentralisation et jeunes compagnies, auprès des plus grands de notre génération, Chéreau, Dubois, Vincent, Gironès, Bayen, etc. De Paris à Strasbourg en passant par Caen, Lyon, ou Toulouse, j’ai participé à l’effervescence artistique des années 70, dominée par la personnalité de quelques créateurs, animateurs de compagnies gui affirment avec force la toute puissance de la mise en scène. On programme alors une majorité de textes classiques que l’on « revisite» ; on adapte pour la scène nombre de textes non théâtraux (essais, romans, nouvelles); on convoque des équipes de comédiens pour de longues séances d’improvisations, matière première mouvante de spectacles dits de « création collective ». C’est l’époque où l’on affirme avec force qu’il n’y a plus d’auteurs. Le développement de ce que l’on commence déjà à nommer du terme d’écriture scénique, se fait, il faut bien le dire, aux dépens de l’écriture dramatique, et de ses auteurs vivants, relégués la plupart du temps, au rôle de dramaturge ou d’assistant. Quant à l’acteur, gui se retrouve trop souvent coupé de la parole vivante du poète, on lui demande plutôt de contribuer à servir au mieux les images scéniques du tout puissant nouveau démiurge, le metteur en scène.
Autour des années quarre-vingt, ce sont les comédiens gui, les premiers, vont réagir et rechercher avec force de nouveaux auteurs, susceptibles de ramener au théâtre la parole de l’écrivain. Certains, comme moi, se mettent à lire (c’est à cette époque que je découvre CONVERSATION CHEZ LES STEIN SUR MONSIEUR DE GOETHE ABSENT de Peter Hacks, que je fais traduire et réalise avec M.-C. Barrault). D’autres acteurs sautent le pas et se mettent à écrire (Denise Bona!, Jean-Paul Wenzel, Louise Doutreligne, Yves Reynaud, par exemple); d’autres, comédiens ou metteurs en scène, incitent avec force des écrivains ou des dramaturges, (Michel Deutsch, Bernard Chartreux,Jean-Christophe Bailly, Daniel Besnehard, Jean Magnan, Daniel Lemahieu … ) à écrire pour le théâtre.
À cette nouvelle génération d’auteurs gui écrivent pour le théâtre, il ne restait plus qu’à trouver un éditeur. Pourquoi pas moi ? Voilà pour le désir ? Quant à sa réalisation, quant au lancement de la première collection THÉÂTRALES chez Edilig en 1981, quant à la fragilité d’une entreprise éditoriale limitée par l’étroitesse de son marché, c’est une autre histoire que nous pourrons évoquer une autre fois.
A. T.: Voyez-vous se dessiner une évolution au sein de l’édition théâtrale ?
J.-P. E.: Bien sûr ! Et ce, d’autant plus que mon parcours d’éditeur de théâtre est étroitement lié à cette évolution. Auparavant, je ne pouvais que déplorer la résistible disparition des livres de théâtre, dans les librairies d’abord, puis chez les grands éditeurs ensuite. Entre 1975 et 1980, Gallimard, (avec le Manteau d’Arleguin), Le Seuil (avec sa collection T), Stock (avec sa collection Théâtre Ouvert), Pierre-Jean Oswald rejoignent la liste des éditeurs gui cessent la publication du théâtre contemporain : ces grands éditeurs généralistes ne veulent même pas publier les pièces de théâtre de leurs auteurs- maison ! Ils contribuent ainsi à renforcer une idée de plus en plus admise laissant entendre qu’il n’y a plus d’auteurs de théâtre ; s’il y en avait, cela se saurait, ils seraient publiés, ainsi que le formulait alors en public Bernard Pivot.
Le lancement de la collection THÉÂTRALES marque le début d’une lente renaissance. Avec la publication de neuf titres par an, la maison d’édition associative de la Ligue Française de l’Enseignement1 (Il répond à une demande réelle de ces compagnies de théâtre, amateurs ou professionnelles, et tente de militer pour un répertoire contemporain, ainsi que J’indique très explicitement le sous-titre de la collection. Auprès de cette collection que je dirige, nous publions pour la première fois des auteurs comme Minyana, Bona!, Reynaud, Lemahieu, Sarrazac, Lebeau, Besnehard gui représentent la nouvelle génération des écrivains issue du théâtre. Dès 1985, Christian Dupeyron — qui avait déjà redynamisé la poussiéreuse revue l’Avant-Scène en y introduisant quelques jeunes auteurs — va lancer une nouvelle maison d’édition, Papiers, consacrée au théâtre. Cette dernière rapidement absorbée par Actes Sud : deviendra la célèbre collection Actes Sud-Papiers gui développe alors une politique éditoriale ambitieuse ( une cinquantaine de nouveaux titres chaque année) et publie la plupart des nouvelles pièces jouées sur scène. Dans le même temps, les efforts de Danièle Dumas — qui reprend l’Avant-Scène et lance les éditions des Quatre Vents — et la renaissance des éditions de l’Arche, sous l’impulsion de Rudolf Rasch, contribuent à réveiller un secteur éditorial qualifié de « sinistré ». Quelques années plus tard, Émile Lansman, dont les éditions sont implantées en Belgique, assure une présence dynamique du livre de théâtre dans les salons et les festivals, et vient renforcer la « bande des quarre », ceux que Michel Vinaver, dans un rapport sur l’édition théâtrale en 19862, qualifiait « d’éditeurs-militants ».
Aujourd’hui, si l’on comprabilise routes les publications (celles des éditeurs spécialisés, celles des revues ou d’éditeurs régionaux) encouragées par les incitations ponctuelles du Centre national du Livre, on peut dénombrer une centaine de pièces nouvelles publiées chaque année. Je pense gue c’est un progrès déterminant gui traduit la renaissance de l’écrit théâtral et la place qu’il retrouve peu à peu dans le paysage du livre comme dans celui du théâtre. Voilà pour le quantitatif. Quant à l’évolution qualitative, il est sans doute trop tôt, en cette période de convalescence, pour en faire le bilan artistique. Aux éditions Théâtrales, nous confirmons les premiers choix éditoriaux de 1982, cour en accueillant progressivement dans la collection « Répertoire contemporain » les nouveaux venus, comme Azama, Renaude, Durringer, Bouchard, notamment. Même s’il reste nécessaire de faire confiance au temps et à la scène pour déterminer ceux des poètes d’aujourd’hui gui laisseront leur marque sur le théâtre de demain, on ne peut plus ignorer la renaissance des auteurs dramatiques ; il ne reste plus qu’à les lire !
A. T.: Quels aspects privilégiez-vous dans les œuvres que vous retenez ?
J.-P. E.: La lecture des titres et des auteurs qui figurent à notre catalogue donne déja une bonne indication des aspects que nous souhaitons privilégier aux éditions Théâtrales et qu’il convient sans doute d’expliciter.
Tout d’abord, nous accordons la priorité à l’écrit ; affirmation qui pourrait paraître pléonastique pour une maison d’édition, mais pas inutile à rappeler lorsqu’on parle d’écrit théâtral. Pour nous, le texte de théâtre est un genre littéraire à part entière et sa publication doit témoigner de son appartenance au monde de la littérature. Et cette affirmation n’est aucunement contra- dictoire avec la spécificité de cette écriture destinée à un spectacle vivant. Au contraire, si on considère que l’aboutissement de l’art théâtral consiste en la rencontre — unique, éphémère, et chaque soir remise en péril, — du poème dramatique et de l’acteur, réunis pour le seul plaisir des spectateurs, il est nécessaire de disposer de véritables poètes, artisans des mots, de la langue et du verbe, pour nourrir et enrichir l’art de la scène. Ce sont donc des qualités tout à la fois littéraires et théâtrales que nous essayons de repérer dans les manuscrits qui nous sont adressés ; qualités qui guident nos choix artistiques.
De ce point de vue, l’édition d’une pièce permet à l’auteur de rencontrer plusieurs équipes de création (simultanées ou successives), et de conserver pour longtemps la matière textuelle sur les rayons des librairies. Cela confère à cette œuvre littéraire une autonomie par rapport à la (ou les) mise (s) en scène auxquelles elle aura éventuellement donné lieu. C’est pourquoi nos choix éditoriaux — malheureusement limités par les énormes difficultés de commercialisation de la littérature théâtrale — s’attachent à privilégier les textes écrits principalement à destination du théâtre, même s’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une représentation. Quant aux formes scéniques initiées, soit par des improvisations, soit par des adaptations de textes non-théâtraux ( romans, essais, nouvelles, poèmes), elles restent étroitement liées à l’équipe de création qui les a produites et, de ce fait, sont difficilement transmissibles par le biais du livre. Nous avons ainsi renoncé à publier les traces des spectacles dont le texte dramatique n’est pas la matière première initiale.
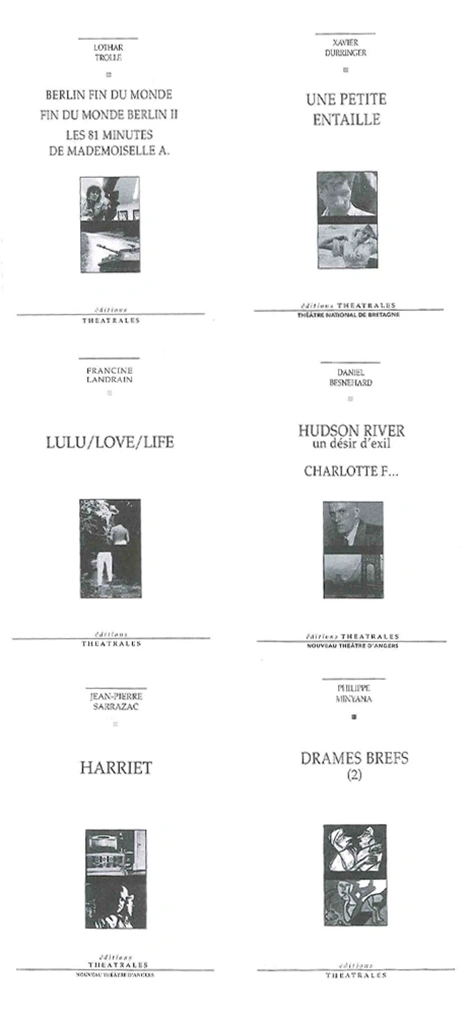
Comme tout éditeur, nous aspirons aussi à la découverte d’écritures de l’étranger, susceptibles de renouveler aussi bien la littérature que l’art théâtral. Après la période très sombre des années soixante, marquée par la désaffection des écrivains pour la scène, la publication régulière de dramaturgies issues d’autres pays contribue à proposer de nouvelles formes inédites. C’est ainsi que nous avons publié pour la première fois en France des auteurs hongrois (comme Peter Nadas dont le théâtre a été édité en 1988, avant les romans), irlandais (en 1996 avec Thomas Murphy ou Sebastian Barry), catalans (Sergi Belbel ou Benet i Jornet), anglais (James Stock ou Gregory Morton). La circulation des œuvres par delà les frontières culturelles, leur confrontation à des pratiques artistiques différentes, enrichit le présent et annonce le futur. À cet égard, nous portons une attention particulière aux exigences spécifiques de la traduction théâtrale, qui privilégient tout autant les caractéristiques de la langue parlée, de son écriture et de son oralité.
Et puis, comme l’affirme notre slogan commercial « le théâtre ça se lit aussi ! », nous tentons de privilégier la publication d’œuvres se prêtant à une lecture simple, dégagée des codes de lecture réservés aux seuls professionnels du théâtre, accessible à tous les amateurs, qu’ils soient passionnés de théâtre ou de littérature.
- La Ligue française de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, organisme fédérateur au plan national des fédérations départementales d’œuvres laïques, regroupe un grand nombre de compagnies théâtrales organisées sous un statut associatif 1901, amateurs ou professionnelles. Elle constitue, à l’époque, la première Fédération théâtrale qui, avec la FNCTA (Fédération nationale des Compagnies de Théâtre amateurs), rassemble la grosse majorité des pratiques de théâtre non institutionnelles en France. ↩︎
- LE COMPTE-RENDU D’ AVIGNON. Des mille maux donc souffre l’édition théâtrale et des trente-sept remèdes pour l’en soigner. Éditions Actes Sud. ↩︎

