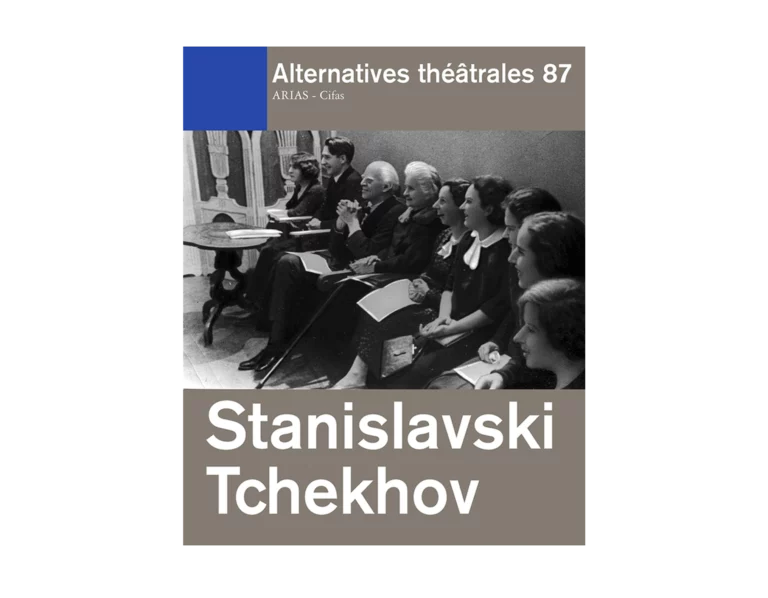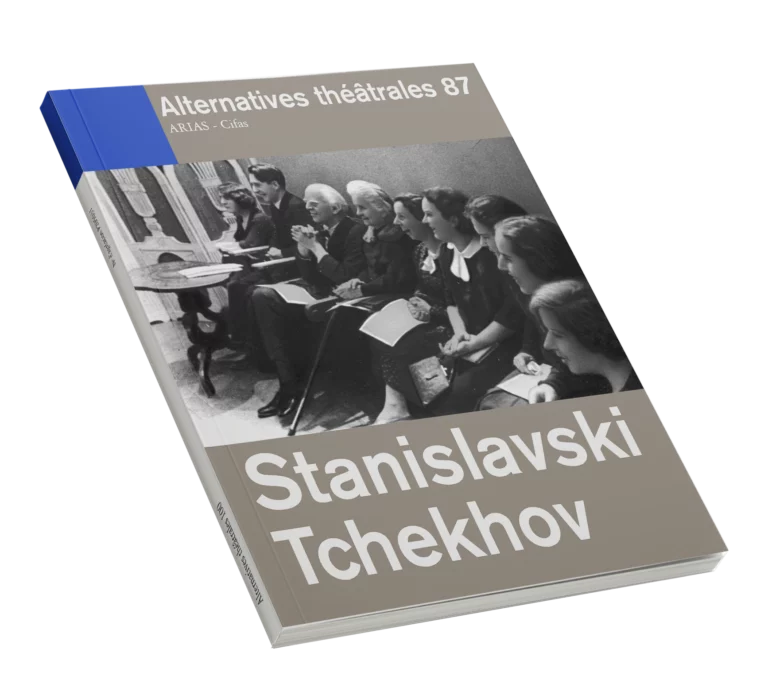LES ÉTUDES qui suivent sont le résultat d’une recherche présentée au Cifas (Centre international de formation en art du spectacle) à Bruxelles, le 7 mai 2005, dans le cadre d’un colloque organisé par ARIAS (Unité CNRS-Paris III-ENS)1 . Une première partie a été consacrée aux Studios du Théâtre d’Art, une seconde aux fondements, à l’évolution, et à la diffusion de ce Système.
Menées à partir de matériaux inédits ou analysés avec de nouveaux critères et des compléments d’informations historiques, les recherches ont porté sur la forme qu’a pris, à partir de 1905 – 1906, le projet stanislavskien d’associer théâtre et pédagogie. La fondation du premier Studio, à la lisière du Théâtre d’Art, a permis la mise en place et la mise à l’épreuve des concepts de base du Système. Ce collectif, cimenté et animé par le très charismatique Leopold Soulerjitski, disciple de Tolstoï, a montré, au fur et à mesure de son existence, les limites et les paradoxes inscrits dans la conception même de la communauté. La personnalité rayonnante de disciples fameux (Vakhtangov, Boleslavski, M. Tchekhov) a fait oublier d’autres membres moins brillants mais non moins importants dans la diffusion du Système au-delà des frontières de la Russie : c’est le cas de Valentin Smychliaev, élève doué et pédagogue enthousiaste, qui fit partie des équipes d’enseignants chargés d’initier au Système les artistes de théâtre des républiques soviétiques. Dans l’histoire du premier Studio, puis dans celle des Studios qui lui ont succédé (le second, le troisième, le Studio d’opéra dramatique), se trouve à l’état embryonnaire l’idée messianique d’un art exemplaire, enseigné par un maître relayé par des disciples, idée qui pourra nourrir soit un art ésotérique, fait pour les initiés, soit un art officiel, articulé autour d’une méthode unique de création.
On trouvera ici un certain nombre de jalons pour de futures études de la formation/ déformation et de l’évolution du Système, dont la diffusion a été chaotique et « idéologisée ». Chaotique : en témoigne l’enseignement du Système aux États-Unis par Boleslavski, un disciple d’origine polonaise, maîtrisant mal l’anglais et qui élabore sa propre version dans une série de conférences publiées sous le titre THE FIRST SIX LESSONS. Diffusion chaotique aussi car il n’existe à ce jour aucune étude sur la terminologie du Système, sur son évolution, notamment à travers les interprétations des élèves de Stanislavski (E. Vakhtangov, M. Tchekhov, mais aussi G. Khmara, V. Soloviova, Maria Knebel). Diffusion problématique, en outre, car l’on ne peut que s’étonner de la canonisation, dès le début des années trente, d’un Système jusque-là considéré comme « bourgeois » et « mystique », cette émergence rendant nulles et non avenues toutes les autres tentatives pédagogiques, en Russie puis, après la guerre, dans les zones sous contrôle soviétique. L’étude des fondements scientifiques des méthodes de formation de l’acteur, au Théâtre d’Art et ailleurs, permettra peut-être de comprendre le pourquoi de ce choix par les autorités culturelles 2.
- Qu’il me soit permis de remercier Alexis Berelowitch, directeur du Centre franco-russe en sciences sociales et humaines de Moscou, qui a pris en charge les missions des collègues russes, Jean-Loup Bourget, directeur d’ARIAS, qui a soutenu la publication des actes de ce colloque, et Georges Banu, qui a permis la réalisation de ce numéro. Sauf indication contraire, les photos proviennent du Musée du Théâtre d’Art de Moscou. ↩︎
- Sur la question du messianisme du Théâtre d’Art et de la diffusion de son enseignement en Europe et aux Etats-Unis, on se référera à l’ouvrage collectif : LE THÉÂTRE D’ART DE MOSCOU. RAMIFICATIONS, VOYAGES, sous la direction de M.-C. Autant-Mathieu, Patis, CNRS Éditions,2005 Certains intervenants au colloque ont participé à cette recherche. ↩︎