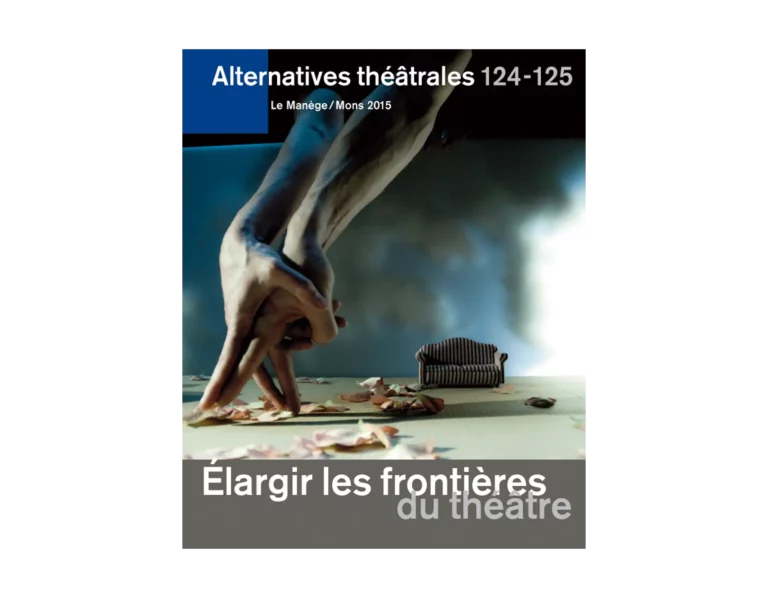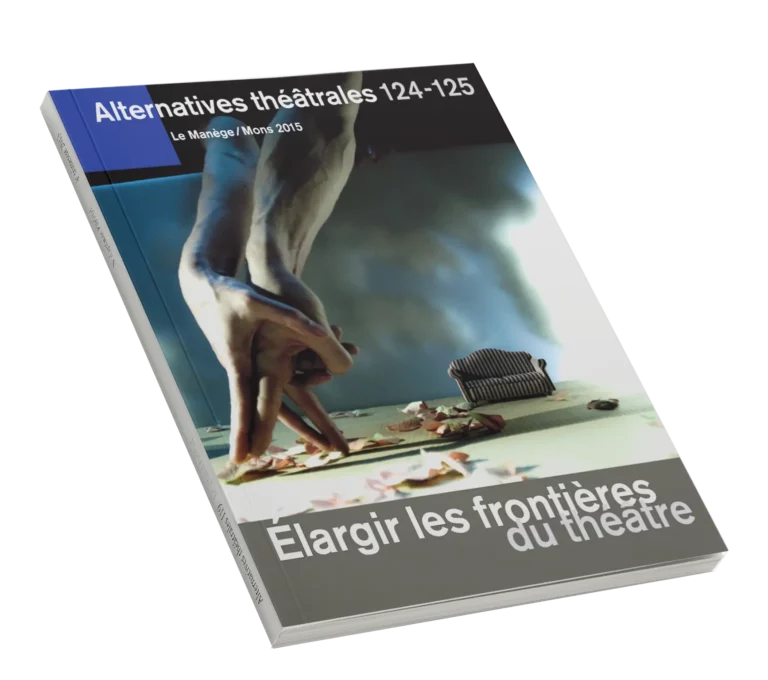« Au théâtre comme en poésie, on y entre par effraction. On y arrive brutalement pour qu’ensuite, tout d’un coup, on se demande : mais où était la porte ?»
Wajdi Mouawad
AUCUN AUTEUR n’aime être comparé à un autre car il se pense « incomparable ». Mais nous, en l’approchant, nous pouvons prendre une telle liberté car la découverte d’une parenté n’est qu’un acte d’interprétation critique. Un artiste éclaire un artiste, sans qu’il s’agisse pour autant de filiation, emprunt ou soupçon de mimétisme. Ils affirment ensemble un rapport proche au monde, à l’art, rapport qui se décline autrement, selon le temps ou l’espace, mais qui dégage tout de même une communauté d’identité. Dans ce sens je dirais que Wajdi Mouawad renvoie à Camus. L’un n’est pas réductible à l’autre, mais ils peuvent dialoguer : une humanité commune les relie sur fond de persistance méditerranéenne. Non pas de la mer, directement, mais de tout ce qu’elle a engendré comme conduites et intensités, comme aveux assumé et affirmation plénière de l’être. Dans Wajdi Mouawad résonne, comme un écho éloigné et proche, la voix de Camus. Et si l’on a aimé l’un on aimera l’autre.
Ce constat préalable est confirmé par le fait que les enthousiasmes qu’ils ont suscités ou les rejets qu’ils ont provoqués s’appuient sur des arguments similaires, comme si l’accueil fait à leur art confortait la proximité signalée ici. Dans le succès rencontré par Le théâtre de Wajdi Mouawad auprès des jeunes spectateurs je reconnais mes anciens engouements camusiens. Les deux appellent à la vie tout en dévoilant ses déchirures autant que ses puissances. L’acte d’écrire ou de mettre en scène prend, chez eux, le sens d’une relation lyrique avec le réel qui mène à un sursaut, à un dépassement de la douleur sans confort ni leurre. Ils assument la tragédie, mais refusent de s’y complaire, ils plongent dans l’abîme animés par une pulsion de salut contenue dans les mots et les gestes, dans les affects et les passions exacerbées qui par leur existence même refusent le constat de défaite. L’un comme l’autre la surmontent. C’est la conclusion d’un combat porté à l’incandescence au nom d’une confiance dans l’homme ou dans l’art à même de s’entraider pour résister au désastre. Cet optimisme foncier, nombreux sont ceux qui le leur reprochent, mais encore plus nombreux sont ceux qui s’en réclament.
Peinture et matière
Wajdi Mouawad en tant que metteur en scène aime la matière sur le plateau, mais il se distingue par un usage tout particulier. Elle n’intervient pas au nom de cette vocation polémique tant cultivée par bon nombre de metteurs en scène allemands — à l’exception, parfois, d’Ostermeier !— mais au nom de la volonté de placer la scène au carrefour du tableau et du plateau. La matière ici se distingue par son chromatisme spécifique et ses vertus plastiques. Le début de la Tétralogie d’Avignon n’en apportait-il pas la meilleure preuve grâce à l’immense toile blanche sur laquelle les acteurs se livraient ensemble à une sorte d’action painting démesurée. Couverts de peinture, ils déposaient leurs empreintes sur ce qui n’était que l’équivalent poétique d’un support plastique tendu tout au long du plateau : nous assistions, dans l’acte, à la naissance d’une œuvre, chaque soir, autre. L’improvisation et le geste plaçaient le théâtre sous l’emprise de la matière picturale. Ensuite, la toile, une fois enroulée, restait déposée à l’avant-scène comme un ex-voto inaugural de la représentation.
Et, par un effet presque de champ-contre champ, il suffit d’évoquer le final d’INCENDIES, non pas à Avignon, mais à Malakoff (les spectacles s’adaptent aux lieux et cela réclame, parfois, des sacrifices !). Final qui répond au début inoubliable dans la Cour du Palais des Papes. Cette fois-ci, la matière se chargeait d’inscrire progressivement sur une vaste plaque de verre les traces des drames et des vexations subies, véritable sismographe du parcours tragique dont les marqueurs étaient les couleurs d’épaisseurs et de brillances contrastées. Page géante, grimoire sur lequel ressortait le chemin des êtres inscrit directement sur ce verre- support. Le chemin, ensuite, s’effaçait sous l’effet des jets d’eau violemment dirigés contre la surface transparente. Nous avons été les témoins troublés de ces destins, témoins prêts à attester de la justesse de ces empreintes, mais le spectacle, à son terme, nous infligeait l’épreuve de leur disparition. Tout s’efface ! Pareille expérience théâtrale ne se vit que rarement dans la vie !
Dans Seuls, la matière, dans sa dimension picturale, intervient, avec une puissance égale. Le personnage narrateur s’enduit avec les pâtes et les huiles polychromes en se livrant à une performance plastique rehaussée par la puissance extrême des mots. Mettre en scène est pour Wajdi Mouawad un défi auquel la matière sert d’appui et de partenaire. Matière imprégnée d’implication psychique, matière à même de laisser une marque plastique. Les deux se rejoignent et sur la scène qui leur sert de creuset se noue un dialogue sous tension où l’on ne rejette ni la teinte intense ni le mot incandescent.
Mais la vision plastique de Mouawad déborde la question du cadre et la perspective : le plateau s’organise sur des critères plus anciens et Patrick Le Mauff, interprète d’un certain nombre des spectacles, et en même temps metteur en scène, fait ce constat : « la mise en scène moderne est articulée la plupart du temps sur la perspective qui a fleuri au moment de la Renaissance, perspective qui est toujours la nôtre.
Celle qui place le regard de l’homme au centre des Celle qui place le regard de l’homme au centre des représentations. Lorsque nous répétions FORÊTS, j’avais la sensation que Wajdi travaillait la représentation comme les peintres d’avant cette utilisation de la perspective moderne. Non pas en fonction de la règle d’or, avec des proportions précises et de justes lignes de fuite mais au contraire en fonction de la signification et des rapports entre les personnages, les histoires et les objets. Comme lorsque l’on voit, sur une peinture médiévale, dans une toute petite barque, de nombreux personnages, avec un château fort au milieu. La scénographie relevait d’un geste poétique étranger aux modes classiques d’organisation du tableau. »
Sur la scène de Mouawad la quête est fortement dirigée vers l’implication du spectateur. Et il n’y a de commentaire plus explicite que celui fourni par l’artiste lui-même : « Je veux tout faire pour ne pas produire de rupture dans le regard du spectateur, c’est-à-dire lui permettre ne pas avoir à revenir à sa raison. Quand le spectacle commence, il n’y a aucune rupture lumineuse créant par exemple un noir soudain pour changer un décor ou changer de scène. Mais il y a beaucoup de changements d’époques et de scènes, surtout dans FORÊTS. Un de mes grands défis quand je commence à travailler est de savoir comment je vais passer d’une scène à une autre sans que le spectateur se réveille. Le plus important est pour moi que le spectateur soit face à l’histoire qui se déroule devant lui comme devant un paysage qu’il regarderait à travers une vitre tellement transparente qu’il en oublie la vitre. Le travail de fluidité devient alors vraiment très important. Il ne doit pas y avoir de heurt. Je dois toujours mettre en place la scène suivante dans la scène précédente. De façon technique, je dois penser à être déjà en place quand la scène se termine pour que la scène qui suit puisse surgir sans rupture. Sans que je m’en rende compte, toutes les solutions que je trouve créent de l’image. Mais c’est bien après que je vois l’image. Et c’est alors que je commence à la structurer, à la mettre en place. C’est donc vers la fin que je commence à structurer l’image mais au départ je suis surtout préoccupé par une nécessité de fluidité et de transparence. Ce que j’aime au théâtre, ou devant une peinture, c’est d’être arraché à ma raison pour être précipité dans mes perceptions et mes sensations. C’est cela le but, l’angoisse même. Comment faire pour qu’il n’y ait pas de retour à l’intellect de façon trop prégnante ou trop régulière chez le spectateur. »
Un temps musical
C’est un fait connu, chez Mouawad l’écriture avance de pair avec la mise en scène, suivant une logique de tressage qui lui est propre. Et le spectacle, dans son organisation temporelle, préserve la dynamique de cette relation car l’auteur/metteur en scène exerce, avec minutie, un travail subtil de ralentissements et accélérations en prenant soin d’organiser une structure musicale. Rien de plus contraire à ces spectacles que le déroulement étale ou la précipitation compulsive, car Mouawad pratique un savant jeu de tempi qui animent la durée et construisent une véritable figure sonore, équivalent sensible des agitations dont la fable apporte le témoignage.
![Wajdi Mouawad dans AJAX [CABARET], d'après AJAx de Sophocle, deuxième partie du volet DES HÉROS, mise en scène Wajdi Mouawad, 2014. Photo Pascal Gély.](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2015/01/AT124-125-42_11zon-1024x730.webp)
![Wajdi Mouawad dans AJAX [CABARET], d'après AJAx de Sophocle, deuxième partie du volet DES HÉROS, mise en scène Wajdi Mouawad, 2014. Photo Pascal Gély.](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2015/01/AT124-125-42_11zon-768x547.webp)