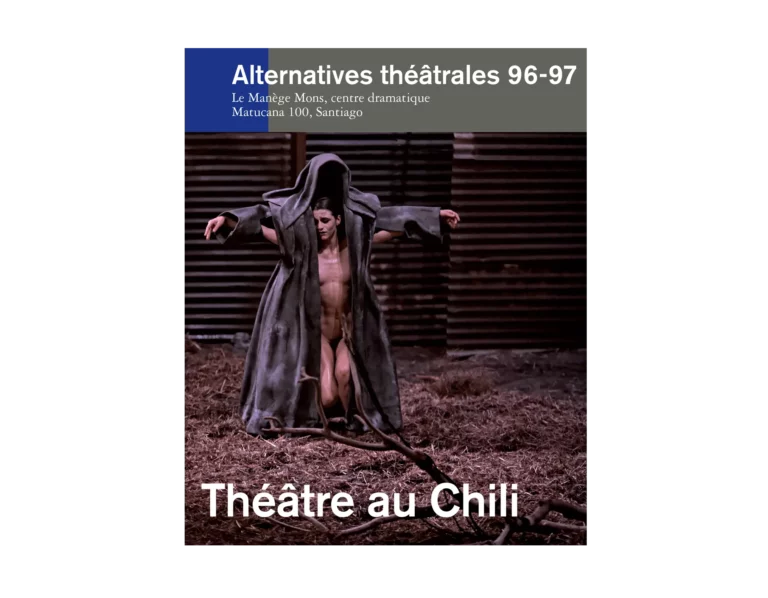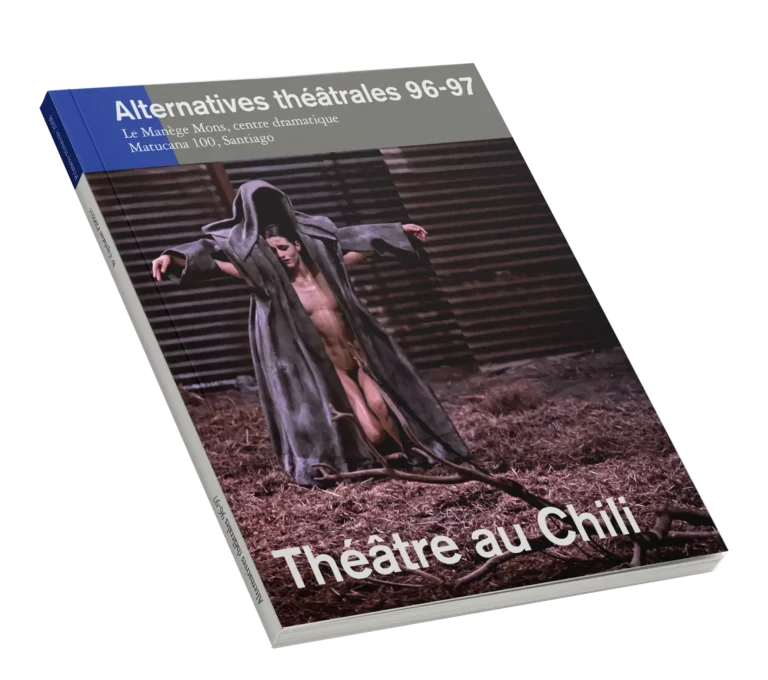UNE DES CHORÉGRAPHES chiliennes les plus reconnues de danse contemporaine revisite le parcours qu’a suivi sa discipline, au Chili, depuis les années 80, période pendant laquelle elle a mûri un langage qui interroge constamment l’usage du corps, la technique, l’espace et le temps sur la scène.
Malgré l’intérêt et la reconnaissance dont ses choré- graphies font l’objet depuis la fin des années 90, Elizabeth Rodrfguez a été contrainte de limiter sa dernière saison de travail à douze représentations seulement.
Non pas par manque de public, mais par le manque de disponibilité de la salle de l’Université Mayor, où les rares montages de danse indépendante doivent alterner avec le foisonnement de productions théâtrales qui sont à l’affiche à Santiago.
Cette situation est caractéristique de l’état dans lequel se trouve la discipline au Chili : l’obligation de s’adapter à des conditions pas toujours propices, et de profiter des espaces libres dans une programmation surchargée.
Comme la plupart des autres chorégraphes actifs dans le pays, pour les répétitions du spectacle Elizabeth Rodrfguez est tributaire de son agenda de cours dans les écoles de théâtre et de danse et, tout comme ses pairs, elle finance ses productions avec les apports des fonds de l’État auxquels tous concourent annuellement.
Ces heures de travail volées à la nuit, et l’engagement fraternel de cinq interprètes ont favorisé ses recherches sur le langage de la danse grâce auxquelles elle jouit d’une grande reconnaissance. Ces recherches se sont cristallisées dans un spectacle envoûtant : CUANDO BAILO, BAILO ; CUANDO DUERMO, DUERMO(Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors). L’imposante structure de la scénographie du spectacle est entreposée dans une cave après une « mini-saison » et, comme à ses débuts, Elizabeth Rodríguez se demande de quelle façon continuer.
Faute d’un gestionnaire au sang-froid (figure rare dans la danse indépendante chilienne), elle n’a pas encore décidé de reprendre le spectacle, d’organiser une tournée en dehors de la capitale ou de tout repousser jusqu’à nouvel ordre. Elle se prend à douter, même quand elle pense au public majoritairement jeune qui a rempli la salle les douze représentations, ou aux spectateurs potentiels qui lui ont manifesté leur intérêt pour cette réalisation.
La ténacité dont elle a fait preuve durant deux décennies est vraiment remarquable, mais ni les applau- dissements ni les critiques favorables qu’elle a reçus n’adoucissent sa frustration.
« Dans les années 80, la pression mercantile d’aujourd’hui n’existait pas », analyse-t-elle. « Actuel- lement tout se conceptualise et se traduit en coût économique. Tu peux disposer d’un espace ou d’une salle à partir du moment où tu peux en payer la location. »
Elizabeth Rodríguez appartient à cette génération de directeurs de danse contemporaine en vogue, qui, pendant la décennie 80, se sont formés, avec la dictature militaire en toile de fond et une motivation marquée par la possibilité de récupérer des marges de liberté pour la création.
« Aujourd’hui, si tu veux des ressources pour monter un projet, tu dois concourir au Fondart (Fond National de Développement Culturel et des Arts, dépendant du Ministère de la Culture) et programmer les répétitions le soir, parce que tout le monde, danseurs et chorégraphes, donne dix mille cours par semaine pour gagner sa vie. Ensuite tu organises la première, tu présentes huit ou douze représentations et le processus est terminé ».
Javier Ibacache : Le système chilien n’est-il pas enclin à soutenir des recherches ou des compagnies dans le temps ?
Elizabeth Rodriguez : L’État organise des concours, mais, dans la pratique, tout reste livré aux lois du marché. Il y a là un risque, alors qu’il est nécessaire de promouvoir la constitution de compagnies à long terme. Maintenant on donne des ressources aux soi-disant projets Bicentenaires (le Chili célèbre 200 ans de son indépendance en 2010) et personne ne s’intéresse à savoir combien nous sommes, où nous sommes et sur quoi nous voulons porter notre interêt, nous, les promoteurs de la danse.
J. I.: Malgré cela, peut-on parler d’un mouvement de danse indépendant ?
E. R.: Je crois que nous ne sommes pas encore un mouvement. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais il faut encore renforcer les étapes du processus que doit suivre toute création de danse. Ce n’est qu’à partir du moment où il y a continuité et permanence de la recherche, de la critique et de la diffusion, qu’on peut parler de mouvement. Les conditions sont juste en train de se mettre en place. Il existe davantage d’écoles de danse que dans les années 80. Mais un travail de longue haleine reste à faire.
Entre Graham et la restauration
On peut suivre l’évolution de la danse au Chili en suivant la carrière d’Elizabeth Rodríguez.
Pendant la première partie des années 80, elle alterna ses études d’ingénieur Informatique avec des classes informelles de danse, comme c’était le cas de beaucoup d’interprètes professionnels et amateurs de l’époque.
« Ma connexion avec le milieu était mince. J’avais l’habitude d’aller au théâtre Ictus où on trouvait tout un mouvement artistique de résistance. Mais la danse de ce temps-là était quasi inexistante dans ce pays. Les gens travaillaient tous dans leur coin. Invitée par ma sœur, je me suis inscrite par curiosité à des cours de danse pour maigrir … ».
Les universités contrôlées par les militaires et les compagnies établies, comme le Ballet de Santiago, tournant au ralenti, les espaces d’expression étaient devenus limités et précaires. Les cours qu’elle suivait, après ses études d’ingénieur, dans une salle située en plein centre-ville, l’ont initiée avec rigueur à la technique de Martha Graham.
Le contexte était très dur : se former aux techniques de la danse alors que dehors se déployait la répression policière et que sévissait une sévère dépression écono- mique. « C’était un groupe hétérogène et des choses incroyables arrivaient. Des employés de bureau y participaient de la même manière que des danseurs professionnels possédant une grande connaissance technique. On voyait en eux cette énorme passion pour l’activité, ça m’a captivée. »
L’isolement que vivait le pays se compensait par de la rigueur. « On parlait d’une tradition et d’un langage perdus. C’est pour cela que nous passions notre temps à regarder et étudier, encore et encore, les vidéos de Martha Graham, sa technique et les exigences physiques qu’elle imposait. »
En terminant ses études, Elizabeth Rodrfguez transforma son loisir en travail, et elle s’engagea bientôt dans la scène underground qu’on retrouvait dans le quartier de San Diego.
« Je ne pensais pas me consacrer à la danse, mais je ne manquais aucun cours et j’ai rejoint un monde souterrain impressionnant. J’ai commencé à m’émerveiller et à tomber amoureuse de la danse. Mais m’y consacrer entièrement était impossible parce que je savais que je devrais pour cela prendre un chemin plus formel : l’École de Danse de l’Université du Chili ou encore celui de l’École de Ballet du Théâtre Municipal. Et je sentais que c’était déjà trop tard pour moi. »
Ses études universitaires terminées au milieu des années 80, elle rencontre Patricio Bunster, chorégraphe célèbre, associé à l’administration de Salvador Allende qui, à ce moment-là, rentrait d’exil avec l’intention de relancer un mouvement de danse à vocation ouvertement sociale.
« Je me suis dit pourquoi ne pas essayer, et j’ai commencé à me former avec lui, ce qui signifiait répéter et se présenter immédiatement dans les quartiers populaires, ou durant les manifestations politiques. C’était un groupe de gens incroyables, leur énergie faisait vibrer. Mais j’ai commencé à me sentir prise au piège » …
Son dilemme était celui d’une nouvelle génération d’artistes qui se débattait entre le chemin de l’expérimentation propre et l’engagement dans la lutte contre la dictature.
L’activité se déroulait au Café del Cerro, un centre légendaire de réunion au sein d’un quartier bohème de Santiago, Bellavista, où circulaient musiciens, auteurs compositeurs, comédiens et danseurs. « J’y passais toute la journée, en ateliers de huit heures du matin à minuit. On travaillait essentiellement la technique Leeder, bien que les tenants d’autres styles s’y trouvaient aussi. »
C’est dans ce contexte qu’elle rencontra ceux qui deviendraient les premiers chorégraphes de danse indépendante de la nouvelle génération : Nelson Avilés et Nuri Gutes (initiateurs de la compagnie Andanzas), et bien d’autres. « Je me rappelle avoir dansé avec Luis Eduardo Araneda devant cinq mille personnes en silence dans le Estadio Chile, accompagnant un acte politique, pendant que la police attendait dehors. Il est indéniable que des expériences comme celles-ci te marquent et te font mûrir. »
L’intérêt pour doter les spectacles de contenu social a contrasté avec le mouvement émergent, plus enclin à la recherche de langages, et le groupe de jeunes chorégraphes prit de la distance par rapport à Patricio Bunster, qui à son tour avait formé l’École de Danse Espiral.
« Beaucoup d’entre nous avons eu, au début, un double militantisme, puis d’autres ont abandonné l’École Espiral ». Elizabeth Rodrfguez gagna son autonomie en tant qu’interprète de la compagnie Andanzas, mais « d’autres regards sont apparus et nous nous sommes rendu compte que la danse pouvait couvrir d’autres domaines. Mais je ne suis pas partie immédiatement vers les directeurs indépendants, parce que je sentais encore le besoin de mieux me former ».