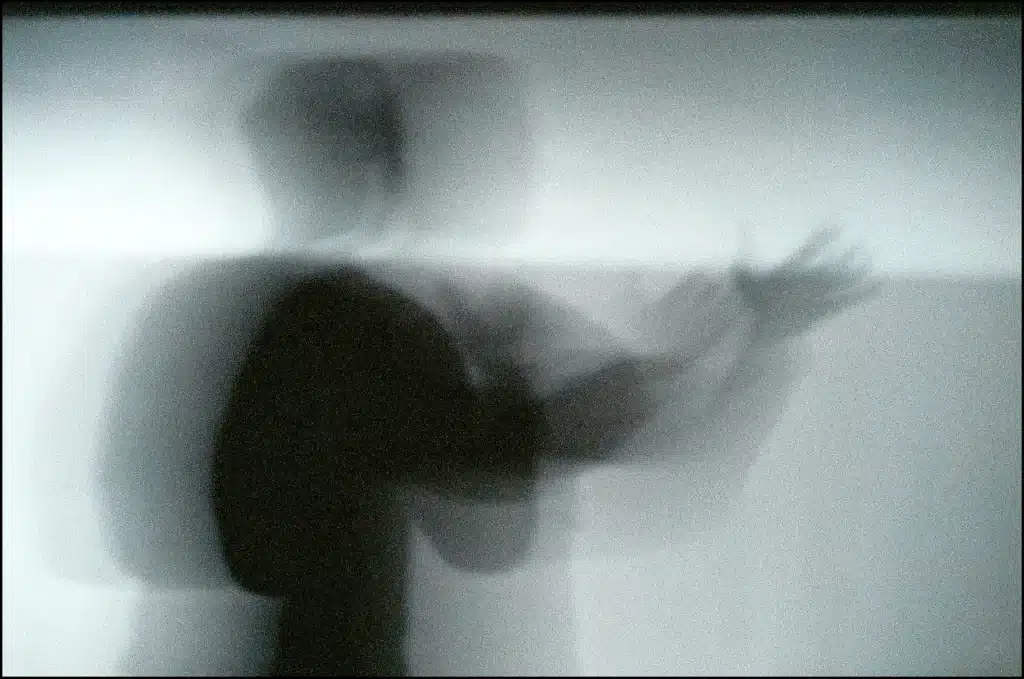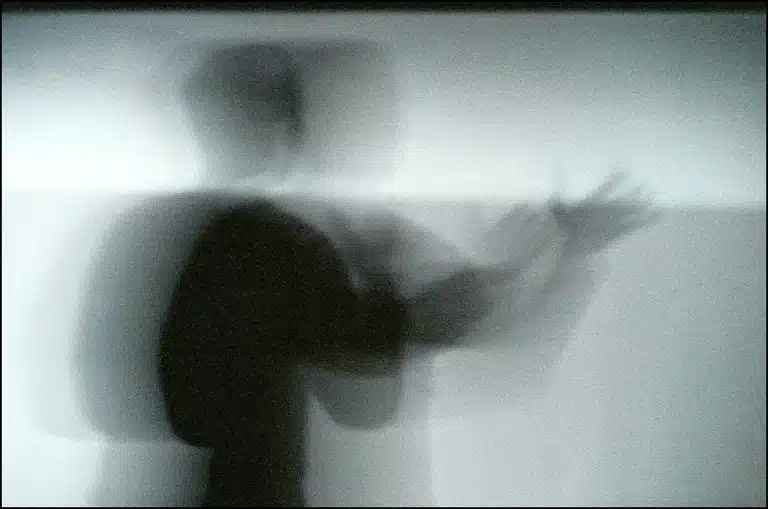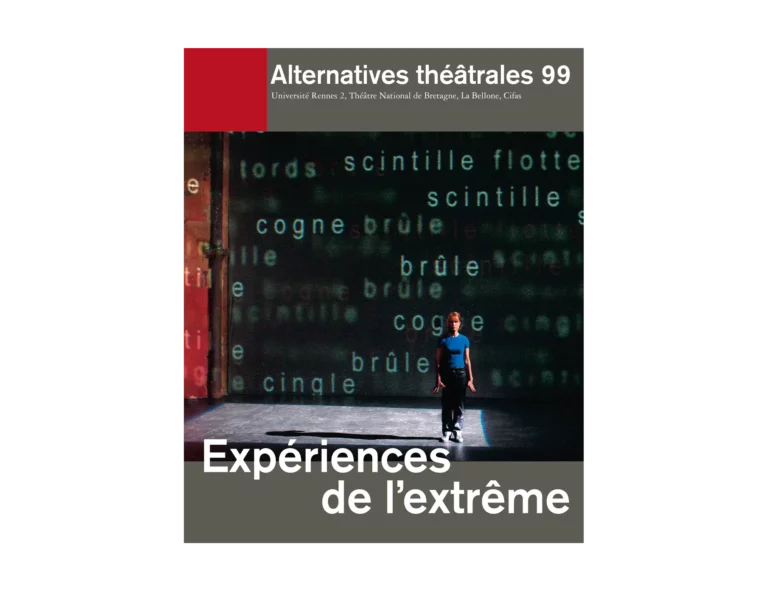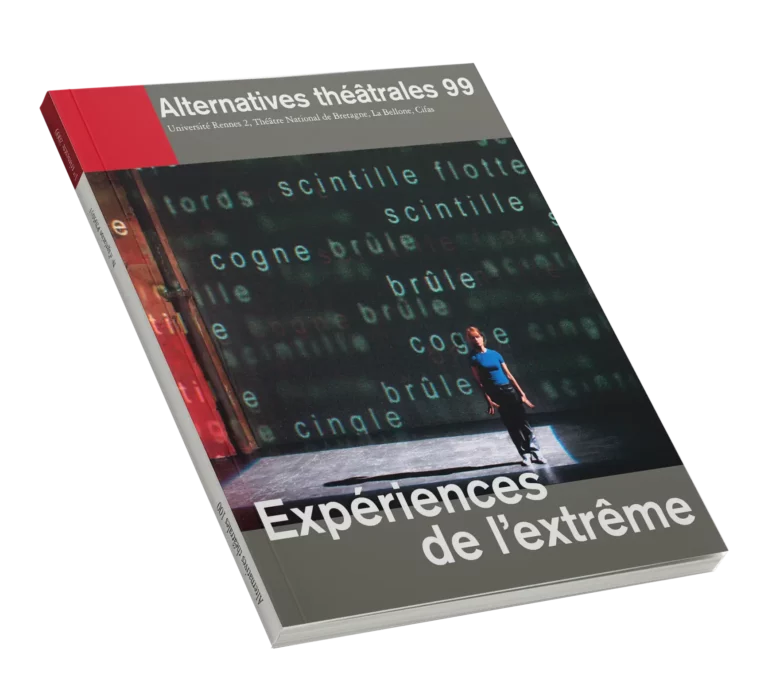On a beaucoup parlé, à mon sujet, d’invisible. Je voudrais commencer par démythifier l’idée d’invisible. Un texte de Merleau-Ponty qui m’a beaucoup frappé dit que l’invisible fait partie de l’acte de perception, parce que nous ne pouvons jamais voir un objet dans toutes ses perspectives. Nous imaginons ce que nous ne voyons pas à partir de la mémoire. Dans la perception interviennent donc déjà la mémoire et l’imagination, c’est-à-dire les deux forces qui nous animent dans n’importe quel acte artistique.
Artaud disait quelque chose qui me paraît très important : si le théâtre n’est pas au moins aussi violent que ce qui se passe dans le monde où nous vivons, alors il ne remplit pas son office. Or, nous vivons dans un monde qui a connu les camps de concentration, Hiroshima, les bombes au napalm ; un monde qui connaît de nos jours le terrorisme et la guerre sans discontinuer, qui laisse impunément se poursuivre les génocides africains. Et on continue à vivre dans l’illusion du progrès, dans le look et le fun ! Pendant ce temps, des charniers continuent à pourrir et d’autres tout neufs sont en train de se creuser.
— D’une part, la mort est présente partout : dans l’histoire et dans notre vie. C’est une réalité violente, omniprésente. Il est de première nécessité de faire vivre la mort sur le théâtre, puisqu’elle vit constamment autour de nous dans l’histoire que les hommes politiques nous fabriquent, et qu’elle vit aussi constamment en nous. Elle est de naissance.
— D’autre part, les progrès accomplis dans le traitement des morts aboutissent à les effacer. J’ai apporté un texte de Jean Baudrillard à ce sujet :
« Il y a une exclusion qui précède toutes les autres, plus radicale que celle des fous, des enfants, des races inférieures ; une exclusion qui précède toutes les autres et leur sert de modèle, qui est à la base même de la “rationalité” de notre culture : c’est celle des morts et de la mort. Car il n’est pas normal d’être mort aujourd’hui, et ceci est nouveau. Être mort est une anomalie impensable ; toutes les autres sont inoffensives au regard de celle-là. La mort est une délinquance, une déviance incurable. Plus de lieu ni d’espace-temps affecté aux morts ; leur séjour est introuvable : les voilà rejetés dans l’utopie radicale — même plus parqués : volatilisés. »1
Voilà donc deux raisons pour qu’on s’occupe de ce sujet : d’une part la violence de la mort dans ce qui se passe autour de nous, et d’autre part cette tendance à supprimer la mort, à la rendre invisible.
J’ajoute quelque chose que j’ai découvert au cours de mon travail et qui l’a gouverné, mais qui m’a aussi été confirmé par la lecture de Baudrillard : la réunion des contraires. Baudrillard dit que le pouvoir se sert de la séparation des contraires ; il s’introduit dans l’espace ainsi créé. Par exemple, l’Église sépare la vie de la mort pour terroriser les fidèles par la peur de la mort. Réunir les contraires — esprit/corps, masculin/féminin, bien/mal, vie/mort — s’avère finalement être l’acte le plus absolument subversif. Ce qui m’intéresse, c’est de montrer la mort dans la vie, de montrer que dans toute existence est une part d’inexistence. C’est pourquoi, à la question de Shakespeare : “Être ou ne pas être”, j’ai substitué l’expression d’une difficulté : “Être et ne pas être en même temps.” Je crois que cette façon de chercher à rendre des contraires concomitants est une révolution, parce que justement elle concerne l’opposition du corps et de l’esprit, du masculin et du féminin, de la vie et de la mort, et toutes les autres. À partir du moment où l’on essaye de faire vivre ensemble ces contraires, on obtient peut-être la photographie ou le scanner d’une vérité de l’Être — si toutefois la vérité existe, ce que je ne crois pas.
Jon Fosse a une façon particulière de se situer à la bordure de la vie et de la mort, voire de les mêler, en particulier dans Je suis le vent, la pièce que je prépare en ce moment. Dans cette pièce exemplaire de la coexistence de la vie et de la mort, les images de la mort sont extrêmement riches et la mort est plutôt montrée comme une espèce de dispersion, voire de dissolution dans les éléments du monde physique : l’eau, le brouillard, le vent.
Entretien avec Didier Plassard, Monique Borie, Élisabeth Angel-Perez et Carole Guidicelli
Didier Plassard : Pourriez-vous nous parler un peu plus de ce texte ?
Claude Régy : C’est une œuvre assez étrange. Plus que sur l’invisible, c’est une pièce sur l’idée de ne pas avoir peur de se confronter à l’indéfinissable, aux choses qu’on ne peut pas concevoir et pour lesquelles il n’y a pas d’explication ni même de vocabulaire. Le point de départ est assez simple : deux hommes sont sur un bateau. L’un des deux a l’air de connaître la navigation et l’autre pas du tout. On se rend compte, par petites touches presque invisibles et répétitives, que celui qui est connaisseur en navigation a probablement fait une tentative de suicide. Peut-être même s’est-il déjà mort noyé. Il dit qu’il ne peut pas être avec les autres, qu’il n’aime pas le bruit et que les mots n’ont pas de sens pour lui. Mais il ne veut pas être seul non plus, car être seul avec soi-même est évidemment insupportable. De plus, cela se traduit chez lui, quand il est seul en mer, par une envie irrésistible de se jeter à l’eau. Sans doute l’a‑t-il déjà fait. Les deux hommes naviguent de crique en crique, ils jettent l’ancre, mangent et boivent un peu, et puis ils s’avancent un peu trop en pleine mer. Celui qui ne sait pas naviguer commence à s’inquiéter, d’autant plus qu’il y a du brouillard et que le vent se lève. Mais l’autre fonce de plus en plus droit vers le large, puis il quitte la barre et, soit à la suite d’un faux pas, soit par un saut volontaire, il tombe à l’eau. Mais à partir de là, il continue à parler et dit qu’il flotte. Auparavant, il avait dit que parfois il était une pierre qui tombait au fond et restait là immobile. À d’autres moments, il dit : « Je suis le vent » (c’est le titre de la pièce). Alors qu’il est dans l’eau et continue à dériver, plus ou moins enseveli par les vagues ou à leur surface, il semble se diluer dans l’élément liquide, et en même temps il est pris dans le vent jusqu’à s’identifier à lui.
On a l’impression que les deux personnages n’en sont qu’un. Et de toute façon, tout est imaginaire. Celui qui reste sur le bateau réussit à coincer la barre et à regagner le phare, c’est-à-dire à revenir au point de départ ; c’est le contraire de l’aventure et de l’inconnu. L’autre, ouvert sur l’inconnu, rejoint les éléments par la dilution de son corps, comme si celui-ci pouvait connaître une mutation qui permettrait qu’il n’y ait pas de frontière entre la pierre, le vent, l’eau et l’homme. L’eau — grande étendue liquide — depuis toujours est mort et vie.
Il s’agit donc pour moi de faire vivre la mort dans la vie, tant la vie sociale que la vie intérieure. Les morts nous habitent : ils ne meurent pas, mais continuent à vivre avec nous et à avoir une influence sur nous qui n’est pas représentable. Qui peut dire qu’il ne l’a pas ressenti ? Cela mène presque à l’anthropophagie qui, sous une forme sacrée, peut être le plus magnifique ensevelissement. C’est-à-dire que les morts sont une nourriture pour les vivants. Ils survivent à travers les vivants qu’ils habitent, qu’ils nourrissent. C’est une symbolique très ancienne et tout à fait remarquable, qui correspond peut-être à une nécessité : les nomades doivent trouver un moyen d’emporter leurs morts avec eux. La seule solution est de les manger, de les partager à l’intérieur du groupe social en perpétuel déplacement. C’est d’une beauté absolue.
Il y a un auteur que je voudrais réhabiliter — elle a subi beaucoup d’insultes — c’est Sarah Kane. Une de ses pièces tout à fait saisissantes, Purifiés, fait agir la concomitance de la vie et de la mort à travers le personnage du frère. La figure principale, une jeune femme, perd son frère qui meurt d’overdose au début de la pièce, mais ce frère revient très vite et cohabite avec les vivants sans différence. Quand il parle, d’autres personnages ouvrent la bouche en même temps, ce qui fait qu’on ne sait pas qui parle. C’est une façon de phagocyter la vie : ce mort qui se met à l’intérieur des vivants et qui parle par la bouche des autres. Là encore, intimement, la vie et la mort sont liées. Sarah Kane a écrit cette pièce pour parler des camps de concentration, qui sont bien un théâtre de la mort, avec des morts-vivants, presque des mannequins de cire, au plus près du cadavre. Elle parle évidemment des nazis quand elle dit : « Ils peuvent t’ôter la vie sans te donner la mort. » Les camps de concentration sont l’exemple limite de cette façon d’ôter la vie alors que les gens respirent encore, peuvent encore tenir debout, bouger et encore vaguement travailler, même si on les prive de sommeil et de nourriture, même si on les pousse à un désespoir vital absolu. Et pourtant, ils vivent, jusqu’au moment où l’on franchit la fragile frontière de l’extinction totale.
Il est très important de souligner la révolution de l’œuvre de Sarah Kane par rapport au théâtre, mais aussi celle qu’elle opère à l’intérieur même de son propre parcours. Purifiés, la troisième de ses cinq pièces, est la dernière où elle a écrit des images violentes : on coupe les mains et les pieds à un homosexuel qu’on empale ensuite de l’anus jusqu’au cou sans toucher un seul organe vital. Mais dans Manque et 4.48 Psychose, ses deux dernières pièces, Sarah Kane a dit qu’elle ne voulait plus de ces images violentes et, d’une certaine façon, racoleuses, pour que désormais ce soit le texte qui crée les images. Cette faculté de faire confiance au texte comme élément dramatique principal et créateur d’images instaure une révolution qui rappelle celle de Duras et de L’Amante anglaise. C’est évidemment sur cette théâtralité inhérente au langage (que théorise Meschonnic) que j’ai principalement travaillé, toutes ces dernières années.
La mort est une chose vivante, non seulement vivante, mais extraordinairement violente. Elle est présente dans notre environnement et en nous-mêmes. Ne pas en parler, c’est une aberration, c’est castrer les êtres humains de neuf dixièmes de leur être. On sait, par exemple, que 95 % de l’univers est invisible et qu’on ne connaît pas la composition de cette matière. On sait seulement qu’elle n’est pas faite d’atomes. Il est donc peut-être aussi pensable qu’il y ait 95 % de l’humain qu’on ignore totalement. On ne peut pas dire non plus que c’est une partie morte, mais on ne la connaît pas. Pourtant, il n’y a pas de raison de ne pas s’occuper de ce qu’on ne connaît pas, de ce qu’on ne peut pas percevoir, et même de ce dont on ne peut pas parler, disent les astrophysiciens. Cette conception m’a beaucoup aidé pour franchir les frontières — je ne dirais pas de l’invisible, mais du possible.
Monique Borie : J’ai été particulièrement frappée par le fait qu’en choisissant pour titre d’un de vos livres L’État d’incertitude, vous faites l’apologie du doute, et du doute, si j’ai bien compris, sur la nature du réel qui nous est donné à voir. Dans Mélancholia de Fosse, un texte très important pour vous, il y a deux personnages : l’écrivain (le douteur, en quelque sorte) et le peintre qui, lui, est dans l’expérience de la folie, mais qui dit : « Je vois ce que les autres ne voient pas. »
Claude Régy : C’est ce que disait aussi Edvard Munch : « Je peins avec mon œil intérieur. » Où est l’œil intérieur ? On en a tous un, mais comment le trouver ?
Monique Borie : La question que je voulais vous poser porte sur l’association, dans votre travail, d’un voir au-delà et d’une incertitude. Il me semble que cette association porte sur la nécessité d’étendre nos moyens de perception : voir ce qui n’est pas montré, entendre ce qui n’est pas audible. C’est un voir au-delà, me semble-t-il, mais marqué du signe de l’incertitude et du doute.
Claude Régy : On y est bien obligé. Dans la poésie ou dans la pensée, il faut accepter de se mouvoir dans l’inconnu. Meschonnic dit que la pensée commence quand on se met à penser quelque chose qui n’a pas été déjà pensé. Rares sont ceux qui le font ! Je ne prétends d’ailleurs pas être de ceux-là, car je me sers beaucoup de la pensée des autres. L’essence de la création, c’est de franchir des frontières et de commencer à s’engager sur des territoires inconnus. C’est pourquoi je suis toujours un peu sceptique sur le théâtre politique, parce que pour faire du théâtre politique, on est forcé de rester dans le connu. On perd cette possibilité de franchir des frontières interdites. Blanchot disait : « La réponse est l’ennemie de la question. » Je partage tout à fait ce point de vue. C’est pourquoi je ne donne aucune réponse, car toute réponse est forcément univoque et limitative. Je préfère poser des questions. En se posant des questions, on répond aussi à quelque chose, d’une certaine façon.
Ce que je dis souvent, c’est que j’essaye de changer les seuils de perception : par des ombres et des lumières très basses, ou au contraire extrêmement surexposées et violentes, comme il y en avait dans 4.48 Psychose, en faisant jouer des tons qui vont du sur-bas au sur-crié.
On constate alors que les gens sont habitués à certains seuils. Quand je fais parler les acteurs très bas, on vient toujours me dire : « Monsieur, vos acteurs, on ne les entend pas. Il faut les faire parler plus fort. » Mais ce n’est pas vrai, puisque les trois quarts de la salle les entendent. Si on ne les entend pas, c’est parce qu’au théâtre on est habitué à ce qu’on profère le texte avec une force théâtralisée ; au nom de cela, les tons sont d’une extériorité redoutablement vide.
Même si les seuils sont plus sensibles pour la vue et l’ouïe, je pense qu’on peut aussi faire varier les seuils de ce qu’on peut appréhender, on pourrait presque dire les seuils de ce qu’on peut comprendre, et d’essayer ainsi d’aller où on ne va pas d’habitude. Faire entendre ce qu’on n’entend généralement pas. Meschonnic a une excellente formule : « On entend aussi ce qu’on ne sait pas qu’on entend. »
C’est un guide très important pour moi par rapport aux spectateurs. Parce qu’on parle d’une pièce, on croit qu’on a compris ce qu’elle voulait dire, mais c’est faux. On ne se rend pas compte qu’en entendant un texte et en voyant un spectacle, de très nombreux éléments nous parviennent sans que l’on en ait conscience.
Blanchot se référait à une compréhension subliminale des œuvres, en deçà de la conscience. Ce qu’on perçoit sans en avoir conscience et qu’on n’analyse pas, fait pourtant son chemin en nous et se développe pour nourrir au final notre personne.
Monique Borie : Vous avez une formule que je trouve magnifique au sujet de la lumière, vous dites : « Il est de sa nature de conduire au-delà des limites… »
Claude Régy : La lumière a cette faculté de changer la nature de l’être humain. J’en ai fait l’expérience dans Mélancholia : quand l’acteur entrait dans la boîte blanche suréclairée qui constituait l’essentiel du dispositif scénique, sa nature d’être humain était différente. Et quand il repassait dans l’autre zone, qui était une zone sombre, sa nature était autre Montrer que la lumière peut changer la nature de l’être, c’est déjà très important. Mais il faut montrer aussi qu’un être humain peut en être plusieurs, successivement ou en même temps ; malheureusement ou heureusement cela se rapproche beaucoup des problèmes de schizophrénie, c’est-à-dire quand on ne fait plus de différence entre le réel et une réalité imaginaire ni, comme disait Sarah Kane, entre moi et cette table ou entre moi et vous.
Cette absence totale de frontières est magnifique, c’est un terrain d’expérimentation passionnant, mais en même temps, c’est le chemin de la folie. Mélancholia prouvait, si c’était à prouver, que la création artistique est extraordinairement proche de la folie, et d’ailleurs beaucoup d’artistes ont côtoyé la folie et ont fini par le suicide, pour ne parler que de Van Gogh, par exemple.
Élisabeth Angel-Perez : Je vous ai entendu avec surprise parler du théâtre politique en disant que vous vous en méfiez parce qu’il reste dans le connu. Pourtant Sarah Kane est aussi quelqu’un qu’on lit et que vous lisez comme un auteur politique précisément parce qu’il n’y a plus dans son œuvre de distinction entre le politique et l’intime. C’est un auteur qui arrive à intérioriser la dimension politique (cette dimension schizophrène dont vous parliez) et qui la traite au niveau de l’intime.
Claude Régy : La pièce Purifiés est exemplaire parce que Sarah Kane a voulu traiter des camps de concentration, mais elle l’a subtilement placée dans une université : campus, bâtiments, baraquements, camps, on n’est pas loin ; et le médecin, dans cette université, est celui qui tranche des pieds, des mains, des sexes et qui pratique le pal, donc il ressemble tout à fait à un tortionnaire de camp de concentration.
Cela dit, j’ai monté Holocauste, un texte réécrit par un poète américain d’après les témoignages du procès de Nuremberg et du procès d’Eichmann, où il y avait une très légère intervention de l’écriture. Mais Charles Reznikoff n’est jamais intervenu pour modifier l’essence même du texte ni pour interférer avec une pensée explicative ou avec un sentiment de quelque ordre qu’il soit. Dans 4.48 Psychose, Sarah Kane écrit sur son suicide encore à venir. C’est comme un attentat-suicide. Elle unit en effet l’intime et le politique.
Carole Guidicelli : Pouvez-vous parler de la façon dont vous avez abordé ce texte, Holocauste, avec le choix d’une quasi-immobilité comme dans 4.48 Psychose ? Quelle démarche avez-vous suivie ?