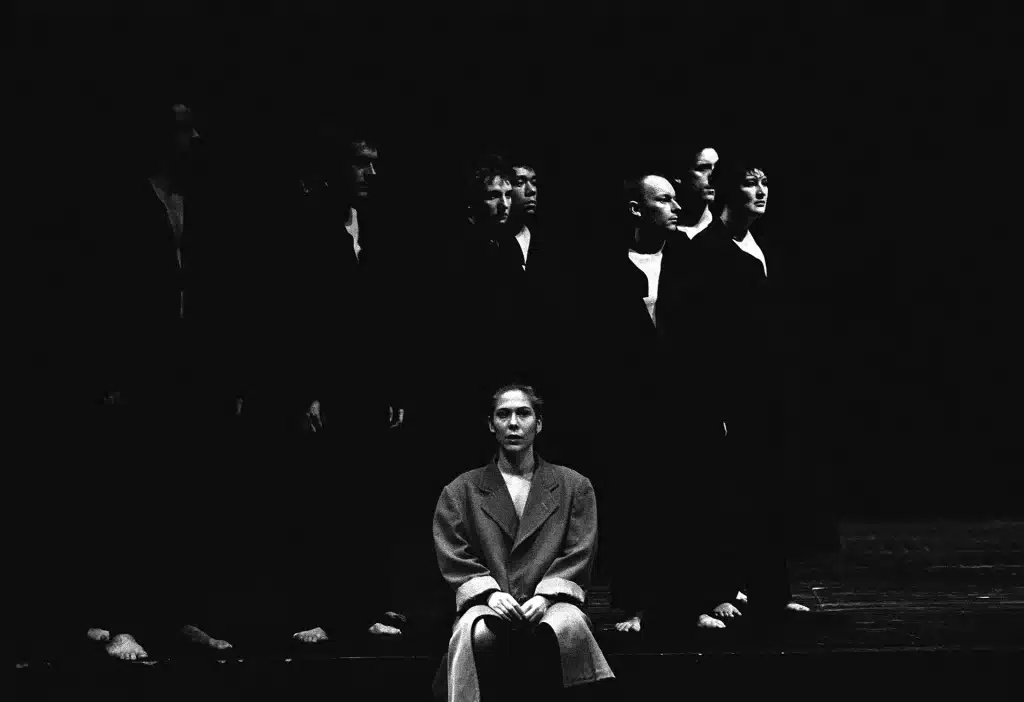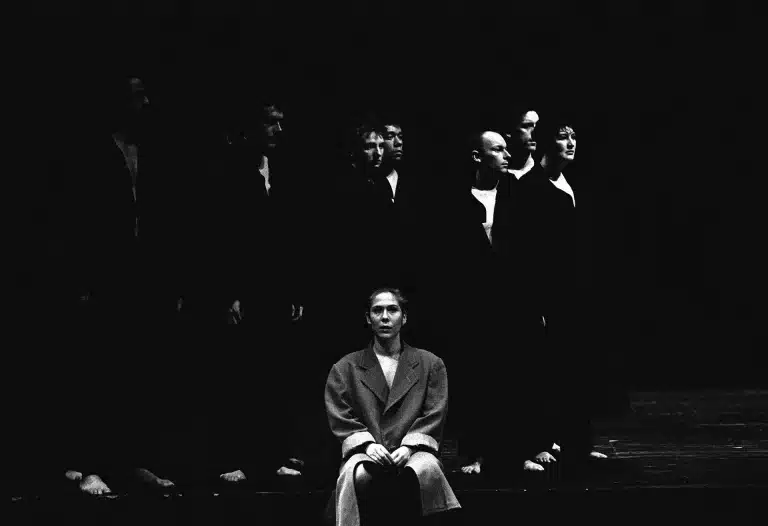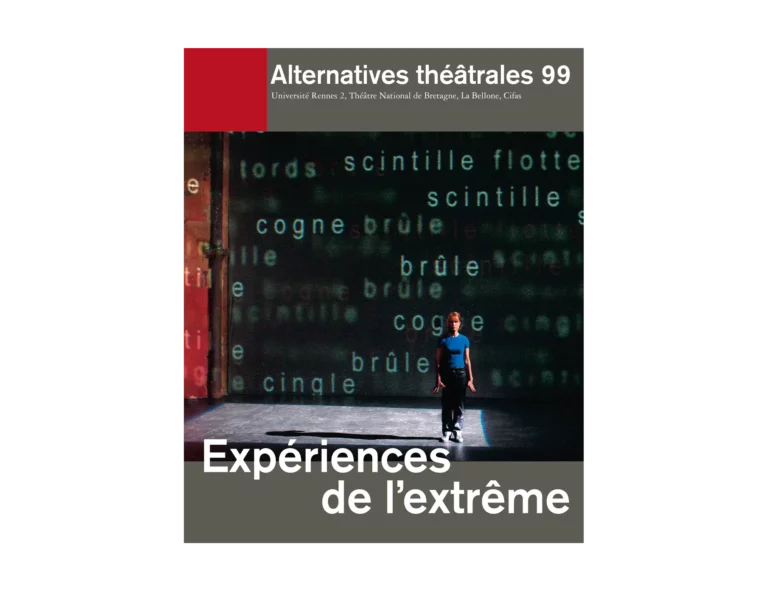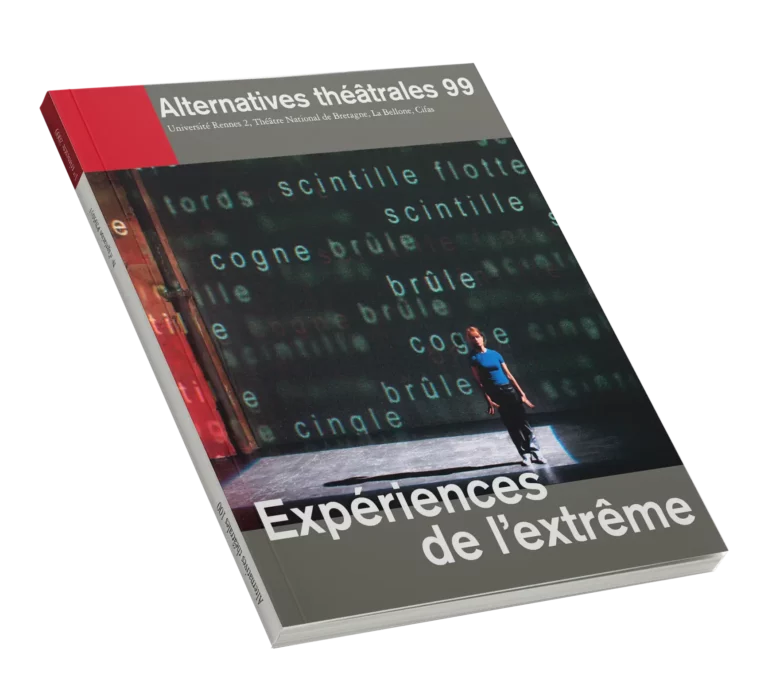Si Pier Paolo Pasolini et Didier-Georges Gabily écrivent leur théâtre dans des contextes nationaux et sociopolitiques bien différents (mouvements de contestation étudiante et avènement de la société de la consommation pour le premier, chute du mur de Berlin et expansion irrésistible du libéralisme économique de type anglo-saxon pour le second), il n’en demeure pas moins que les deux œuvres partagent un même geste d’écriture en ce qu’elles problématisent les puissances propres du théâtre et leurs rapports à la configuration sociale et politique contemporaine. En d’autres termes, les pièces interrogent la puissance mythopoétique de la scène au sein de la société. Elles partagent également une même interrogation quant aux puissances du théâtre face aux morts, ou plus précisément quant aux rapports qu’entretiennent aux cadavres à la fois la fiction et la parole théâtrale.
Cette puissance mythopoétique est posée par les deux auteurs comme l’exigence propre du théâtre, et cela depuis Athènes. Ils se réclament donc du modèle grec, de la tragédie comme interrogation de la communauté sur elle-même. Dans la préface de sa traduction de L’Orestie parue en 1960, Pasolini dit vouloir se mesurer à Eschyle, qui montre dans sa trilogie la fin de la société archaïque et la naissance de la société politique. Le théâtre pasolinien postérieur peut être considéré selon cette relation intertextuelle : l’auteur aspire à y mettre en fable les mutations du pouvoir politique et économique dues à l’avènement de la société de consommation. Le modèle grec, s’il est revendiqué de façon moins explicite par Gabily, n’en est pas moins présent chez lui. La « substance essentielle » du théâtre, « son devoir d’être », consiste en « la parole d’aujourd’hui pour aujourd’hui ; le texte dramatique contemporain pour les hommes et les femmes qui vivent ici même »1.
Du fait de l’ancrage historique de ces œuvres, la puissance mythopoétique du théâtre se trouve confrontée à la fois à une exigence et à un ensemble de menaces. L’exigence concerne le projet même de dire le monde, « l’après-Auschwitz » et la réitération effroyable de l’horreur. En effet, l’événement historique du génocide des Juifs par les nazis sert davantage de paradigme de la modernité que de référence historique. Dans de nombreux essais au milieu des années 1970, Pasolini utilise le terme de « génocide » pour désigner les mutations qui affectent la société italienne. Chez Gabily, les cadavres de la modernité sont ceux des innombrables guerres qui ont eu lieu depuis 1945, mais ce sont aussi les victimes du système libéral : « Nous marchons sur des cadavres et continuons à tenter d’agir et de penser comme si nous n’étions pas ces marcheurs piétinant les cadavres de plus d’un demi-siècle de catastrophes, de défaites et d’abdications en tout genre. Aujourd’hui, les cadavres peuplent jusqu’à nos rues »2. Il s’agit, pour les deux auteurs, de donner une fiction à ces corps meurtris ou assassinés. Or, cette exigence de dire l’horreur du monde se trouve elle-même menacée, et à travers elle la puissance mythopoétique du théâtre.
L’occultation des cadavres
En écrivant dans le « Désordre liminaire » de Violences que son œuvre ne peut être constituée que de « bribes de tragédies défaites »3, Gabily signale la distance qui sépare le projet tragique des puissances contemporaines du théâtre. La tragédie ne peut subsister que sous la forme de traces. Et cela, parce que la fable contemporaine majoritaire, l’ensemble des récits qui fondent le présent et qui proposent des types exemplaires de comportement, est profondément antitragique. Cette fable contemporaine est celle des sitcoms, des soap operas, dont Gabily parle dans les didascalies de ses pièces. De même chez Pasolini, le projet tragique vient buter sur la fable contemporaine des années 1960, qui n’est pas tant médiatique que politique : celle du progrès, de l’accession au bien-être matériel. Or, ces fables se rejoignent en un point : leur antitragicité réside dans l’occultation des morts, nécessaire à leur déploiement. En d’autres termes, la fable majoritaire, médiatique ou idéologique, ne s’écrit qu’à partir de l’oubli et du refoulement du cadavre. Les deux auteurs vont déployer dans leurs pièces les fables de cette occultation, mais pour mieux les défaire.
C’est, par exemple, le cas de Pylade. La tragédie pasolinienne propose une suite à la trilogie tragique d’Eschyle, L’Orestie, et s’ouvre sur l’évocation des dépouilles de Clytemnestre et d’Égisthe, que l’on vient d’enterrer. Oreste, à son retour, demande à son peuple l’oubli du passé pour que la société démocratique s’établisse, et refuse d’aller prier sur la tombe des rois défunts. Pasolini pose ainsi une concomitance troublante entre l’instauration de la démocratie et l’oubli des morts. Mais les cadavres vont venir perturber le monde laïque des vivants, comme dans une tragédie attique : certaines Euménides redeviennent Furies et réclament les hommages que le culte des morts exige. Toutefois, cette résurgence du cadavre tragique ne sera que provisoire, et Oreste parviendra à la juguler par l’instauration d’une société basée sur le bien-être matériel. Pour le dire de façon peut-être brutale, Pylade est le récit de la sortie de la tragédie, de la séparation définitive du monde des morts et du monde des vivants.
L’œuvre de Gabily évoque deux autres types de récits majoritaires contemporains menaçant l’exigence de rendre compte des cadavres du monde : ceux qui exploitent ces cadavres, et ceux qui en réclament de nouveaux. Les premiers sont les récits de l’industrie télévisuelle ou cinématographique qui font du corps des victimes un rouage de leur économie libidinale en satisfaisant les pulsions de voyeurisme des spectateurs. C’est une autre forme d’occultation du cadavre, puisque celui-ci y devient un produit d’appel. Les seconds sont les mythes qui persistent dans notre présent (la Phèdre de Gibiers du temps qui continue à réclamer depuis deux mille quatre cents ans la mort d’un Hippolyte). Les mythes sont des récits de massacre pour Gabily, et leur survivance pose problème en ce qu’elle implique la perpétuation des horreurs qu’ils contiennent.
Au vu de ces exemples, il est évident que le geste d’écriture des deux auteurs est celui d’une confrontation brutale avec ces différents récits qui dirigent le cours du monde. Leur reprise participe de la thématisation des puissances du théâtre évoquée plus haut : que peut la scène face aux récits qui effacent les morts ?
L’archéologie de la fable
Le théâtre permet le retour des morts, c’est là sa puissance. Et ce retour s’accompagne de l’implosion du récit majoritaire. Les deux auteurs opposent donc à un premier récit, qui rend manifeste l’emprise de la fable contemporaine sur le monde d’aujourd’hui, un second récit, celui des « cortèges de cadavres », qui déjoue et interrompt les récits d’occultation et d’exploitation de la mort. Les deux auteurs interrogent les fables du présent, mais aussi celles du passé, depuis la perspective, le prisme des victimes de l’histoire, grâce à l’intrusion de fantômes, de spectres, d’énonciateurs indéterminés, de personnages en marge ; bref, grâce à l’intrusion d’une voix autre, d’une parole d’altérité. Dans Bête de style, les narrations génocidaires sont prises en charge par des fantômes, des « esprits » : l’esprit de Karel, celui de la Mère. En cela, Pasolini s’inscrit dans une longue et importante tradition théâtrale ; nous pensons, par exemple, au fantôme de Darius dans Les Perses d’Eschyle ou à celui du père dans Hamlet. S’il n’y a pas de fantôme dans Pylade, c’est Athéna qui prophétise le génocide, apparaissant, telle un deus ex machina, dans le monde des mortels. Et du fait de l’intrusion de cette parole autre, les fables contemporaines se défont, se délitent, laissant apparaître leurs fondations traumatiques refoulées.
L’intrusion du cadavre, de sa parole ou d’une parole qui le dit, vient mettre à mal la fiction, ou plus précisément vient creuser la fable : l’écriture dramatique se fait stratigraphique, au sens que le retour du mort permet de retourner la fable majoritaire comme un terrain archéologique, et ainsi, d’en saisir les motifs oubliés. Elle peut être également prophétique : les voix pythiques de l’œuvre gabilienne, comme l’Athéna de Pylade, révèlent aussi le devenir terrifiant des récits contemporains, ceux du progrès matériel et de la société de consommation. Dans les deux cas, l’action dramatique contemporaine est minée dans les pièces par la voix de ces morts sur lesquels elle germe ou qu’elle va produire, par la persistance de leurs mots qu’elle tente d’oublier. Il y a donc comme une obscénité de la présence du cadavre génocidaire par la mise à jour qu’il opère de la part maudite et oubliée de la fable contemporaine ; obscénité d’un geste d’écriture qui se rapproche le plus souvent de l’anamnèse. Celle-ci est alors politique en ce qu’elle consiste en une déconstruction des récits majoritaires ou médiatiques. Les morts resurgissent pour défaire les grands récits qui fondent les sociétés occidentales, comme, d’ailleurs, ceux de la commémoration qui favorisent l’oubli.
Dans Pylade, comme il a été déjà dit, Pasolini propose une parabole qui montre la naissance de la société démocratique moderne et son devenir décadent en société de consommation à travers les figures du mythe des Atrides. Or, dans cette trame qui signe la mort de la tragédie par l’occultation des morts, Athéna apparaît à Oreste, qui doute du devenir d’Argos, pour lui prophétiser l’épisode douloureux que sera l’extermination nazie, figurée par le meurtre d’un jeune homme englouti dans une marmite ornée d’une croix gammée. La distance qui sépare le temps du mythe du génocide juif prophétisé par Athéna pose problème. Même en rapportant le récit de l’extermination au monde contemporain visé par la parabole pasolinienne, une hétérogénéité irréductible subsiste dans l’intrusion de ce récit. Que penser de cette mise en relation généalogique entre la société laïque, démocratique et la barbarie nazie ? La parole d’Athéna est donc inaudible pour Oreste, qui l’oubliera bien vite. L’intrigue poursuit alors son cours jusqu’à la victoire d’Oreste et de la société du bien-être sur la révolte de Pylade qui s’opposait à cette idéologie du progrès. Mais la véritable fin est ailleurs, elle se situe dans le récit du génocide juif. Si le récit d’émancipation politique minoritaire porté par Pylade est disqualifié par le dénouement de la pièce, le récit du développement matériel de la société occidentale l’est également, mais par celui du génocide, puisqu’il ne peut s’écrire que par l’oubli scandaleux du désastre. L’intrusion du fantôme qui vient dire le cadavre du génocide dans la trame de la fiction dramatique permet donc l’affirmation forte d’un geste d’anamnèse : il s’agit, par ce biais, de montrer et de déjouer les stratégies d’occultation du génocide à l’œuvre dans les sociétés du bien-être, de faire surgir l’impensé des fables célébrant le progrès matériel.