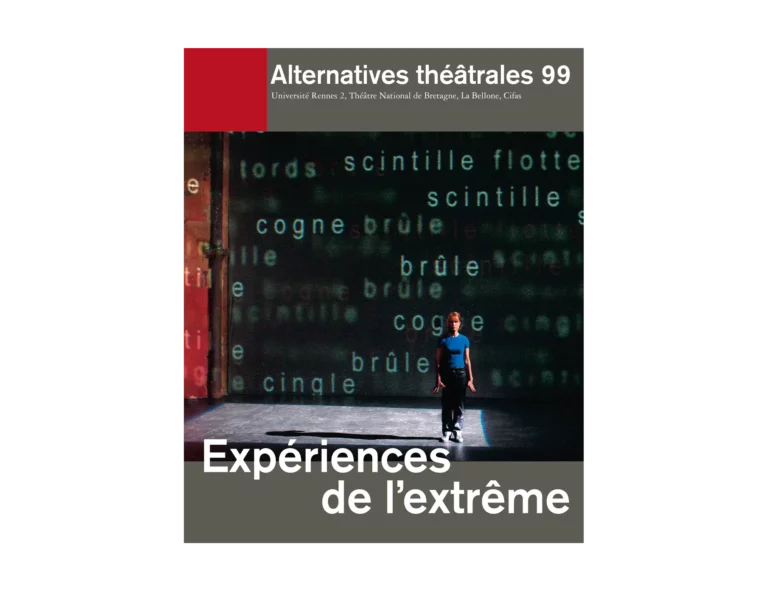« Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite »
Apocalypse selon Saint-Jean,
chapitre 1, verset 19
Parmi tous les événements de la fin du XXᵉ siècle qui sont couramment évoqués par les essayistes et historiens des idées comme marqueurs chronologiques de la « fin des idéologies », de la « fin de l’Histoire », de la « fin » de la croyance aveugle dans les sciences et la notion de progrès, ou plus simplement, de la fin d’un monde, la catastrophe de Tchernobyl n’a sans doute pas été autant citée qu’elle aurait dû l’être. Plus de vingt ans se sont écoulés depuis que quatre cent cinquante types de radionucléides différents se sont répandus sur notre terre à la suite d’une explosion équivalente à trois cent cinquante bombes d’Hiroshima. Ouvertures de la jarre de Pandore ou des sceaux des cavaliers de l’Apocalypse, on ne compte plus depuis les images empruntées aux textes anciens ou aux Écritures saintes pour tenter de décrire la quantité de poison déversé du trou béant ouvert par la pulvérisation du toit du quatrième réacteur de la centrale ukrainienne.
Dans un monde qui avait jusqu’alors cru assister à la victoire du rationalisme, le texte de l’Apocalypse de Jean était de nouveau convoqué par de nombreux observateurs pour associer Tchernobyl de façon symbolique aux premiers signes du châtiment divin. La catastrophe semblait pour eux consacrer la renaissance de Dieu aussi bien que l’avènement du « royaume de l’amertume », ce qu’ils cherchaient à démontrer en s’appuyant sur l’étymologie du mot Tchernobilnik : signifiant justement « armoise » (une espèce de plantes dont l’une des variétés est l’absinthe), le nom même du site de la centrale rappelait que dans les Écritures saintes, ce terme avait été associé à la mort, aux épreuves et aux chagrins de la vie.
La prophétie, qui avait promis qu’un grand astre, brûlant comme une torche, percuterait la Terre, changeant le tiers des fleuves et des sources en « eaux amères », révoquait en doute l’immortalité du genre humain. Elle s’était substituée à l’idée que chez les anciens, le nom latin commun à toutes les armoises avait été relié à celui de la déesse Artémis, maîtresse et protectrice des bêtes fauves et d’une nature sauvage à défendre contre l’atteinte des hommes. Et en effet, dans la zone interdite des trente kilomètres autour de la centrale, la nature reprenait maintenant ses droits sur les folles constructions des hommes. À cet endroit, où les sangliers se reposent maintenant près d’anciens poêles et où les arbres crèvent les planchers d’anciens salons vidés de leurs habitants, le monde ne semble pas se porter plus mal en continuant à tourner sans l’espèce humaine.
Ce qui « nous » arrive
Le début de la catastrophe pouvait être précisément daté au 26 avril 1986 à 1h26 du matin, date et heure de l’explosion du réacteur, et l’on ne lut pas depuis un seul article omettant de rappeler le fait, comme pour souligner qu’elle appartenait bien au passé. Or, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il était justement impossible d’en prévoir la fin, à moins de reléguer celle-ci dans un futur de plusieurs centaines d’années en se fondant, par exemple, sur des critères aussi fantastiques que celui de la durée de vie du plutonium. D’autres ont montré qu’en Biélorussie, pays le plus directement et immédiatement touché par les retombées radioactives, Tchernobyl avait été très tôt comparé à un arbre qui pousse et qui n’en finit pas de pousser1. De fait, la catastrophe de Tchernobyl, avec son lot de maladies et de mutations, est toujours en cours.
Ce que l’urbaniste et essayiste Paul Virilio a qualifié « d’accident de la connaissance » s’était toutefois produit ailleurs et dans un autre temps. Un « ailleurs » qu’on préfère encore souvent localiser en Ukraine, en dépit de la quantité de mesures ayant depuis montré que Tchernobyl était l’affaire du monde entier. Un temps qui, comme le notait parallèlement l’écrivaine russophone de Biélorussie, Svetlana Alexievitch, avait pris une dimension nouvelle pour se transformer en éternité, comme si la fin et le commencement avaient choisi de se rencontrer2.
Pour le reste de l’Europe, et pendant longtemps, Tchernobyl ne fut toutefois associé à aucun processus de « mise à nu » ou de « révélation ». La « levée du voile » fut plutôt dévolue, trois années plus tard, à la chute du mur de Berlin : espoir immense pour les uns, désespoir infini pour les autres. L’URSS n’allait bientôt plus être et l’Europe en resterait bouleversée. Confrontée à l’histoire de son si « court » mais si sanglant XXᵉ siècle, elle se voyait mise en demeure de penser les interactions entre histoire du nazisme et du communisme, entre essentialisme et marxisme, comme de rétablir la vérité sur les mensonges par omission de trop de ses intellectuels et dirigeants acquis à la cause du progrès à tout et à n’importe quel prix.
La chute du mur de Berlin et la fin de l’URSS étaient ainsi de ces conséquences qui faisaient oublier les causes : une catastrophe ingérable à tous les points de vue s’était produite, qui ne semblait pouvoir trouver aucune solution économique, politique ou sanitaire. Elle avait signé la restauration d’une économie de guerre à l’échelle de l’URSS, précédant le morcellement d’un empire, le retour des blindés dans les rues, l’évacuation nécessairement forcée de centaines de milliers de personnes, la mobilisation de milliers de soldats et de « liquidateurs » pour tenter de vaincre l’atome, l’univers, et éviter qu’une seconde explosion nucléaire, bien plus importante, ne nous conduise à rayer la majeure partie de l’Europe des cartes de géographie3.
Nul ne pensait alors à ces centaines de milliers de Soviétiques qui s’étaient sacrifiés pour pérenniser l’idée de notre immortalité en tant qu’espèce. Nul ne témoignait de la souffrance de ceux qui avaient vu chars et pelleteuses raser sous leurs yeux et sans autre forme de procès leur maison, avant de se laisser entasser dans des bus pour être arrachés manu militari à la contamination. Nul ne mentionnait les milliers d’animaux hautement radioactifs fusillés à la kalachnikov, les mètres cubes de terre enterrés dans la terre, les trois mille deux cent vingt et un villages de Biélorussie contaminés ou « perdus ». Deux millions et demi de personnes étaient encore contraintes de continuer à vivre dans la contamination pour éviter, selon les termes d’un diplomate en poste à Minsk en 2001, « de trop déstabiliser le limon économique local ». Dans certains villages désormais coupés du monde, elles devaient apprendre à laver l’eau, à nettoyer les bûches, à cultiver leur champ à la faux, à réinventer la roue et à se satisfaire de la solitude.
Nul ne soulignait alors que la défection du nucléaire civil conduisait justement l’humanité à « faire avec » la contamination tout en réapprenant à vivre à la bougie ; qu’il était inutile d’introduire un rapport de cause à conséquence entre la nécessité de se chauffer et l’obligation de courir le risque d’être contaminé (comme en témoignent encore certains discours sur le nucléaire comme « instrument de civilisation »). Trop peu de voix enfin s’élevaient pour critiquer le fait que la gestion d’une catastrophe nucléaire, y compris civile, ne supportait pas la démocratie et, par voie de conséquence, ne supportait pas le théâtre4. C’est que l’absinthe est aussi une plante dont l’usage fut largement répandu, à dater du XVIIIᵉ siècle, pour provoquer l’oubli, sous la forme d’une boisson à laquelle on donna le nom coquet de « fée verte » mais qui, consommée à trop fortes doses, rendait aveugle.
Les premiers suppliants
Le livre qui témoigna le mieux de notre aveuglement et de notre impuissance, et que nul n’est depuis parvenu à surpasser, n’avait pas été écrit par un spécialiste du nucléaire cherchant à expliquer la radioactivité aux ignorants. Il s’agissait de ce qu’on appela plus tard un « roman de voix », mais de ce qu’on appelait plus simplement alors un roman documentaire. Une voix artistique autant qu’isolée s’était élevée dans le « silence hurlant » qui avait succédé à la catastrophe, pour aborder la question sur le terrain du sensible. La prière de Tchernobyl. Chroniques du futur (Černobyl’skaja molitva. Xronika budušcego)5 de Svetlana Alexievitch fut toutefois traduite en français par son éditeur sous le titre La Supplication. Chronique du monde après l’Apocalypse (Lattès, 1998) : une traduction qui prenait le contre-pied de la thèse de l’auteure, pour qui l’apocalypse ne faisait justement que commencer, et qui utilisait le témoignage6 comme procédé permettant d’écrire sur ce qui avait été, était et allait être. C’est ce livre qui allait notamment permettre à Bruno Boussagol, metteur en scène de la compagnie Brut de béton production, de développer et d’appliquer au théâtre le concept de « mémoire du futur » dans sa mise en scène d’Elena (2001). L’actrice Nathalie Vannereau adressait au public le premier monologue de La Prière…, les deux pieds ancrés dans un jardin japonais miniature, sous une sculpture gigantesque de fibres et d’acier suspendue au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès.
Comme l’a montré Bruno Boussagol, dans supplication, il y a « supplice » : « Supplice est pour moi un des quelques mots prometteurs qui ouvrent la jarre de Pandore. J’ai lu, dévoré même — comme on dit d’un livre qui vous séduit — cette prose si singulière qui vous propulse dans l’hyper-modernité, mais paradoxalement en vous ramenant à l’archaïsme des sentiments. J’ai lu et relu. Je n’en croyais pas mes yeux ! Quelque chose d’important se passait là, à portée de main, qui venait barrer le flux de la littérature contemporaine. Un auteur (ici une auteure) avait donc, en amont de ma lecture, durant des années d’élaboration, construit un “objet littéraire” qui venait répondre à de graves questions relatives à l’humanité, à l’art, à l’amour, à la vérité. Et c’était par la littérature que cela passait, plutôt que par la science, la politique ou la philosophie7. »