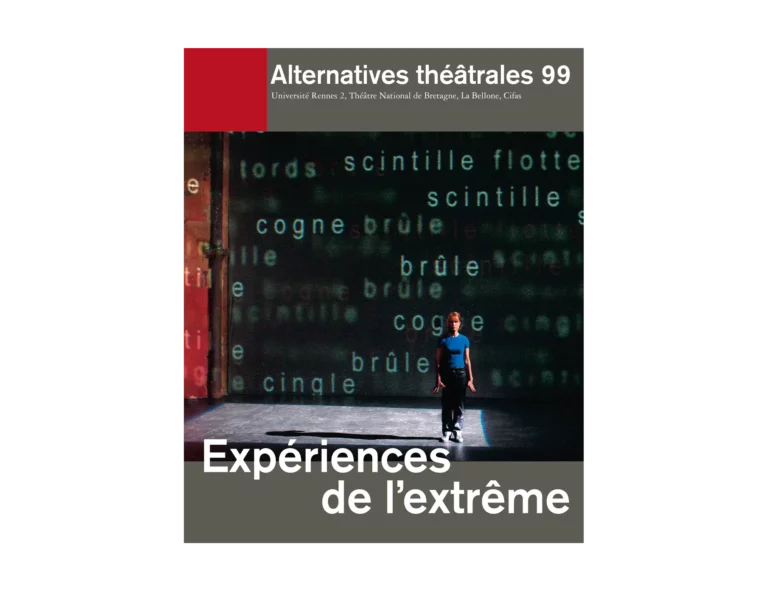YANNIC MANCEL : J’aimerais pour cet entretien que nous procédions en trois temps. D’abord que par un bref historique, le plus subjectif possible, vous nous rappeliez l’histoire de La Bellone, cette « Maison du Spectacle, La Bellone », située, je le rappelle, au 46, rue de Flandre à Bruxelles. Je souhaiterais ensuite que vous nous résumiez en quelques mots ce qui, dans votre histoire intellectuelle et artistique personnelle, vous a amené à poser votre candidature à ce poste et à être nommé directeur de ce lieu. Je voudrais enfin que le troisième temps de notre conversation soit consacré à votre projet, ses objectifs, ses enjeux, en distinguant peut-être ce qui a déjà été amorcé après un an d’activité et ce qui reste à réaliser ou à développer. Mais commençons par le commencement : comment perceviez-vous La Bellone et son imposante histoire avant d’y être nommé ?
Antoine Pickels : En 1980, un scénographe, également artiste-peintre, Serge Creuz, prend l’initiative de fonder cette Maison du Spectacle dans un lieu très particulier, une maison patricienne en fond de rue, édifiée à la charnière des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, avec une magnifique façade baroque, semblable aux murs de scène des théâtres à l’antique ou à l’italienne, qui possède donc par ses reliefs et son dessin une sorte de théâtralité inhérente ou naturelle. Il s’agit donc d’abord d’un projet d’artistes, et non d’un projet d’administrateur ou d’intendant : la précision a son importance. Ensuite, ce projet a évolué avec la pensée de son fondateur selon des étapes différentes : dans un premier temps, l’idée était d’en faire principalement un musée des arts de la scène, rythmé par des expositions temporaires, dont la dominante première était évidemment scénographique puisque telle était la compétence première de Serge Creuz. Mais ce qui m’émeut encore aujourd’hui dans son projet, c’est l’idée initiale de créer une maison qui rassemble tous les arts et tous les artistes du spectacle : un point de rendez-vous, un centre de réunion, un lieu de visibilité aussi, de tous ceux qui participent à la création du spectacle : l’auteur, le metteur en scène, le régisseur, le maquilleur de plateau… ce qui traduisait un respect, une reconnaissance et une attention pour tout ce et ceux qui participent à la création, tous les métiers, y compris ceux qu’on appelle les petits métiers. Je retrouve dans ce projet initial l’élément principal qui m’a fait m’orienter vers le théâtre, à savoir le goût du collectif. C’est un art que, même quand on est performer en solo, on ne peut pas faire tout seul : le théâtre se définit par la nécessité de l’autre, du collectif, du talent conjugué de plusieurs personnes, et cela, Serge Creuz l’avait non seulement compris, mais il l’avait inscrit dans le projet même de sa Maison du Spectacle.
Yannic Mancel : Comment cela se manifestait-il concrètement dans les activités de La Bellone ?
Antoine Pickels : Principalement dans l’importance accordée à la lumière et aux éclairagistes, dont l’art était encore un peu négligé dans les années quatre-vingt, mais aussi dans l’intérêt renouvelé pour les masques, les marionnettes, les automates, la danse, la musique, les affiches… Bref, tous les métiers de la scène étaient tour à tour mis en évidence par des expositions, des publications, des cycles de conférences et de rencontres… En prenant de l’ampleur, le projet a évolué architecturalement aussi : ce qui était au départ concentré dans cette maison en arrière-cour s’est étendu aux bâtiments adjacents bordant deux des trois autres côtés de la cour, puis est venue l’idée que je trouve pour ma part audacieuse et géniale de couvrir la cour d’un toit de verre afin d’en faire une « place publique » couverte, comme une sorte de halle, d’agora ou de forum, à l’abri des intempéries, tout en restant ouvert à la lumière naturelle et au ciel. Voilà ce qui m’intéresse passionnément : être à la tête non pas d’un théâtre, d’un musée ou d’un centre d’archives mais d’une place publique ! Parallèlement, quelques pôles associatifs se sont successivement greffés sur ce nouveau complexe et autour de cette cour : une bibliothèque des arts du spectacle, un centre d’information et de documentation sur la danse, une bibliothèque consacrée aux compagnies dramatiques amateurs… France Culture, les Brigittines, le CIFAS (Centre International de Formation en Arts du Spectacle), Temporalia, qui allait donner naissance au Centre des Écritures Dramatiques, y ont été temporairement hébergés. Le Réseau des Arts à Bruxelles y réside encore… De nombreuses aventures sont nées ici et y ont grandi avant d’aller se développer ailleurs dans une plus grande autonomie. J’aime beaucoup cette tradition d’accueil, d’hospitalité, cette idée d’aider à naître et à grandir, cette idée de fédérer des aventures naissantes sans les infléchir ni les contraindre. À la mort de Serge Creuz en 1996, son adjointe et compagne, Anne Molitor, a repris le flambeau, en codirection avec Monique Duren, qui venait du service culture de la Ville de Bruxelles et qui dirige aujourd’hui Les Brigittines. À leur côté, Pietro Pizzuti a redynamisé l’action qu’il avait déjà auparavant engagée dans cette maison, dans un contexte général fébrile où se réunissaient les États Généraux du Jeune Théâtre et se dessinait déjà la préparation de Bruxelles 2000, capitale européenne de la culture. Le lieu est alors devenu un espace de dialogue intense et vif entre des énergies artistiques, culturelles et institutionnelles parfois antagonistes. Et c’est aussi dans cette dynamique, en 1998, sous la direction d’Anne Molitor, qu’a été créée la revue Scènes, en écho écrit à tous ces débats tumultueux, un magazine qui donnait la parole aux artistes plus qu’aux commentateurs. On mesure ainsi combien l’outil s’est progressivement perfectionné : il s’est aujourd’hui doté d’un café et d’un comptoir d’accueil qui assurent une transition plus conviviale entre la rue et la cour. Ce sont des petits détails pratiques apparemment anecdotiques mais qui contribuent à l’animation et à l’esprit du lieu. Reste la question de la visibilité repérable sur la rue, qui demeure un vrai problème, heureusement en cours de résolution.
Yannic Mancel : Et combien d’employés pour faire fonctionner tout cela ?
Antoine Pickels : La Maison compte actuellement dix-neuf salariés, la plupart à temps partiel et beaucoup sur des emplois aidés, dont on pourrait décliner les fonctions ainsi : une équipe direction qui conçoit, organise et réalise les diverses manifestations et des secteurs qui se subdivisent en recherche, information, documentation, gestion, intendance, accueil et entretien… Peu de monde au total, si on convertit tous ces temps partiels en temps pleins je ne surprendrai personne en affirmant qu’en proportion du foisonnement de ses activités, la Maison est sous-subventionnée. Tous sont au service de ces trois missions cardinales que je résumerai ainsi : une vitrine des arts de la scène, avec une attention particulière accordée à ce qui se passe en Wallonie et à Bruxelles ; un forum où se dispute la chose publique en matière de spectacles ; et enfin, un lieu de mémoire vivante du spectacle vivant.
Yannic Mancel : Le moment est venu, me semble-t-il, de nous dire comment, ici et maintenant, votre histoire personnelle croise l’histoire de ce lieu de vie artistique, de débats et de mémoire, avec précisément les missions qu’il s’est progressivement construites. Autrement dit, d’où venez-vous et qui êtes-vous, Antoine Pickels ?
Antoine Pickels : Si l’on remonte à mes années de formation, disons qu’en termes d’enseignement supérieur elles furent très brèves : j’ai quitté l’INSAS, où j’étais entré en section mise en scène, au bout d’un mois et demi ! J’étais déjà trop dans le métier pour m’intéresser de façon concentrée à un enseignement théorique initial. J’avais commencé à dix-sept ans comme artiste-performer et metteur en scène de théâtre expérimental, formé sur le tas par des héritiers de l’avant-garde américaine, ceux qui à l’époque animaient les soirées du Plan K, eux-mêmes disciples et anciens collaborateurs de Robert Wilson, Lucinda Childs, Laurie Anderson, etc. Parallèlement, j’étais aussi plasticien, peintre et installateur. Quant aux métiers du théâtre, je les ai presque tous pratiqués : peintre de décors au Théâtre des Galeries, éclairagiste, producteur, diffuseur, vidéaste… J’ai même accompagné un groupe de rock expérimental américain, Tuxedomoon, qui avait pendant quelques années posé ses valises à Bruxelles. J’ai été aussi pendant un temps responsable d’éditions à l’ULB auprès de Jacques Sojcher : pour moi qui n’avais pas fait d’études supérieures, ou si peu, c’était une chance et un bonheur de côtoyer les grands sociologues ou philosophes à qui nous commandions des textes. Je me souviens avec émotion du volume Belgique toujours grande et belle en 1998, un chant du cygne de la Belgique entonné par cent vingt-sept auteurs tous plus passionnants les uns que les autres…
Yannic Mancel : Comment, au terme de cet itinéraire très éclectique et un peu désordonné, êtes-vous revenu au théâtre ?
Antoine Pickels : C’est la crise du sida qui m’a ramené au politique, et donc au théâtre : j’ai eu envie d’écrire des pièces et de monter des spectacles qui traitent de ce sujet sous un angle un peu alternatif, avec une interrogation sur le point de vue…
Yannic Mancel : Il y a eu aussi cette collaboration avec Virginie Jonay, je pense notamment à Bruxelles, ville d’Afrique, qui portait un regard nouveau et très documenté sur l’identité coloniale belge à travers le rapport de la Belgique à l’Afrique centrale.
Antoine Pickels : C’est vrai, et je n’ai plus jamais abandonné depuis ce rapport à l’écriture, puisque je reviens depuis peu d’une résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, où j’ai retravaillé une de mes pièces, et j’ai continué mon activité de traducteur d’auteurs britanniques, voire d’auteurs indiens de langue anglaise…
Yannic Mancel : À une certaine époque, disons autour des années 2000, je vous ai également connu comme conseiller artistique et concepteur d’événements souvent entourés d’un certain prestige…