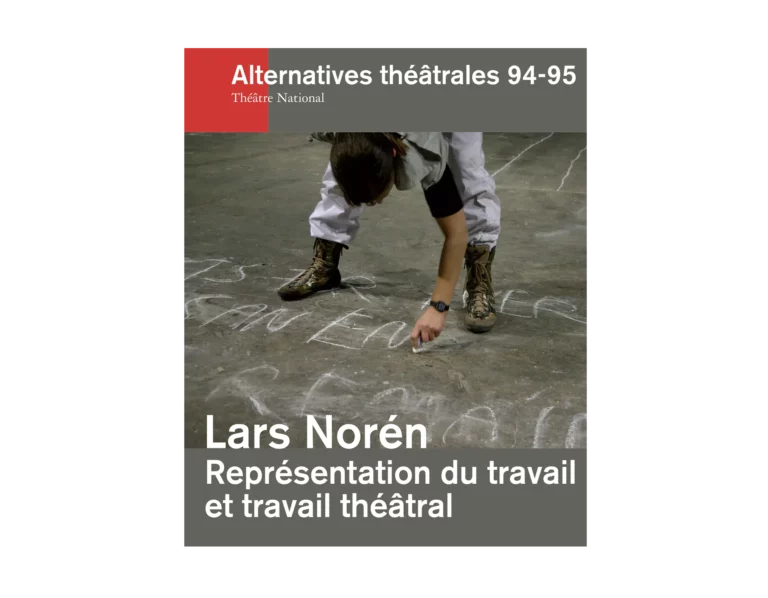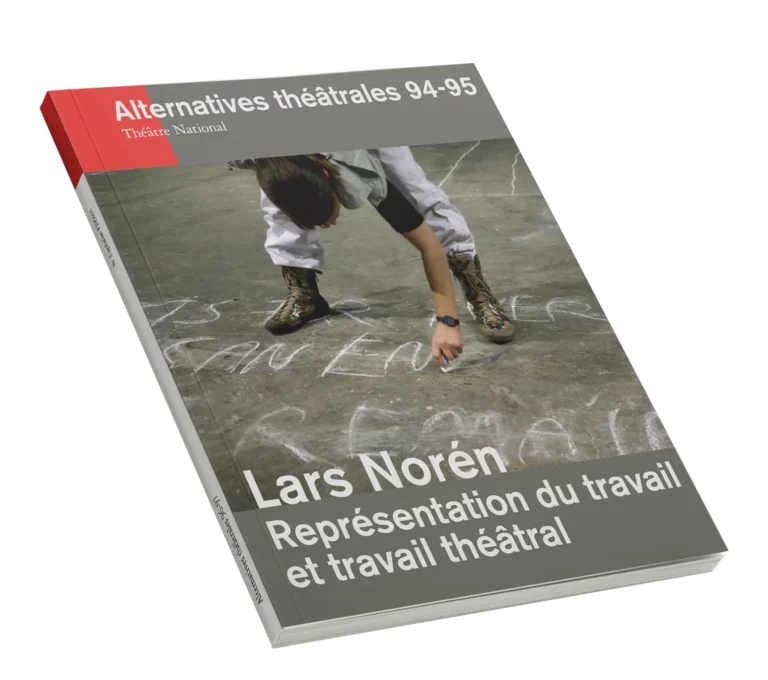A la première lecture, Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis se compose de huit tableaux discontinus, dans le style fragmenté (fragmentaire?) hérité de la tradition germanique, de Heiner Millier, mais aussi peut-être plus lointainement de Brecht et de Karl Valentin, qu’affectionne depuis toujours, du moins pour une partie de son œuvre, l’auteur Jean-Marie Piemme. Huit saynètes. Huit sketches. A moins qu’il ne s’agisse de huit entrées de clowns réunissant à sept reprises, sur la piste ou sur le ring, comme pour un improbable spectacle de boxe à quatre pattes et à deux poings, un humain et un chien, dans la pure tradition cette fois des duos burlesques de cirque : Footit et Chocolat, Pippo et Dario, l’Auguste et le clown blanc, à moins qu’il ne s’agisse après tout d’un nouvel avatar de Didi et Gogo, alias Vladimir et Estragon, les clochards métaphysiques du Godot de Beckett — les Pensées de Pascal jouées par les Fratellini, disait encore Anouilh. Du « théâtre des idées » donc, selon la belle formule d’Antoine Vitez, mais enfariné, et maquillé avec son nez rouge en empoignade foraine. Gare à vos abattis ! Les mots vont rouler. Les coups aussi. La joute oratoire, dans sa version populaire et bonimenteuse, n’est après tout qu’une « bastonnade verbale », nous apprit naguère Mikhaïl Bakhtine, un pugilat de paroles où les deux adversaires se rendent coup pour coup — une formidable stichomachie en quelque sorte, de celle où les acteurs, comiques ou tragiques, s’affrontent en crescendo vers à vers, réplique contre réplique, jusqu’au K.O. final…
Dialogisme
De Bakhtine, ou de Julia Kristeva qui contribua fortement à commenter et propager en francophonie l’appareillage théorique du grand chercheur soviétique, Piemme aura sûrement retenu aussi le concept de « dialogisme », cette forme spécifique, duelle, de théâtre des idées, cette dialectique narrative et romanesque, souvent carnavalesque et bouffonne, qui trouve ses racines antiques dans le dialogue socratique, qui passe ensuite par Erasme, Rabelais, Shakespeare et Cervantès, se réincarne au XVIIIe siècle dans les dialogues mi-dramatiques mi-romanesques de Denis Diderot ‑Jacques le Fataliste, Le Neveu de Rameau- et trouvera probablement, sans pourtant que Bakhtine en fasse mention, dans les Dialogues d’exilés de Bertolt Brecht, l’un de ses accomplissements les plus aboutis : « J’étais en train de lire Jacques le Fataliste de Diderot, note Brecht dans son Journal en octobre 1940, lorsque m’est venue à l’esprit une nouvelle possibilité de réaliser mon vieux projet concernant Ziffel. À la lecture de Kivi1, j’avais aimé sa façon d’intercaler des dialogues dans le texte. En outre, j’ai encore dans l’oreille le ton de Puntila. À titre d’essai, j’ai rédigé deux courts chapitres et intitulé l’ensemble Dialogues d’exilés ». Or, lorsqu’en 1999 Jean-Marie Piemme s’était déjà,avec brio, essayé au dialogue avec Toréadors — c’était dans la Salle des voûtes du Théâtre Le Public —, ne réagissait-il pas précisément à une commande de Philippe Sireuil qui lui avait amicalement enjoint : « Ecris-moi un Dialogue d’exilés d’aujourd’hui ! » Ainsi le physicien Ziffel et l’ouvrier Kalle de Brecht s’étaient-ils métamorphosés sous le clavier de Piemme en un gérant de laverie automatique immigré (le très méditerranéen Momo de Pietro Pizzuti) et un SDF vaguement philosophe, intellectuel déclassé, également immigré (le Ferdinand plus balkanique ou plus slave d’Alexandre von Sivers), avant de connaître aujourd’hui une nouvelle métamorphose : le portier d’hôtel squatter de caravane de Philippe Jeusette, et le chien parlant, espiègle et arrogant, de Fabrice Schilacci. Le dialogisme, c’est aussi le lieu d’expression du paradoxe, cette autre figure de la pensée qui, appliquée au théâtre et surtout à l’art du comédien, fut également chère à Diderot, et à laquelle Piemme recourt à son tour lorsqu’il commente les situations dramatiques et humaines dont il part pour enclencher sa parole performative. C’est enfin la forme la mieux appropriée à l’expression de l’ambivalence des contraires, de la dialectique, de la dynamique inséparabilité des forces antagoniques qui constituent non seulement le ressort des sociétés, mais celui de la vie même : pulsion de vie / pulsion de mort, amour / haine, attirance / répulsion, le même / l’autre, l’identité / la différence — éternel combat d’Eros et de Thanatos, d’ego et d’alter… On le sait depuis Aristote et sa Poétique, pas de théâtre sans conflit ni tension. L’« agôn » et ses multiples dérivés dans notre langue, l’antagonisme, voire l’agonie, sont le moteur de tout enjeu dramatique, qu’il soit comique ou tragique. Avec la tauromachie implicite de Toréadors cette corrida que se livrent dans l’arène dérisoire d’une laverie automatique les deux immigrés bruxellois, comme avec les aboiements et les morsures que s’assènent indiscernablement le vieux groom et son chien de gouttière dans Dialogue…, Piemme touche à l’essence même de toute dramaturgie.Dans Toréadors déjà, un processus d’inversion — de renversement, voire de détrônement carnavalesque,pourrait-on dire — aboutissait à la fin de la pièce à la dépossession par Ferdinand le sans-abri de la gérance de l’échoppe dont jouissait fragilement jusque-là un Momo mal récompensé de son hospitalité. Imité des grands schémas du répertoire européen mais transposé dans la précarité boutiquière d’un quartier populaire de Bruxelles, c’était à la fois l’usurpation d’Egisthe, de Macbeth et de Richard III, doublée de l’imposture machiavélique de Tartuffe.