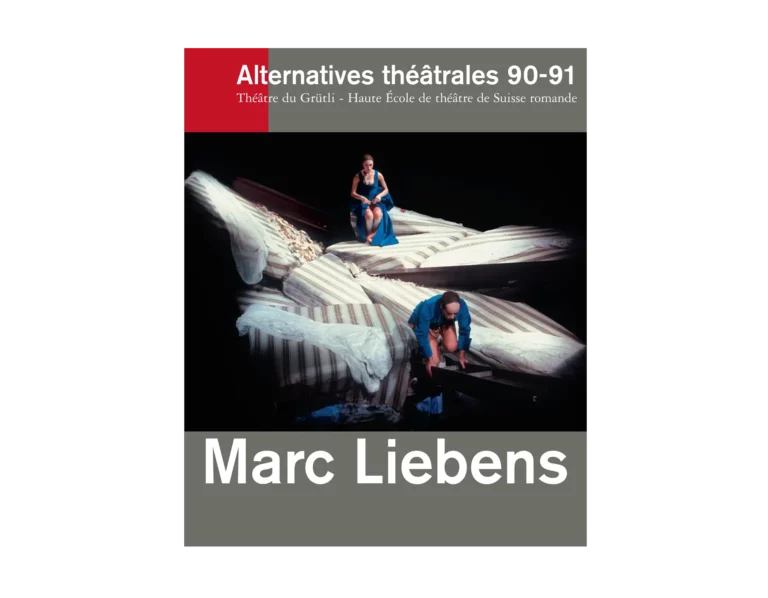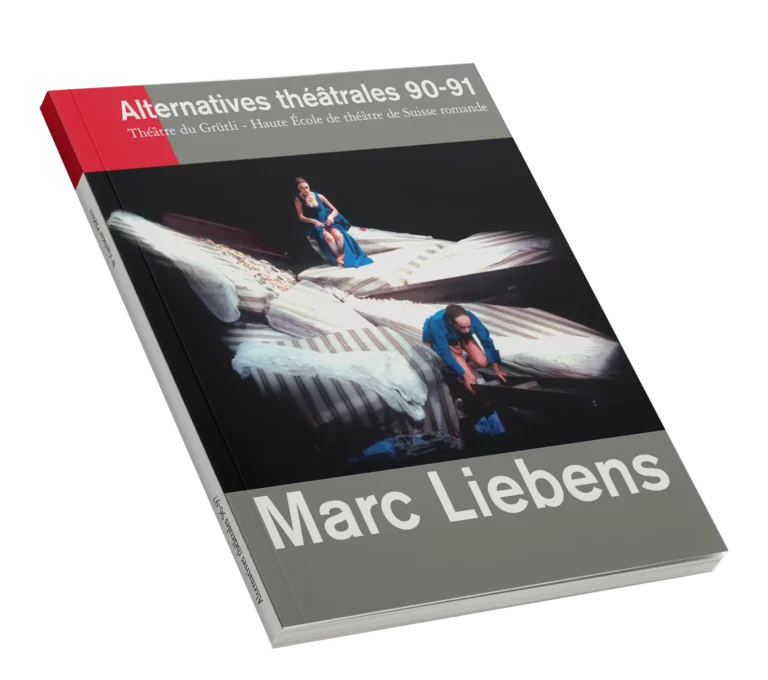En 1988, dans un texte intitulé L’enjeu éthique du jeu, publié dans L’Art du théâtre, Alain Badiou écrivait ceci :
« Saisi des débats interminables pour savoir si Hamlet est un phobique ou un schizophrène, ou s’il ne sait comment affronter la castration, Lacan y mettait fin par cette remarque qui m’a toujours réjoui, que de telles consultations analytiques étaient vaines, de ce que Hamlet n’existe pas. »
Cette remarque de Lacan me réjouit moi aussi, autant que me réjouissent les considérations dont Badiou l’accompagnait et la différence qu’il faisait entre le bon théâtre et le mauvais, le mauvais étant celui qui laisse entendre que « quelque chose existe », « qu’il y a quelque chose à imiter », qui « nous propose une mise en signe des substances supposées ». Toujours dans ce même article, il écrivait aussi :
« Ce qui se présente est l’acteur, et si son jeu présume de l’existence de quelque chose comme Hamlet, le théâtre est dissous. »
À l’instar de Badiou, je dirais que l’écrivain de théâtre qui m’intéresse, c’est celui qui m’empêche de supposer des substances, qui ne donne rien à imiter.
Je vais bientôt monter Amphitryon de Kleist. Pourquoi ? Parce que Kleist joue avec le théâtre, avec les « règles » du théâtre, ses… substances, qu’il brouille, qu’il renverse ou qu’il vide. Tout se passe hors de scène ou avant ou après, et l’affrontement entre les personnages y est aussi impossible que leur rencontre. Parce qu’il agence son histoire pour qu’elle ne s’accomplisse jamais. Les personnages n’y peuvent à aucun moment jouer leur rôle au sens de leur « emploi », comme on dit au théâtre. Seul Sosie joue quelque chose jusqu’au bout et dans la jouissance : quand il répète comme un acteur le rôle du messager, au début de la pièce ; mais il n’est pas au bon endroit, il n’a pas la bonne partenaire : ce devrait être Alcmène, or ce n’est qu’une lanterne, et en plus, il n’est pas du tout censé faire l’acteur ! Ironique, non ? Comme tragédie, cette pièce est bouffonne, comme comédie, elle est atroce.
Alors, c’est quoi ? C’est un objet bizarre, à peine identifié comme théâtre, longtemps désigné en tout cas comme « irréprésentable ».
Vu d’aujourd’hui, l’exemple de Kleist est typique de ces deux vitesses dont on me demande de parler. C’est un auteur mort et son texte est devenu cadavre, c’est-à-dire objet cernable. Plus d’un siècle nous sépare, et aujourd’hui, on peut monter Kleist parce qu’il est clos, clôturé. Il est mort et son œuvre est achevée, son monde aussi, qui n’est plus tout à fait le nôtre. Aujourd’hui, on parle de jeu avec des règles, donc, nous aussi, metteurs en scène, pouvons jouer, cent ans après, à l’unisson.
Cela vaut pour tous les classiques : mettez un smoking à Hamlet, disait Brecht, est toujours bon pour le smoking, mais cela ne change rien à ces six lettres qui forment le nom Hamlet. J’ai vu Ajax revêtu d’un uniforme venu tout droit de l’armée américaine, cela ne m’a pas rapproché Ajax pour autant, Athéna encore moins, qui ne peut que faire métaphore. Et quand il y a métaphore, c’est qu’il y a quelque chose à imiter ! Ceux qui croient au rapprochement se leurrent, les deux vitesses sont toujours là. Mais ce n’est pas très grave et Sophocle s’en sort bien : il reste là où il est, à sa bonne place, à 2 500 ans de nous.
Est-ce à dire qu’il n’est de bon auteur de théâtre que mort ? Pour qu’une rencontre ait lieu, en tout cas, c’est à craindre.
Pourquoi ? Est-ce parce que l’une s’inscrit dans la durée et dans l’espace et l’autre dans l’ici et maintenant ? Je ne crois pas, pas vraiment. En fait, cet art apparemment du hic et nunc, cet acte reproductible qui n’existe à chaque fois que dans la singularité de son accomplissement d’un soir, est en réalité un art qui a tellement à voir avec le passé qu’il en devient presque impossible au présent. Je ne parle pas du théâtre, qui lui, quand il s’accomplit, s’accomplit au présent ; je parle de la mise en scène, de ce qu’elle fige et fixe et tue d’un texte sur le plateau. Après, par le jeu, l’acteur redonne vie, chaque soir, ou essaie de le faire.
La mise en scène est prélèvement, biopsie ; le texte, lui, est totalité, mais totalité trouée, inachèvement. Totalité puisqu’il porte un certain nombre de possibles, inachèvement puisqu’il demande un espace, un corps, une voix, c’est-à-dire un morceau de vie d’acteur et de metteur en scène.
Monte-t-on jamais un texte de théâtre ? Le monter, n’est-ce pas proprement l’exécuter ? Ne faut-il pas, pour le monter, justement, chercher ailleurs et autre chose ?
Diderot : « Quel est donc son talent [à la Clairon] ? Celui d’imaginer un grand fantôme et de le copier de génie. Elle imitait le mouvement, les actions, les gestes, toute l’expression d’un être fort au-dessus d’elle. »
Comme je dis : chercher ailleurs et autre chose, du côté des héros et des morts. Il le sait, Müller, quand il commence Hamlet-Machine par : « J’étais Hamlet »… Encore plus radical, peut-être, que le fameux « Me voici, ignorant, imbécile » de Tête d’or. Quoique Claudel, déjà, ne postulait que les défauts de son personnage : un personnage par défaut, donc. Et le travail du metteur en scène, c’est de s’engouffrer dans ce défaut-là, d’effacer au maximum l’acteur qui, rassurez-vous, fait retour quand même, toujours et heureusement, car c’est entre sa disparition et son retour, entre le héros mort imaginé et la petite personne présente, qu’il y a le théâtre.
Diderot, encore, à Garrick : « Ne m’as-tu pas dit que, quoi que tu sentisses fortement, ton action serait faible, si, quelle que fût la passion ou le caractère que tu avais à rendre, tu ne savais t’élever par la pensée à la grandeur d’un fantôme homérique ? »
Le vif se doit d’aller saisir le mort, ça, c’est pour le jeu, pour l’acteur. C’est aussi, la plupart du temps, ce que fait le metteur en scène : rejoindre l’auteur mort. J’entends par auteur mort l’auteur dont l’œuvre s’est détachée du champ social dans lequel un jour elle s’est inscrite, et qui donc, nous parvient aujourd’hui comme un objet facile à identifier. Mais c’est un objet qui ne fait aucun mal, parce que ce qu’il nous dit est soit révolu, soit accompli, en tout cas connu, assimilé, digéré. Un objet saturé d’histoire, d’Histoire tout court et d’histoire du théâtre. Mais un acteur peut être physiquement mort et son théâtre terriblement vivant : Pasolini, par exemple.
Je postule avec lui ma deuxième « rencontre » pour la saison prochaine. Je mets rencontre entre guillemets, car la première a fait son trou : quelque chose d’Orgie n’a pas été mis en scène : dans le spectacle que j’ai fait en 1986, manquait — ça paraît ironique aujourd’hui, mais cependant, c’était fondamental — la dimension du retour du pendu ! On essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais il faut le savoir : la mise en scène d’un texte contemporain ne peut se dessiner que sous forme d’asymptote.
Mais enfin, je reviens au bonheur, en 1978, de rencontrer un texte de théâtre, une fiction qui nous parle de tout cela ! Tout y était, même la mise en pièce de l’auteur !… Enfin, de sa photographie ! On en a parlé à l’époque — et écrit —, de sa déconstruction du personnage — s’il était Hamlet, c’est qu’il ne l’est plus, une Ophélie que la rivière ne garde pas n’est plus tout à fait une Ophélie —, de la division du sujet, du fractionnement de l’intrigue et de sa mise en pièce, de l’intellectuel schizophrénisé…
De cela, nous avons monté/montré certaines choses. Des dérives sont apparues aussi que nous n’avions pas prévues, comme toujours dans les spectacles. L’espace était comme une page blanche sur un plateau : une lande de neige, très longue et très étroite, un Hamlet en imper noir s’y déplaçant comme un jambage et une Ophélie son double, imper noir elle aussi, qui murmurait une révolte inutile.
Les deux vitesses dont il n’arrête pas d’être question ici nous restaient néanmoins en travers de la gorge, et j’ai remis sur le métier l’ouvrage, recherchant autre chose de Müller que le texte et son mythe théâtral : j’ai ajouté Avis de décès et cet autre texte, Sur le Père. Atteindre l’auteur par ses morts devenus écriture, théâtre ?
Il n’y avait plus vraiment de plateau, la scène autrefois du monde était réduite à l’espace privé d’un loft grandeur nature et dans lequel l’« Interprète d’Hamlet » tournait en rond en portant le rideau rouge sur son dos comme d’autres le poids du monde.
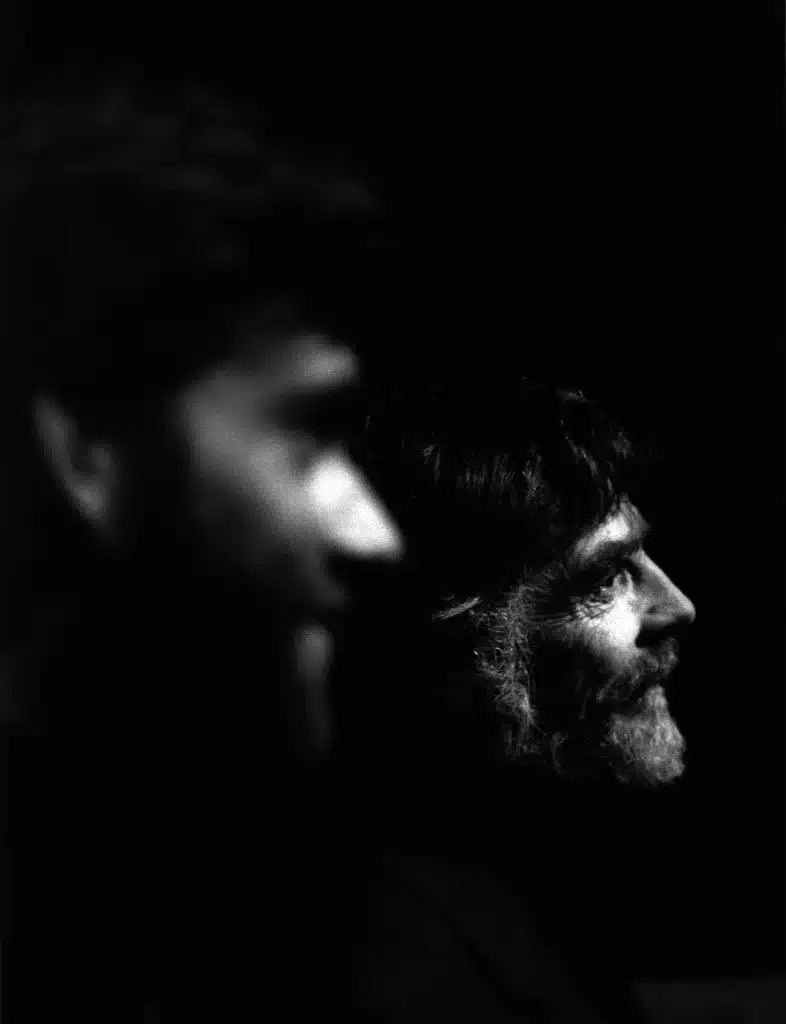
Autres questions, autres réponses. Et aujourd’hui, ce qui me frappe, c’est que ce texte écrit aussi comment le mort saisit le vif et que cet Hamlet qui blablate devant les ruines de l’Europe tente de se dégager de son illustre modèle, de la spirale de la vengeance et de l’escalade de la violence, mais comment il échoue, repris qu’il est à chaque coup par la « Machine-Hamlet » — c’est ainsi qu’aujourd’hui j’aimerais comprendre le titre allemand : Die Hamlet-Maschine.
« Je ne joue plus de rôle. Mes mots n’ont plus rien à me dire. Mes pensées aspirent le sang des images. Mon drame n’a plus lieu. » Et pourtant, cet interprète d’Hamlet vaut le fantôme qui lui colle à la peau, mieux, il en devient un lui-même, mais pas tout de suite !
Deux vitesses, oui, oh combien. Mais je n’irais pas jusqu’à dire que la mise en scène doit rester autonome « pour garder son autonomie au texte ». Un texte contemporain a trop d’histoire et pas assez : il a trop d’histoire du théâtre — je veux dire de littérature dramatique inscrite à l’intérieur — mais aucune de la représentation, ou si peu. Alors c’est au metteur en scène à louvoyer à sa manière entre ce trop plein et ce peu.
Peut-être existe-t-il un espace de l’imaginaire où les temps se rejoignent ? Au niveau du public, peut-être ? Troisième vitesse dans l’espace-temps… En tout cas, comme dit Badiou, encore :
« Pensée du temps, le théâtre l’exécute au passé. »
En 1988, dans un texte intitulé L’enjeu éthique du jeu, publié dans L’Art du théâtre, Alain Badiou écrivait ceci :
« Saisi des débats interminables pour savoir si Hamlet est un phobique ou un schizophrène, ou s’il ne sait comment affronter la castration, Lacan y mettait fin par cette remarque qui m’a toujours réjoui, que de telles consultations analytiques étaient vaines, de ce que Hamlet n’existe pas. »