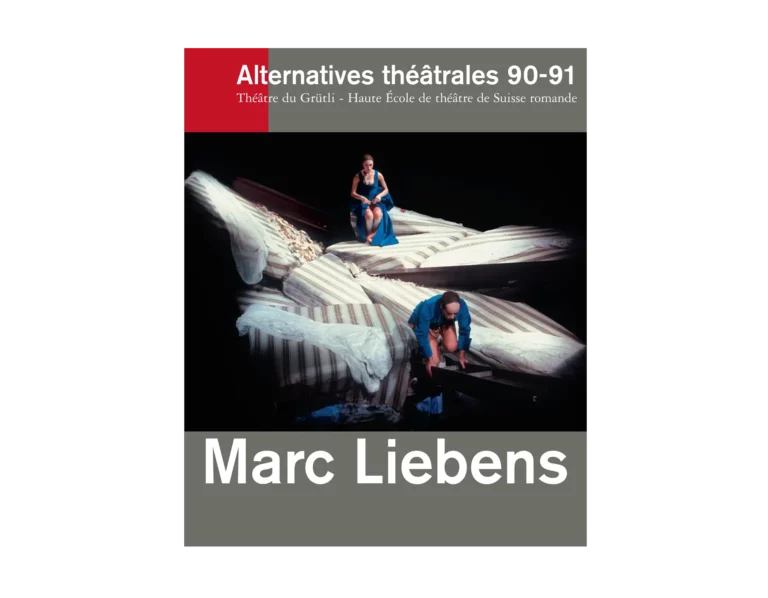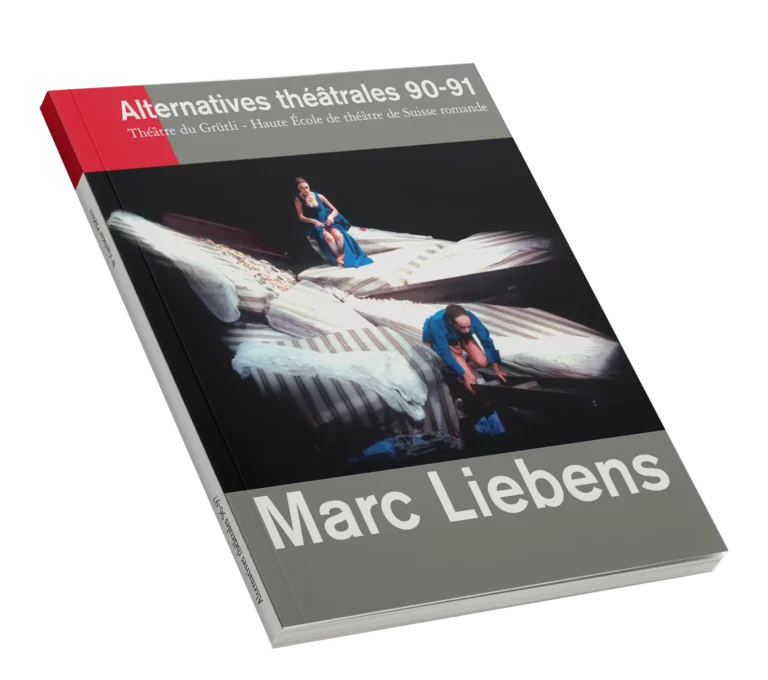Nieuport, le 26 décembre 1979
Cher Bernard Dort,
Ces quelques mots constituent-ils encore une lettre ? Oui, parce que j’ai envie de vous les faire parvenir… Vous n’avez pas le temps de poursuivre cette correspondance et je le regrette, car elle n’est pas fausse, croyez-moi. Nous aurions pu tenir deux discours : vous, avec votre connaissance de Shakespeare et de Brecht ; moi, avec ma sensibilité à ce texte-ci, précisément. Pourquoi faudrait-il que l’on se pose des questions dont l’autre ait la réponse ? Pourquoi faudrait-il que l’on parle du même lieu et que l’on tienne le même langage ? Hamlet et Ophélie sont, chez Müller, chacun dans leur(s) théâtre(s), et pourtant, ils sont bien dans le même texte.
J’aurais aimé que l’on parle davantage de cette annulation par Müller, l’une par l’autre, de la grande visée historique et de la dérision théâtrale — il achève un théâtre ou il en invente un nouveau ? — en relation, sans doute, avec ce désir et cette peur d’un grand changement, et de la question de savoir quelle part l’homme y prend.
Mais il est un peu inutile d’entamer des discussions. Donc, gardons nos distances, restons dans nos propos.
En ce qui me concerne, j’avais envie de vous parler de cette deuxième voix qui se joue en deux fragments : « L’Europe de la femme » et « Furieuse attente dans l’armure terrible des millénaires » ; ce fameux personnage féminin qui continue de s’appeler Ophélie, mais qui, à la fin, se présente comme Électre qui parle.
Il y a, dans Hamlet-Machine, une voix qui ne joue pas du tout Hamlet — ce qui ne veut pas dire qu’elle ne joue pas du tout Shakespeare — qui ne se pose plus/pas la question. Elle n’a gardé d’Ophélie que le nom, elle a entièrement vidé le personnage de sa substance et de sa fonction. Forcément, le personnage de Shakespeare n’est vraiment plus d’aucune utilité pour la femme contemporaine qui refuse de se suicider, même avec des moyens modernes (l’overdose, la cuisinière à gaz, etc.). Il n’y a guère, dans l’histoire, dans la littérature, dans le théâtre, un modèle par rapport auquel elle pourrait se situer, dans, contre, hors. La femme sans histoire, la femme sans parole, la femme sans théâtre…
Le premier fragment, « L’Europe de la femme », n’est traversé par aucune référence à aucune théâtralité. Pas de jeu, pas de mythe, pas d’histoire, pas de réflexion.
Elle ne dit que des actions concrètes qui s’épuisent dans le simple fait de s’énoncer. Pour Ophélie, la question ne se pose pas d’être ou de ne pas être : elle fait, c’est tout. Toute entière dans ces actions, dans cette série de gestes qui semblent suffire à la définir à ce moment-là de la pièce. Rien avant, rien après, rien au-dehors (sauf le cri du monde, que l’on appelle). Le langage la recouvre, elle sature le théâtre.
« Je suis seule… Je détruis les instruments de ma captivité… J’ouvre grand les portes… Je sors dans la rue… »
Paroles simples, élémentaires, qui ne racontent rien d’autre que ce qu’elles disent.