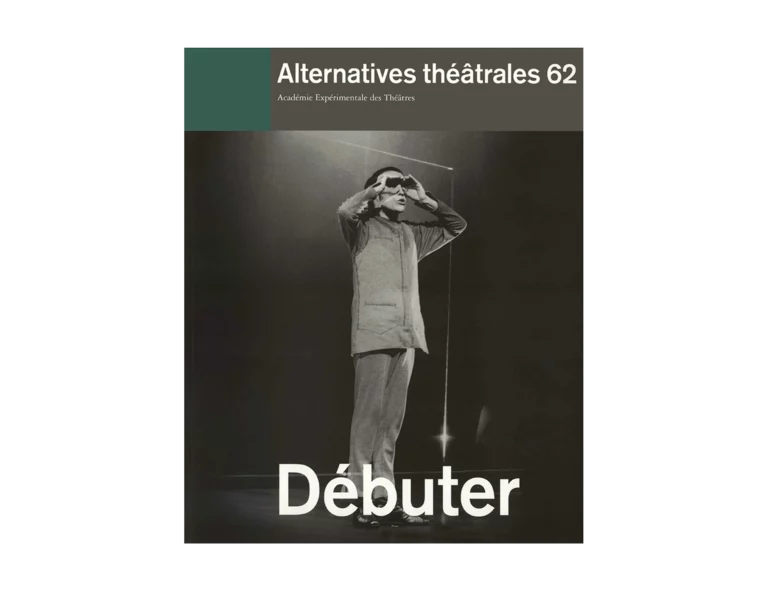Julie Birmant : Tu m’as dit avoir choisi de faire du théâtre, avant tout parce que c’était un moyen de t’affranchir de ton milieu social ouvrier, Comment ce sentiment s’est-il formé ?
Michel Dezoteux : J’ai commencé le théâtre dans les années 60, les années bénies. Tout semblait alors possible ; même pour ceux qui venaient d’un milieu ouvrier comme le mien. J’ai eu la chance de faire des humanités1, ce que n’ont pas fait mes parents, encore moins mes grands-parents, et j’avais le désir de m’en aller, de quitter ma province, La Louvière, et de côtoyer d’autres façons de vivre. J’avais l’impression de vivre la disparition de l’univers ouvrier, de tout ce qui faisait la culture de mon père, sa pratique quotidienne : un certain rapport au travail, à l’usine, les façons de se réunir, de chanter. Ils avaient conscience de vivre désormais en décalage avec la réalité et se sentaient trahis par la société. J’ai vécu ce tiraillement. On était élevé dans l’utopie socialiste, imprégné de sa culture, et en même temps nous n y croyions plus. Ces valeurs me constituent, elles influent sur ma pratique de metteur en scène, de directeur de théâtre et de pédagogue ; mais en même temps, je n’ai jamais voulu travailler à l’usine, devenir ouvrier.
J. B.: Tu as voulu sortir de l’étouffoir. Mais pourquoi as-tu choisi précisément le théâtre pour le faire ?
M. D.: J’avais envie de littérature. J’étais passionné de littérature et de poésie. Je lisais énormément. Mais je me suis rendu compte très vite que je n’étais pas écrivain. J’ai fait également diverses expériences de théâtre pendant mes humanités, de la marionnette, de l’expression corporelle aussi. C’était au Centre Culturel du Hainaut. Nous n’avions pas beaucoup l’occasion d’aller au théâtre, mais je me souviens avoir vu un spectacle de Rudy Barnett dans lequel Philippe van Kessel jouait. Cela m’avait beaucoup marqué. J’ai eu également quelques professeurs de français formidables qui trouvaient vraiment très étrange qu’on m’ait relégué dans une filière technique. L’un d’entre eux était Jean Louvet. Je me suis inscrit à son club théâtre, il nous racontait des histoires étonnantes, la mort de Che Guevara, par exemple. Et puis un jour j’ai vu une affiche qui présentait l’INSAS2 dans le hall de mon école. J’en ai parlé à mon professeur de français qui m’a conseillé de tenter le concours. J’ai alors réuni quelques copains à la Louvière et on a commencé à travailler sur des pièces didactiques de Brecht qui sont davantage écrites pour ceux qui les montent que pour ceux qui les voient. C’est alors que j’ai fait la découverte d’un monde étonnant qui ouvrait une réflexion sur la société, une sorte de laboratoire où l’on devait chercher à comprendre le réel au travers d’un texte.
Je suis arrivé à l’INSAS en 1968. C’était surréaliste : pour passer les examens de mai, j’avais mis un costume trois pièces, une cravate ! Nous passions un oral de présélection. Les étudiants racontaient tous qu’ils voulaient faire du théâtre pour les ouvriers alors que moi je voulais au contraire faire du théâtre pour ne pas être ouvrier ! J’ai été reçu au concours !
L’INSAS m’a ouvert un certain nombre d’horizons, mais m’a en même temps incroyablement déçu. Je trouvais le milieu très bourgeois, très étriqué, et Je me suis inscrit parallèlement en philosophie à l’Université. Mais j’ai encore une fois été déçu, m’apercevant très vite que le but de l’enseignement était de transformer les étudiants en professeurs de morale. J’ai mené de front l’INSAS et l’Université, sans grand enthousiasme, jusqu’au Jour où j ai eu la chance de rencontrer Eugenio Barba. C’est cette rencontre qui m’a donné une accroche directe avec le théâtre. Il était venu faire une semaine de stage public à l’INSAS. Il était avec ses acteurs, et les élèves comédiens de troisième année de l’INSAS faisaient avec eux l’entraînement physique et vocal devant les élèves des autres sections qui étaient intéressés. J’ai fini mes études par un spectacle à partir du MASSACRE À PARIS de Christopher Marlowe et j’ai fait un premier spectacle ANATHÈME avec des acteurs non-professionnels que j’avais rencontrés dans des stages — Les acteurs professionnels ne voulaient pas travailler avec moi à cette époque ! J’ai aussi été l’assistant du metteur en scène Derek Golby au théâtre de Poche. Et puis je suis enfin parti à l’Odin Teatret, suivre un stage de formation d’un an auprès de Barba. Nous sommes seulement une vingtaine de personnes (hormis les acteurs de Barba) à avoir été initiés aux secrets de Barba. Ec c’est seulement après ce stage que j’ai compris le livre de Grotowski TOWARD A POOR THEATER, tout comme ceux de Stanislavski. Tout d’un coup tout prenait un sens concret, devenait réel.
J. B.: De retour de ton voyage de formation à l’étranger, tu fondes avec le comédien Dominique Boissel, un lieu de théâtre expérimental, le Théâtre Élémentaire. Comment est née cette idée ? Quels en étaient les objectifs ?
M. D.: À Bruxelles, les institutions étaient complètement fermées. Il n’y avait pas d’alternative théâtrale. Tout s’organisait autour du Théâtre National et de son directeur Jacques Huysman dont nous n’appréciions pas du tout les spectacles. Nous ne nous sentions aucune filiation avec les metteurs en scène belges qui nous précédaient. Il fallait donc inventer notre propre outil. Un outil avec lequel il serait possible de réaliser ce qui me paraissait essentiel : le travail de compagnonnage avec des acteurs à partir de textes pas forcément dramatiques. Il nous fallait un lieu, et un peu d’argent.
Nous ne partions de rien. Et si nous avons pu vivre l’aventure du Théâtre élémentaire, c’est vraiment parce qu’est née à cette époque — le milieu des années 1970 — une nouvelle politique culturelle qui voulait soutenir les jeunes compagnies : on recevait 300 000 FB (50 000 FF) pour faire un spectacle, c’était miraculeux. Nous avons trouvé un lieu à Anderlecht, un premier étage d’immeuble que nous avons tout de suite transformé en théâtre. Il fallait peindre les murs, construire le circuit électrique, le boîtier de sécurité, le gril. Il faut dire que nos recherches nous menaient vers un théâtre d’abord physique et vocal, et pour le reste, très dépouillé : dans le premier spectacle, il n’y avait pour tout éclairage qu’une lampe de 120 watt et crois bougies !
La nécessité première était celle d’exister, de poser des actions par le théâtre. Cela avait encore un côté théâtre pour le théâtre. Ce n’était pas encore rattaché à une vision beaucoup plus globale, comme peut l’avoir le Varia aujourd’hui, d’intervention sur le public et la société. Mais ceux qui virent notre travail le vécurent comme un découverte :c’était la première fois qu’ils voyaient un théâtre de corps, alors que Grotowski et Barba faisaient cela depuis déjà plus de vingt ans.
J. B.: Après la création du Théâtre Varia en 1982, tu te mets à faire un autre type de théâtre moins expérimental, plus citoyen. Comme si tu ressentais la nécessité de rencontrer un public plus large. Pourrait-on dire que tu commences alors une nouvelle histoire, que tu connais un nouveau début ?
M. D.: Le Théâtre Élémentaire était un théâtre de quarante-neuf places : nous étions encore en train d’apprendre. Et petit à petit nous avons pris conscience de la limite même des possibilités de notre entreprise. Je crois que, dans un premier temps, on fait du théâtre un peu pour ses parents, quand on a la chance d’être fils de bourgeois qui possèdent un théâtre de verdure dans leur jardin, on invente des divertissements, comme dans le premier acte de LA MOUETTE, et puis, dans un deuxième temps, on essaye de se découvrir à travers ce métier-là : les différentes situations que l’on affronte transforment la conscience que l’on a de la destination de notre travail. Très vite, j’ai eu besoin d’élargir le public, d’avoir un propos plus conscient ; j’ai senti au bout de trois ou quatre ans que le Théâtre Élémentaire ne pouvait plus se développer, mais seulement reproduire les mêmes schémas de recherche. Il fallait aussi songer à exercer un métier dont on puisse vivre !
Le Varia est, il est vrai, un nouveau début, mais l’époque qui a suivi mon retour de Grenoble en 1990 l’est tout autant … J’ai le sentiment d’avoir toujours été en train de recommencer. D’abord parce que nous n’étions jamais sûrs d’avance d’être soutenus par les pouvoirs publics, ou par les autres relais institutionnels. Et ce jusqu’à très récemment.
L’histoire de la création du Varia est celle d’un concours de circonstances. Philippe Sireuil, Marc Liebens, Philippe van Kessel et Patrick Roegiers avaient inventé ce qu’on a appelé le Cartel. Ils ne sont jamais arrivés à se mettre d’accord et ont un jour demandé à Marcel Delval et à moi-même de les rejoindre. Philippe Sireuil voulait absolument avoir un lieu de théâtre. Mais Patrick Roegiers est parti soudainement en France, Marc Liebens voulait rester seul, et Philippe van Kessel avait un autre projet individuel à défendre. Il ne restait plus que Marcel et moi ! Nous avons accepté d’investir avec Philippe Sireuil le grand garage désaffecté qui allait devenir le Varia. Il avait une subvention plus importante que la nôtre, à nous trois on allait pouvoir réaliser nos désirs de théâtre : nous étions bien loin d’imaginer que ce lieu deviendrait un jour un Centre Dramatique dont nous serions tous trois directeurs ! Nos spectacles ont très vite de plus en plus fonctionné dans le souci d’atteindre le public : les spectateurs venaient, dans un vrai lieu de théâtre. il fallait répondre à leur attente. C’est cette situation qui a influé sur notre esthétique :la pratique a amené les idées et non l’inverse.