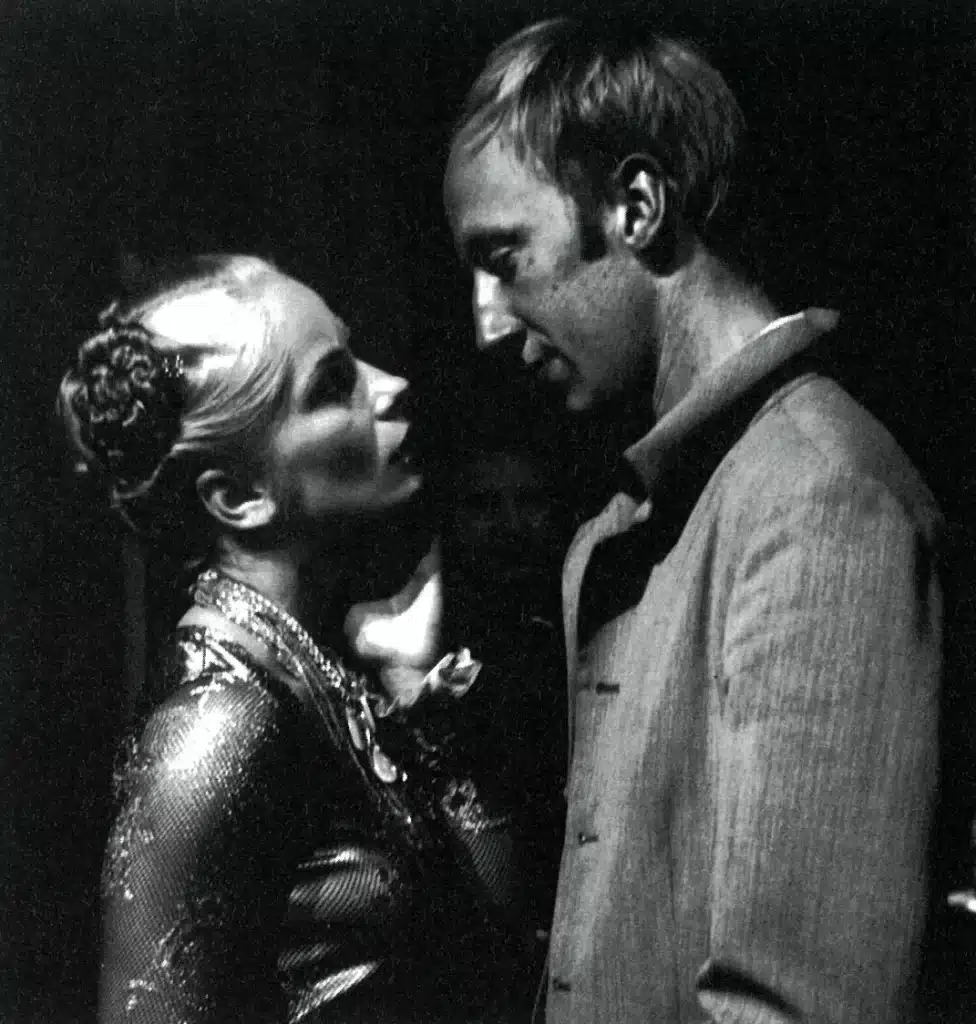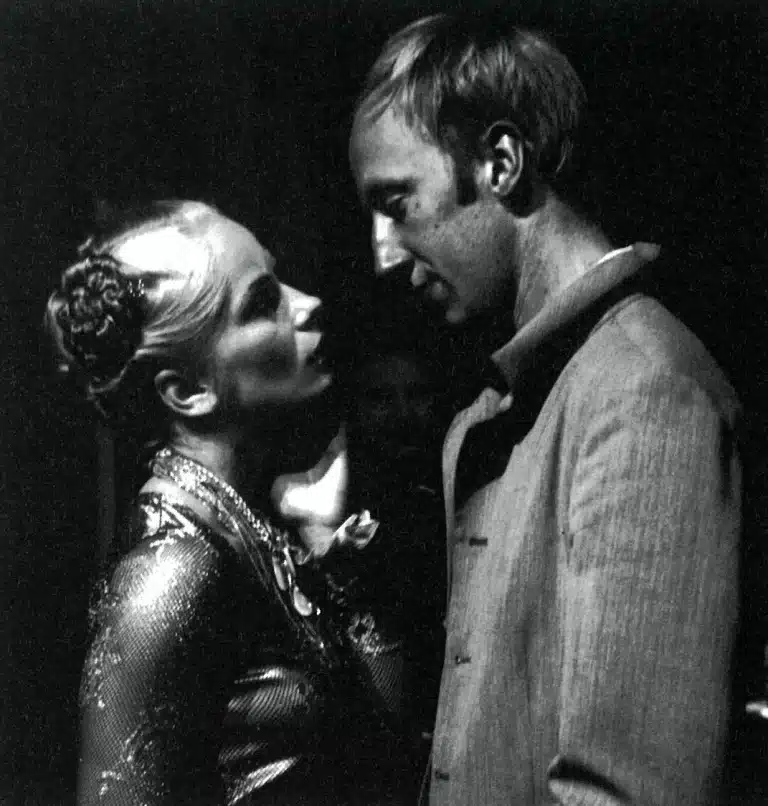Krzysztof Mieszkowski : Dans Uroczystosci (Cérémonies ou Festen), un citoyen honorable, le riche Helge, moleste sexuellement ses enfants. L’une de ses filles vient de se suicider et la vie de l’ensemble de la famille est bouleversée de manière irréversible. Le repas solennel découvre le drame de la maison familiale. En même temps, dans le spectacle, apparaît une perspective mythique — la destruction du pouvoir du père. Le spectacle a donc certaines caractéristiques d’un drame antique.
Grzegorz Jarzyna : À mon avis, ce drame appartient déjà au XXIᵉ siècle. Nous lisons les journaux et nous regardons la télévision. Les Talibans font sauter les statues du Bouddha, le Dalaï-Lama rencontre le président des États-Unis. En Pologne aussi, nous vivons avec les problèmes des autres nations, nous en endossons la responsabilité et nous tentons d’y participer ou, tout au moins, d’exprimer notre position. Nous nous intéressons aux événements du monde et, en même temps, la révision de nos bases familiales et sociales s’accentue. Cela ne se réalise pas du point de vue de la religion ou de l’Église, mais au regard de la responsabilité de l’homme envers l’absolu. Le croyant, tout comme l’incroyant, ressent une certaine angoisse. Ils savent tous deux qu’il faudra payer pour les fautes commises dans les familles. Je crois que tout cela est observé par un troisième œil, d’une perspective cosmique. Dans ce contexte, c’est un drame antique.
K. M. : Durant des siècles en Europe, le seul amour totalement autorisé était l’amour de Dieu. La tradition judéo-chrétienne opposait le monde spirituel au monde des sens, la pensée à la matière, l’âme au corps. Finalement, Nietzsche est venu et a annoncé la mort de Dieu. Le corps s’est émancipé et l’idée de la libération sexuelle s’est développée. Est née une société de consommation qui, lentement, se transforme en société prise dans un filet. Nous nous sommes offert la décomposition de la famille et des valeurs fondamentales. Les gens cessent de parler entre eux, ils deviennent de plus en plus solitaires et abandonnés, impuissants et cruels.
G. J. : On ne peut rapprocher les gens qu’en leur proposant un thème très intime dont ils ont honte de parler. Chacun d’entre nous est touché par une sorte de faute tragique. Il peut en effet s’avérer que, dans un concours bizarre de circonstances et de lieux, apparaissent des gens qui découvriront en nous un bouc émissaire. Les fautes des ancêtres y sont vengées : il doit être aveuglé, partir ou périr.
K. M. : Dans ce spectacle, nous avons affaire à un monde sans Dieu mais, paradoxalement, imprégné de métaphysique. Penses-tu que cette famille tragiquement déchirée a une possibilité de purification ?
G. J. : Oui.
K. M. : Dans l’Antiquité, les gens élus étaient marqués par le sceau du tragique. Par contre, chez toi, chaque personnage est frappé par un tel destin.
G. J. : J’ai réalisé un jour, avec étonnement, qu’en fait, aucun de mes amis n’était heureux. Chacun d’eux porte la marque d’une souffrance venue de l’enfance. Par rapport à ce qu’il s’imaginait devoir être, il se sent imparfait. Durant toute notre vie, nous tentons de le cacher et de l’oublier.
K. M. : Kazimierz Kutz a dit que les jeunes metteurs en scène mènent un dialogue avec l’art et les conventions artistiques et non avec ce qui est essentiel : le monde. Il considère que c’est le privilège ou le défaut de la jeunesse. Il pensait sans doute à toi.
G. J. : Søren Kierkegaard a écrit que, dans la vie, nous avons trois périodes : esthétique, éthique et religieuse. Comme jeunes créateurs, nous avons droit à l’expérimentation esthétique, c’est le privilège de l’âge.
K. M. : Le franchissement de l’esthétique indique le plus souvent le dépassement des frontières de son propre théâtre. Ton dernier travail n’est pas une tentative de fixer le langage employé jusqu’à présent, mais d’aller au-delà. De nouvelles idées y apparaissent, mais je vois toujours l’influence de Lupa pour lequel l’enfance est l’inspiration fondamentale.
G. J. : J’ai mûri rapidement. Faire des choses qui sont le privilège des plus âgés m’a toujours plu. Je voudrais me débarrasser de l’enfance comme d’un bagage inutile.
K. M. : Tu n’aimes pas ton enfance ?
G. J. : J’ai maintenant 33 ans, il est peut-être trop tôt pour faire un bilan.
K. M. : Je suis tes spectacles depuis 1997, quand tu as débuté à Varsovie avec Bzik tropikalny (La Dinguerie tropicale) de Witkiewicz. Tu es devenu un metteur en scène que les médias adulent. On parle de Jarzyna aussi comme d’une idole du pop. C’est une référence à une culture de masse.
G. J. : Le théâtre est un moyen de communication médiatique.
K. M. : Les médias ont obtenu une autonomie relative. Ils sont une force par eux-mêmes. Ils se nourrissent de tout ce qui les entoure. Tout ce qui tombe est bon à saisir. Ils forment un monde sur lequel nous n’avons aucune influence.
G. J. : Il dépend de nous de nous y soumettre. Le problème, c’est qu’ils sont attractifs. Nous n’en voulons pas, mais nous nous y soumettons. (…)