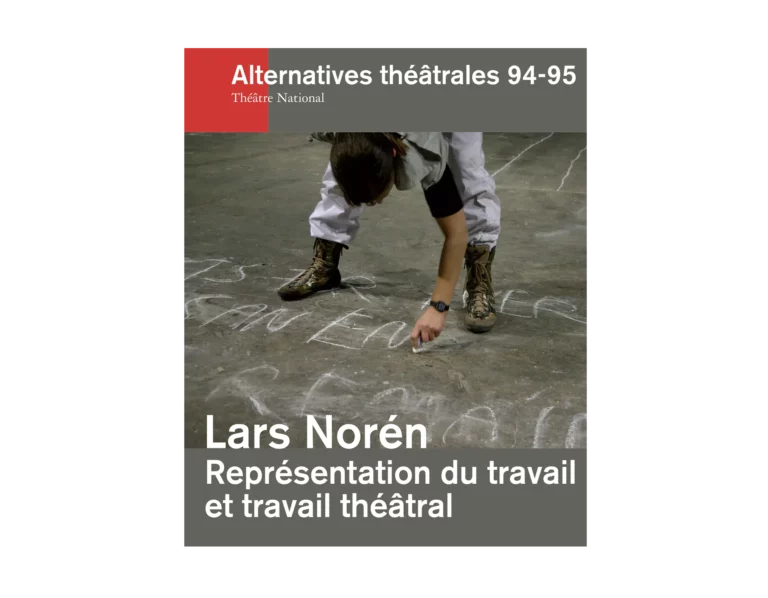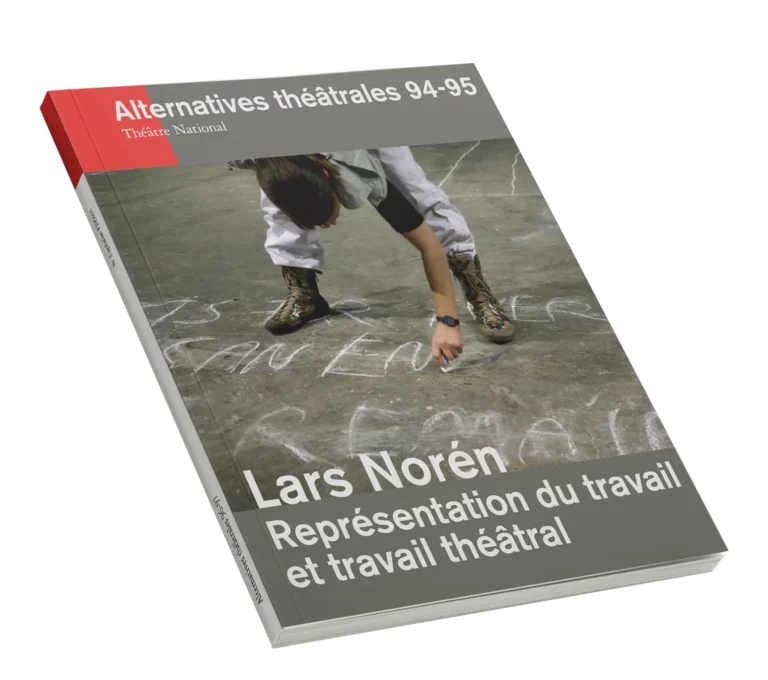Entretien avec Isabelle Polisseur réalisé par Bernard Debroux
Bernard Debroux : Comment naissent tes projets de spectacle ? Est-ce au départ d’un concept ? À quel moment intervient le théâtre ?
Isabelle Pousseur : C’est très mystérieux… Depuis que je fais du théâtre, il y a toujours eu plusieurs types de projets. Certains étaient de pures créations, d’autres étaient des pièces de répertoire. Il y en a qui étaient un peu entre les deux et ils se sont toujours construits les uns par rapport aux autres. J’ai parfois eu besoin de retourner au répertoire parce qu’après une période de pure création, je ressentais le besoin de retourner à de l’écriture constituée, ou l’inverse… Tout ça a toujours été très lié à des moments de ma vie. Alors, comment naît un projet ? En tout cas, le « comment il naît » est important. J’accorde beaucoup d’importance à la qualité de sa naissance. Il ne naît pas ou quasi jamais par opportunité ou par opportunisme. J’accorde de l’importance à ce que sa naissance soit une nécessité que je puisse éprouver comme profonde. Mais c’est aussi un mystère, car je n’ai pas de grille d’examen de la profondeur de ma nécessité ! Ce sont des choses que je soumets à des sortes d’examens personnels qui peuvent être chaque fois différents. Parfois, ça a à voir avec la durée. J’ai tout à coup l’impression qu’un tel texte me hante, je me dis qu’il y a quelque chose qui me poursuit et qu’il faut que j’aille voir de plus près. Parfois, c’est beaucoup plus brutal ; en lisant quelque chose, par exemple, ça se passe dans l’instant et je dois réagir tout de suite.Je fais très fort confiance à mon instinct, à mon intuition et au sentiment que je peux avoir d’être saisie par quelque chose. Mais « comment ils naissent », c’est vraiment la question à laquelle je ne peux pas répondre ; je ne sais pas pourquoi ou comment quelque chose est là… Quelque chose est là, je la reçois et je dois y répondre.
Bernard Debroux : Tu as dit pourtant que c’était lié à des moments de ta vie…
Isabelle Pousseur : Oui, mais c’est souvent après coup que je m’en rends compte. Comme lorsque, après toute une série de spectacles, j’ai tout à coup besoin de faire un changement de cap et vient alors un projet comme À ceux qui naîtront après nous, un projet très spécifique ; ou alors je dois interroger le rapport au public et le rapport aux acteurs et je remets un peu tout à zéro. Je sais qu’il y a dans ma vie des moments charnières où il y a des choses claires qui se passent. Par exemple, je travaille un texte à l’Insas avec des élèves et il ne me quitte pas ; je sens que je ne suis pas allé au bout, que je dois rencontrer des acteurs professionnels avec ce texte-là, que j’ai encore beaucoup à explorer. Ce que je suis en train de faire, en ce moment, c’est tout autre chose : ce sont deux actrices qui veulent travailler ensemble et travailler avec moi. Elles ne trouvaient pas vraiment de projets et j’ai décidé, il y a quatre semaines, de leur proposer 4. 48 Psychose de Sarah Kane. C’est une idée qui m’est tombée dessus une nuit… Ça peut être quatre, cinq choses qui me tombent dessus en même temps, des souvenirs de pensées que j’ai eues en voyant ce texte au théâtre, ou par exemple en voyant Claude Régy ce printemps à Lausanne qui le travaillait avec des élèves. Véronique et Catherine ont travaillé dans Matériau Médée et ont éprouvé des frustrations. Je mets ensemble toutes ces données et je relis le texte qui semble répondre à ces différents éléments. Là, c’est un exemple de décision très brutale, très rapide, même si les racines peuvent être anciennes.
Bernard Debroux : Les choses naissent, semble-t-il, plus par du vécu que par un concept ?
Isabelle Pousseur : Oui, tout à fait. Je suis très méfiante de tous les actes trop volontaires. Je crois être quelqu’un de très rationnel dans toute une série de moments de ma vie, donc, par rapport à la création, je ne veux pas que ce soit cette partie-là de moi qui agisse. Je veux vraiment que ça se passe autrement. Le choix des projets, j’essaye qu’il vienne du vécu et d’une partie de moi qui peut être enfouie. Il m’est arrivé de comprendre très tard pourquoi j’avais fait certains projets. C’était parfois pour des questions très intimes que je n’avais pas du tout lues au moment où je réalisais le projet.
Bernard Debroux : En définissant le temps d’un projet en trois parties, la conception, la préparation et la réalisation, comment navigues-tu dans ces trois temps ? On a déjà parlé de la conception, comment organises-tu la préparation ?
Isabelle Pousseur : Il y a toute une partie de temps de lecture, un temps que j’aime. L’idéal est d’avoir du temps de lecture, du temps de recherche dramaturgique réel. Un temps de lecture, très ouvert. Dans le cas d’un auteur, j’essaye de lire tout ce qu’il a écrit et ce qu’il y a autour. J’aime bien ce que j’appelle faire l’éponge. Avant même de produire, de créer ou de dire des choses, il faut que je me sois imprégnée, beaucoup. Il y a une époque de ma vie où j’avais plus de temps que maintenant, alors j’ai trouvé des stratégies pour le faire plus rapidement. Pour Tchékhov que j’ai déjà travaillé, j’ai quand même l’impression de partir à la découverte, autrement. Après avoir lu deux, trois biographies que je ne connaissais pas, je me suis dit que par rapport à L’Homme des Bois, il y a toute une problématique vis-à-vis de Tolstoï : la question de l’idéalisme. Tout en l’admirant, Tchékhov s’oppose à l’idéalisme, à une certaine forme d’idéalisme chez Tolstoï. Et dans L’Homme des Bois, il existe un conflit entre idéalisme et scepticisme personnifié par les personnages de l’Homme des Bois lui-même et Voïnitzki (qui deviendra Vania plus tard). Mais ce conflit existe aussi en Tchékhov lui-même. Ces deux personnages représentent aussi chacun des tendances de Tchékhov lui-même. Je peux mener ce travail dramaturgique et de lecture en faisant autre chose. C’est ce qui se passe en ce moment où je suis sur deux projets en même temps. Pendant le mois de juillet, j’accompagnais la scénographe qui travaillait sur la maquette et les costumes, donc sur les personnages, et je relisais le texte pour pouvoir répondre aux questions qui se posaient. C’étaient des questions extrêmement précises, tout en étant encore dans la dramaturgie plus générale et en même temps, je commençais à plancher sur Sarah Kane. Ce sont des moments où je suis extrêmement reconnaissante au métier que je fais de pouvoir les vivre. Ce sont de grands moments intenses d’apprentissage. À partir de là, il y a des axes de travail qui naissent, que je vais partager avec les autres. D’abord, forcément, avec le scénographe, c’est le premier avec lequel il y a un échange dramaturgique, la plupart du temps. Ensuite il y a tout le travail à faire à destination des acteurs. J’envisage la dramaturgie en direction des acteurs ; ce n’est pas n’importe quel type de pensée, n’importe quel type d’analyse, c’est une dramaturgie en direction de ceux qui vont jouer. Elle doit s’appuyer sur le texte, mais elle doit en même temps être un ressort de désir de jeu et un ressort de construction. À partir de cette étape-là, je songe à inventer les premières choses que je vais leur demander, des exercices ou des improvisations, des textes à écrire.